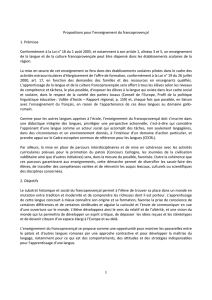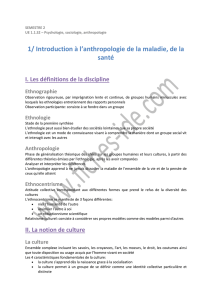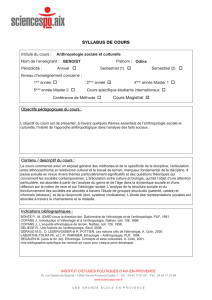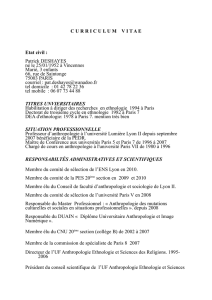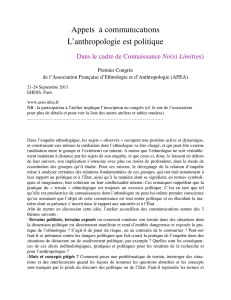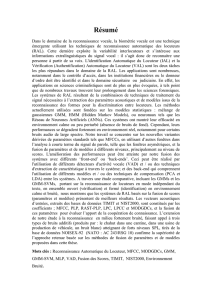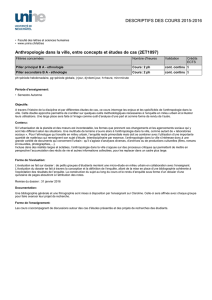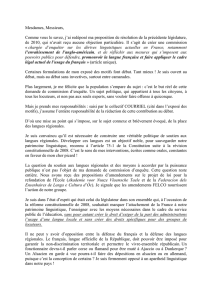Quelques éléments d`ethnologie pour aborder la civilisation

Christiane DUNOYER
Ethnologue réalisatrice
Docteur en Anthropologie Université d'Aix-Marseille I
Quelques éléments d’ethnologie pour aborder la civilisation francoprovençale
Je pars de loin, car il est très important de fixer des petits éléments basilaires afin de bâtir sur du
solide.
Si vous vous êtes inscrits à ce parcours de formation c’est parce que vous avez au fond de vous des
questions sans réponses. Vous êtes un auditoire privilégié qui se pose des questions, qui cherche des
réponses et qui pourra jouer un rôle important, peut-être décisif, dans le paysage culturel valdôtain.
Alors ne soyez pas trop rapides à trouver la réponse, prenez le temps d’écouter et d’observer, et
surtout de vous interroger peut-être pour la première fois sur des faits qui vous paraissaient
normaux jusqu’aujourd’hui : il n’y a rien de normal ni d’anormal, tout est construction.
L’ethnologie n’a rien avoir avec l’œnologie (sic !)
L’ethnologie n’a rien à voir avec la passion pour les choses vieilles : cela c’est de l’archéologie ou
de l’histoire ou de la brocante. L’ethnologie est la science qui étudie le fonctionnement des sociétés,
la relation à l’autre telle qu’elle se construit dans son contexte social, les moyens grâce auxquels les
êtres humains qui habitent un espace social s’accordent sur la manière de le représenter et d’y agir.
Il est important de distinguer trois stades dans la discipline ou trois degrés différents
d’approfondissement d’un même thème :
« Le passage de l’ethnographie à l’ethnologie puis à l’anthropologie révèle à la fois un emboîtement
apparemment technique voire théorique et un processus de généralisation et de comparaison de plus
en plus ample. » (Jean Copans)
Ethnographie : description soi-disant objective et neutre d’une population
Ethnologie : réflexion plus systématique et comparative à partir des matériaux de l’ethnographie
Anthropologie : méditation abstraite et universelle sur le devenir des cultures
Non seulement pour être anthropologue mais aussi pour être ouvert aux découvertes que
l’anthropologie faite par quelqu’un d’autre peut vous offrir, il est indispensable de se libérer des a
priori : non pas ajouter du savoir à votre savoir mais effacer tout et repartir sur de nouvelles bases,
en sachant que ce que vous croyez savoir ce ne sont pas des faits sociaux ou culturels mais votre
représentation de cette culture et de cette société.
Un exemple : les Alpes sont devenues un terrain de prédation et d’assujettissement culturel. C’est
un fait moderne. Alors quand on analyse le langage et que l’on trouve un mot dans la plaine et dans
les Alpes, on pense que c’est un mot qui a été imposé par la plaine : en réalité il fut une époque où
le savoir alpin dévalait les pentes, jusque dans les plaines.
Voilà un exemple pour porter un petit bémol à la théorie diffusionniste utilisée à tout bout portant.
Vous êtes porteurs ici d’un mini savoir local, je ne dis pas cela pour vous rabaisser, moi j’ai été
toujours confrontée à la multiplicité des formes, je n’ai pas cette sécurité linguistique due à l’unicité
d’une variante, j’ai trop réfléchi à la langue pour parler sans penser à comment dire : il s’agit de
bribes d’un parler conséquent et exhaustif qui suffisait à lui-même et qui n’est plus suffisant, à
cause de la concurrence des grandes langues de communication, de la hâte caractéristique de notre
temps, de la conviction qui s’est insinuée dans la tête des locuteurs de moins en moins maîtres de la

langue qu’il s’agissait d’une langue incomplète et inadaptée à la réalité qui nous entoure. Ce mini
savoir local dont vous êtes les dépositaires devra se nourrir de nouvelles compétences linguistiques,
dans une optique dynamique et toujours perfectible.
Tout est représentation. Plus vous serez compétents en la matière et plus vous saurez prendre du
recul, mieux vous pourrez transmettre et devenir un relai. Plus vous resterez dans vos
représentations, plus vous aurez du mal à transmettre quoi que ce soit : sans le recul, pas de
médiation possible entre deux visions du monde.
Un code linguistique ne sera jamais autre chose qu’une vision du monde : si on n’accepte pas cette
idée, on pourra transmettre du vocabulaire, des règles grammaticales, mais pas le souffle vital sans
lequel une langue comme un organisme vivant vit, se propage et fait jaillir des émotions. Ce que je
viens de dire n’est pas anodin car chaque langue véhicule sa propre vision du monde et à son tour
elle façonne les représentations de ses locuteurs.
Tout est représentation, on l’a vu. Et tout est dans la méthode :
- Il n’est pas de parole qui ne soit à contextualiser
- Il n’y a aucun fait qui aille de soi : tout demande une explication (arrêtons-nous sur le mot « ex-
plication »…)
Pour ce faire, il faut avoir les connaissances théoriques nécessaires (la littérature existante sur
un certain nombre de thèmes, tout se rejoint en ethnologie, sans cloisonnements de sorte,
transdisciplinaire, avec une vision le plus possible comparative).
Tenez, la notion de pureté. Chacun de nous a une idée de ce qui est pur. Mais la pureté existe-t-
elle? Qui parle une variante pure ? Combien sont-elles les variantes ? A-t-on le droit de décider
qu’une variante est meilleure qu’une autre ? Qui est un bon locuteur ?
Un ethnologue ne juge pas, ne porte pas de jugement moral : il constate et il explicite le non-dit,
il contribue à la prise de conscience de ce ressenti qui n’a pas encore été dit. Un autre exemple :
nous sommes dans une société travaillée par la passion antiquaire : tout ce qui est vieux vaut
« parce que c’est vieux » et le prestige des choses vieilles retombe aussi sur ceux qui s’en
occupent. Au cours des années 60 et 70 les vieux, ceux que quelqu’un pourrait définir les vrais
Valdôtains, n’avaient pas cette passion antiquaire : ils avaient tellement trimé, connu la
privation, la fatigue harassante, la peur, la mort, la maladie, la douleur, ils ont tourné le dos
massivement au passé, ils ont parfois vendu leur terre, ils ont refusé de transmettre un métier qui
voulait dire fatigue et désormais misère, ils ont préféré une table en formica plutôt qu’une vieille
table en noyer toute vermoulue, ils regardaient de l’avant, ils voulaient le mieux pour leur
progéniture. Avaient-ils tort ? Ce n’est pas du ressort d’un ethnologue de formuler un jugement
de ce type, ce que fait un ethnologue c’est de mettre en exergue qu’à chaque génération les
choses changent beaucoup plus qu’on ne le croit.
Le mythe du passé parfait, immuable. Le passé d’avant les transformations que nous avons
connues, n’était ni immuable, ni « parfait », ni « authentique », il était différent et surtout il
différait de lui-même de génération en génération.
Un exemple beaucoup plus vieux : les tenues vestimentaires. A chaque génération la mode
changeait dans nos campagnes.
Se tourner vers le passé est un choix parmi d’autres : le passéisme qui caractérise notre époque
est une réaction à un sentiment d’insécurité, c’est un refuge pour pallier au manque de réponses
sue les questions d’actualité, c’est une manière pour ne pas s’impliquer dans le présent,
exactement comme la passion pour l’exotique. Le passé devient un ailleurs.
Mais la question de l’identité valdôtaine aujourd’hui est là, sans réponse et les questions sans
réponse sont un stimulant quand on a l’outillage pour aller chercher les réponses, mais si on ne
dispose pas d’outils, c’est différent.
La représentation de la tradition qui a été enfantée ici comme ailleurs est certainement une
réaction à ces questionnements sans réponse. La culture valdôtaine a subi des attaques
prolongées et profondes, mais elle s’est doté aussi d’instruments pour se protéger : elle s’est

dite, décrite, codifiée pour RESISTER, mais résister ce n’est encore pas exister.
La vie n’est pas facile lorsqu’on devient un emblème. Vivre, c’est-à-dire changer, contient une
menace implicite, dans ce cas : ne va-t-on pas perdre le statut acquis ? Le vivre quotidien
s’accroche à l’emblématisation qui en a fait l’ethnographie, la tentation du musée est
omniprésente, la tradition devient dogme… Le discours identitaire ne prend plus son essor dans
l’entrelacs des pratiques et des savoirs, mais dans un espace imaginaire se rétractant toujours
plus de la réalité, toujours plus en contradiction avec celle-ci, engendrant une absence troublante
de systèmes référentiels crédibles.
Un nouvel élan dans les études ethnologiques est à préconiser, afin de jeter des ponts entre des
systèmes de représentations soumis à la cristallisation et le vécu quotidien.
Encore un exemple : la notion de surnaturel n’est pas universelle, elle s’est imposée dans la
civilisation occidentale en même temps que le concept de sciences naturelles. Au domaine de la
nature, observable par les méthodes scientifiques, s’opposerait celui de l’imaginaire, des mythes
et des superstitions. Depuis, l’Occident éprouve quelques difficultés à affronter la part
irrationnelle de l’homme. Il y arrive grâce à l’œuvre des artistes, à quelques philosophes, à la
psychanalyse et aux autres formes de rationalité proposées par l’anthropologie. Et nous, qui
avons une des ces formes différentes de rationalité, juste derrière nous, peut-être encore
partiellement chez nous, que voulons-nous en faire ? La regarder de haut en bas comme une
charmante tradition de famille, tout en croyant encore au mensonge de la supériorité de la
pensée rationnelle occidentale ? L’anthropologie n’est pas conciliable avec l’eurocentrisme.
« Dans l’anthropologie prérelativiste, les Occidentaux se représentaient comme supérieurs à
tous les autres peuples. Le relativisme a remplacé cette détestable barrière hiérarchique par un
aparatheid cognitif : si nous ne pouvons pas être supérieurs dans un même univers, que chaque
peuple vive dans son univers à soi. (…) Ils protègent ainsi le sentiment de leur propre identité »
(Dan Sperber, Le savoir des anthropologues, p.83)
Selon Sperber il y a deux types de croyances, à savoir les croyances factuelles et les croyances
représentationnelles. Ces deuxièmes, ce sont des croyances culturelles, « des représentations
acquises par le biais de la communication sociale et acceptées en fonction de l’affiliation
sociale » (p78). Le contenu des croyances apparemment irrationnelles est bien semi-
propositionnel. Dans certains ce sont bien les indigènes eux-mêmes qui le disent, plus souvent
le caractère semi-propositionnel est reconnu implicitement : « considérer que la bonne
interprétation des croyances est un secret perdu, un secret à découvrir, ou les deux à la fois, c’est
distinguer la croyance de son interprétation. » (p.79)

Anthropologie du langage
Le langage peut se lire et s’interpréter comme un fait social à part entière.
- Ce qu’on dit…
Un article paraît en 1903 « Les classifications primitives », signé Durkheim et Mauss, qui attire
l’attention sur les mises en ordre intellectuelles du monde.
Sous l’influence de la linguistique, on parlera bientôt de codifications symboliques : tous les
peuples classent les espèces (végétales et animales), les éléments et les substances de la nature, les
phénomènes climatiques, etc en différentes catégories.
L’hypothèse émise au cours des années 50 par Sapir et Whorf (qui étaient linguistes et
anthropologues) fait encore discuter de nos jours. Selon eux, il existe une relation nécessaire entre
les catégories et la structure du langage et la manière dont les humains appréhendent le monde.
Ainsi la langue des Indiens Hopi s’intéresserait au mouvement plutôt que, à l’image des principales
langues européennes, aux choses.
De nombreux autres chercheurs ont poursuivi dans cette direction.
- … et comment on le dit
Parler ou écrire ce n’est pas la même chose. Sauf exceptions, exceptions méritoires certes, mais ça
reste des exceptions, et récentes qui plus est, le francoprovençal est une langue orale, ce qui
n’empêche bien sûr pas d’en faire une langue écrite, mais cela est du ressort de la volonté des
locuteurs ou des politiques, moi, je me borne à analyser.
Parler, implique un interlocuteur qui écoute et qui est censé parler à son tour. Ecrire implique
l’espoir plus ou moins fondé qu’il y aura un lecteur, mais on ne peut pas savoir qui lit ni quand,
parce que dans l’écriture il y a une notion de durabilité qui n’existe pas dans le langage parlé (verba
volant…). Parler est lié à un contexte, l’écriture décontextualise : on écrit pour quelqu’un qui n’est
pas à côté de nous, qui ne voit pas ce que nous indiquons, qui a ou n’a pas nos mêmes systèmes de
références, nos mêmes systèmes de valeurs.
Donc, dans un échange en francoprovençal il se passe certainement quelque chose de différent que
ce qu’on pourrait enregistrer si la langue parlée était une autre. Les systèmes de références
changent, de même que les pratiques allusives, les jeux de mots…
Un village du pays d’oc, dans les Alpes maritimes : les bistrots étaient très vivants, il se pratiquait
un genre d’humour très typé, qui faisait partie de la convivialité de l’endroit, de la sociabilité
villageoise, une marque identitaire balayée du jour au lendemain avec l’occitan, parce que les
mêmes locuteurs en passant au français ne pouvaient pas reproduire les mêmes stratégies de
communication.
Dans la communication, en plus du message brut, il y a deux composantes présentes à chaque fois
dans un dosage différent : moi et l’autre. Le locuteur veut, bien sûr, faire passer un message
principal, mais il veut aussi exprimer une certaine idée de soi-même et de celui auquel le message
est adressé.
En parlant patois, étant donné sa richesse de variétés locales, on peut dire beaucoup plus sur soi-
même qu’en langue standard: voilà la plus grande richesse du patois, qui dévoile d’une manière
incroyablement profonde l’identité de celui qui s’exprime (je dirais même le « feuilletage

identitaire » du locuteur qui ne se contente pas de se dire «valdôtain », mais veut affirmer son
identité communale, parfois son identité villageoise). En choisissant une certaine variante locale
(communale, parfois, d’un village) on dit qui on est, d’où l’on vient, à quelle micro-communauté on
appartient, à quelle famille parfois. On peut aussi choisir une variante à l’intérieur d’une
communauté pour déclarer qu’on appartient à celle-ci ou bien pour être en syntonie avec celle-ci
tout en mettant en avant qu’on n’appartient pas à celle-ci. Ou bien on va utiliser une variante locale
pour s’approprier une identité locale qui pour n’être pas la nôtre a été quand-même privilégiée pour
une question affective ou d’opportunisme.
D’ailleurs peut-on simplement choisir une identité ou bien faut-il forcément être accepté par les
détenteurs de cette identité ? Qu’est-ce qui fait la légitimité d’un détenteur et la légitimité de son
jugement, de son ouverture à l’étranger ou de son refus ? Comment faut-il agir pour ne pas être un
usurpateur, dans une communauté tellement généreuse et pourtant devenue méfiante à force
d’usurpations, et à force de mépris ? Faut-il toujours attendre d’être coopté, quand on sait qu’on ne
le sera pas (simplement parce qu’on ne peut pas croire qu’on s’intéresse à tel point à cette culture ou
bien parce qu’on continue à percevoir une distance qu’on ne sait pas nommer, mais qui dérange,
offense ou nous met mal à l’aise) qu’on attend et qu’on désire au plus haut point qu’on vous ouvre
les bras et qu’on sera vraiment reconnaissant ?
Parfois, c’est l’interlocuteur qui est mis en avant dans les choix linguistiques : dans le but d’établir
une complicité plus forte, ou bien inversement dans le but de refuser une complicité naturelle, due
au partage d’un code linguistique ou de normes culturelles ou d’un sentiment d’appartenance
communautaire qu’on ne veut pas prendre en compte.
Parfois c’est le souci de se faire comprendre qui prime, alors on privilégie le message principal et la
possibilité de communiquer facilement au plus grand nombre, alors le locuteur peut gommer ces
micro-différences, ces informations sur le moi, au profit de formes plus générales, voire au profit de
la forme parlée par son interlocuteur, mais toujours selon ses compétences linguistiques, ses
expériences, sa sensibilité.
Ces différents états d’esprit, qui règlent la communication en francoprovençal, selon les locuteurs,
selon les circonstances, peuvent coexister et doivent être identifiés, reconnus et légitimés, car cette
gamme de choix, qu’il est toujours possible d’activer, représente un plus dans la communication à
l’échelle francoprovençale, en particulier à l’échelle valdôtaine où tous les parlers locaux sont
vivants où en se rencontrant dans le train ou à Aoste ou ailleurs on bavarde en tentant de deviner de
quelles communes est originaire notre interlocuteur.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%