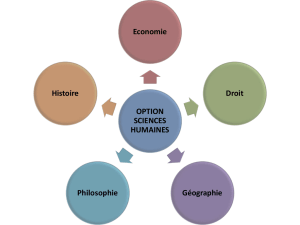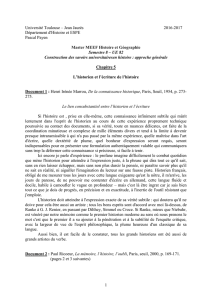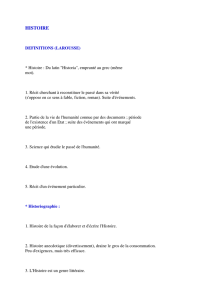Untitled


Du même auteur
AUX MÊMES ÉDITIONS
Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, 1948 et « Points Histoire », no 56 et 57, 1981.
Saint Augustin et l’augustinisme, 1955 et « Points Sagesses », no 179, 2003.
Les Troubadours, 1961 et « Points Histoire », no 5, 1971.
Théologie de l’histoire, 1968, Cerf, 2006.
Patristique et humanisme, 1976.
Décadence romaine ou Antiquité tardive ?, « Points Histoire », no 29, 1977.
L’Eglise de l’Antiquité tardive, « Points Histoire », no 81, 1985, 1996.
CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
Autour de la bibliothèque du pape Agapit, De Boccard, 1931.
La Vie intellectuelle au forum de Trajan et au forum d’Auguste, De Boccard, 1932.
La Collection Gaston de Vulpillières à El-Kantara, De Boccard, 1933.
Saint Augustin et la fin de la culture antique, suivi de « Retractatio », De Boccard, 1937, 1983.
Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Letouzey et Ané, 1939-1948, 1950-1953.
L’Ambivalence du temps de l’histoire chez Saint Augustin, J. Vrin, 1950.
A Diognète, Cerf, « Sources chrétiennes », 1952, 1997.
Les Fouilles du Vatican, Letouzey et Ané, 1953.
La Question algérienne, Minuit, 1958.
Le Pédagogue de Clément d’Alexandrie, Cerf, « Sources chrétiennes », 1960, 1965, 1970.
Recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule, antérieures à la Renaissance carolingienne, (direction), Ed. du CNRS, 1975,
1985.
Christiana Tempora, École française de Rome, 1978.
Crise de notre temps et réflexion chrétienne, Beauchesne, 1978.
Carnets posthumes, Cerf, 2006.

La présente édition est une version revue et augmentée
de la sixième édition de l’ouvrage publié
sous le même titre aux Éditions du Seuil,
dans la collection « Esprit »
ISBN 978-2-02-122848-9
© ÉDITIONS DU sEUIL, 1954
Cet ouvrage a été numérisé en partenariat avec le Centre National du Livre.
Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.

A Jean Laloy
pour commémorer vingt-cinq ans d’amitié
οὐ γὰρ δοϰεῖν ἄριστος, άλλ’ εἶναι θέλει
ESCHYLE, Sept contre Thèbes, 592.

T
Couverture
Du même auteur
Copyright
Dédicace
Introduction – La philosophie critique de l’histoire
1 - L’histoire comme connaissance
2 - L’histoire est inséparable de l’historien
3 - L’histoire se fait avec des documents
4 - Conditions et moyens de la compréhension
5 - Du document au passé
6 - L’usage du concept
7 - L’explication et ses limites
8 - L’existentiel en histoire
9 - La vérité de l’histoire
10 - L’utilité de l’histoire
Conclusion – L’œuvre historique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%