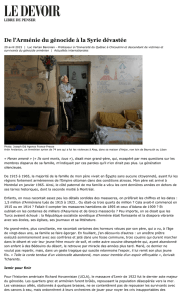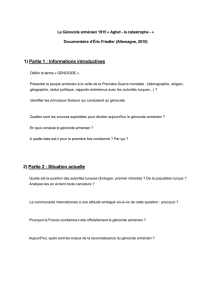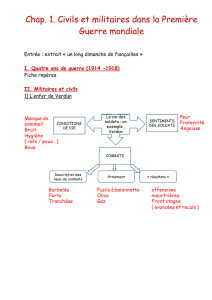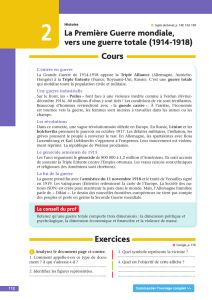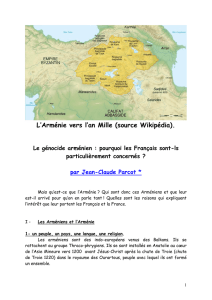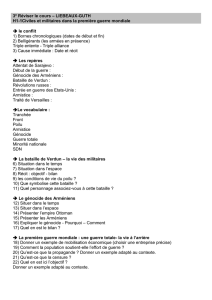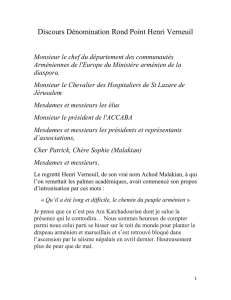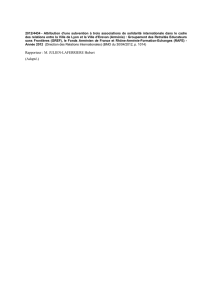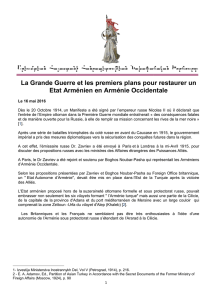Télécharger le texte en pdf - Centre d`histoire sociale du XXème siècle

Mémoire du génocide et
politique en République
d’Arménie
Par Claire Mouradian
De l’hommage aux morts à la
commémoration ritualisée de la « Grande
Catastrophe
Les Arméniens de l’Empire russe, observateurs
« privilégiés » du génocide
Dès décembre 1914, et surtout à partir du printemps de 1915,
face à l’afux au Caucase de quelques 300 000 réfugiés des
provinces arméniennes de l’Empire ottoman frontalières,
les dirigeants politiques et la population de l’Arménie russe,
base territoriale de l’Etat actuel, sont très tôt informés des
déportations et des massacres et se mobilisent massivement
pour venir en aide aux rescapés. Des comités de secours se
constituent à Erévan et surtout dans les centres urbains de
l’Empire russe où sont regroupées les couches aisées et les élites
intellectuelles et politiques : Tiis, Bakou, Nor Nakhitchevan
près de Rostov-sur-le-Don, Moscou, Saint- Petersbourg.
Le 24 mai 1915, par une déclaration commune solennelle, la
Russie tsariste s’est d’ailleurs associée à ses alliés de l’Entente, la
France et la Grande-Bretagne, pour faire «savoir publiquement à
la Sublime Porte qu’ils tiendront personnellement responsables les
membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents
qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres», des
massacres déjà désignés comme des «crimes contre l’humanité
et la civilisation» ou des «crimes de lèse-humanité». Cette même
année, une médaille commémorative, sans doute la première du
genre, est frappée en Russie. Elle porte l’inscription : «Russes
et Arméniens unis dans l’épreuve». Le produit de sa vente est
destiné à aider les réfugiés dont on fait connaître le sort au cours
de conférences et de soirées dans les centres communautaires.
On y projette des reportages de guerre russes sur le front du
Caucase. Certaines de leurs images seront reprises, dès 1915, dans
des premiers lms documentaires ou de ction comme Ariounod
Arevelk (Orient sanglant) de A. Arkadov (Moscou) et Krderi ltzi
dak (sous le joug des Kurdes) de A. Minervine (Ekaterinodar).
Ce n’est cependant qu’en 1916, avec l’avance de l’armée russe
en Anatolie orientale, à travers villes et villages dévastés et
déserts, que les Arméniens du Caucase prennent réellement la
mesure de l’ampleur de la catastrophe, également conrmée
par les premiers témoignages publiés en Occident dès 1915. En
1919, la traduction russe du témoignage de H. Barby est publiée
à Tiis, tandis que paraissent à Constantinople des traductions
arméniennes de Morgenthau, Lepsius, Bryce, Pinon. La perception
des événements se fait néanmoins au travers du prisme de la
guerre, premier conit mondial où l’hécatombe a atteint un

degré sans précédent sur tous les fronts. On espère que la paix
signiera un retour à la «normale» et le retour des réfugiés dans
leurs foyers. C’est l’un des thèmes à l’ordre du jour de l’Assemblée
arménienne qui réunit à Petrograd, en mai 1916, les organisations
nationales de l’Empire russe. L’éclatement de l’empire tsariste
consécutif aux défaites et révolutions de 1917 plonge bientôt les
Arméniens orientaux, comme l’ensemble du Caucase dans une
autre tourmente. L’offensive de l’armée ottomane protant du
vide laissé par le départ des troupes russes pour marcher sur
Bakou, à travers le Nakhitchevan, le Zanguezour, le nord de l’Iran
et le Karabagh, prolonge les massacres d’Anatolie et démontre la
volonté d’anéantissement de l’ensemble des Arméniens au-delà
des frontières de l’Empire ottoman. Dans la région de Erévan,
le sursaut de résistance d’une population consciente du sort
qui l’attend en cas de victoire turque, pour avoir été confrontée
aux ux de réfugiés depuis le printemps 1915, permettra la
naissance de l’Etat arménien. Entre le 21 et le 25 mai 1918, les
Turcs sont ainsi repoussés aux portes de Erévan par les forces
nationales, constituées par les soldats arméniens de l’ancienne
armée tsariste et les légions de volontaires, soutenues par une
levée en masse, lors de batailles désespérées aux portes de
Erévan. L’éphémère tentative de Fédération transcaucasienne
ne résiste pas à la poussée turque et aux intérêts divergents de
ses composantes arménienne, géorgienne et azérie. Et après les
proclamations unilatérales d’indépendance par la Géorgie, forte
de la protection allemande (26 mai), suivie par l’Azerbaïdjan, les
représentants arméniens se résignent, à leur tour, à proclamer
l’indépendance le 28 mai. Une indépendance qui n’avait pas
été envisagée pour l’ancien gouvernorat tsariste de Erévan,
province arriérée et à la population mixte, mais devenue
nécessaire pour conclure la paix avec la Turquie, et nalement
assumée comme une nécessité historique pour réaliser le projet
historique de rassemblement des terres et des hommes.
Un héritage douloureux pour un Etat nouveau-né
Comme pour les Juifs, le génocide, même si on ne le nomme
pas encore ainsi, est un des éléments constitutifs de l’identité
nationale des Arméniens à l’époque contemporaine. Cependant,
à la différence des Juifs, il ne constitue pas un des arguments de
légitimation de la création ou de la renaissance d’un Etat national,
un lieu où il existerait la possibilité de vivre normalement, sans
discrimination et en sécurité, un lieu qui permettrait le retour
et la n de la diaspora, conçue comme une situation «hors
norme», sinon «dangereuse». Pour les Arméniens, le génocide
symbolise l’échec du projet national d’émancipation, plus
fédéraliste qu’indépendantiste à l’origine, un projet prônant une
plus grande autonomie locale et des réformes en vue d’établir
l’égalité des droits et la sécurité des personnes et des biens
dans un cadre impérial rénové, respectueux des minorités. Le
génocide signie la disparition des terres ancestrales, du cœur
de la «vraie» patrie située dans l’Empire ottoman, là où devait
s’incarner ce projet. La république créée autour de Erévan,
dans une province périphérique du Yerkir (pays), ne s’imposera
pas d’emblée comme République d’Arménie : elle est désignée
à ses débuts comme «République araratienne» ou «République
de Erévan», ne recouvrant qu’une partie du projet d’»Arménie
intégrale» présenté à la Conférence de la Paix de Paris, devant
laquelle se présentent deux délégations, celle de la République
et des Arméniens de Russie, menée par Avétis Aharonian, et

celle des Arméniens de Turquie, dirigée par Boghos Noubar
Pacha. A l’inverse des Juifs, le génocide constitue l’acte fondateur
non de l’Etat, mais de la diaspora, quand la nouvelle entité
politique créée autour de Erévan ne réussira ni à sauvegarder
sa souveraineté, ni à inclure dans ses frontières les vilayets
d’Anatolie orientale attribués par le traité de Sèvres (10 août
1920), ni à obtenir le retour des réfugiés dans leurs foyers.
D’où la difculté originelle de l’Etat arménien à assumer l’héritage
du génocide, sauf à héroïser le martyr et à revendiquer des
réparations pour effacer l’injustice. Ce sera le cas dès le premier
anniversaire de la proclamation de l’indépendance, le 28 mai
1919. Le souvenir des victimes, s’il est évoqué, est mis au second
plan par l’Acte d’Union des deux Arménies, une décision prise en
réponse au IIe Congrès des Arméniens occidentaux de février 1919
qui exigeait le jugement en cour martiale des auteurs des crimes
contre les Arméniens - Guillaume II, principaux dirigeants Jeunes-
Turcs, Enver, Talaat, Djemal, Nazim, Behaeddin Shakir, ainsi que
les gouverneurs et responsables administratifs - et demandait
l’indemnisation des victimes ainsi que le retour dans leurs foyers.
La naissance du «24 avril» dans les capitales des pays
coupables : Constantinople et Berlin
Ce n’est donc pas à Erévan, la capitale de l’Etat Arménien,
mais à Constantinople, sur le lieu même des événements - la
rae des notables arméniens de la capitale ottomane qui, en
décapitant la nation, donne le coup d’envoi de l’extermination -
qu’a lieu la première commémoration du 24 avril (11 avril selon
l’ancien calendrier). Dans la ville occupée par les Alliés depuis
l’armistice de Moudros (30 octobre 1918), tandis que s’organise
le procès des criminels de guerre Jeunes Turcs, le 12 avril 1919,
une cérémonie laïque et religieuse en hommage aux grandes
gures nationales disparues est organisée par un «Comité du
souvenir du 11 (24 avril)». Evocation des disparus, lecture de
poèmes, discours politiques et partie artistique alternent au
cours de la cérémonie où l’on annonce aussi le projet de création
d’un fonds d’aide aux familles des victimes. Pour l’occasion, un
premier ouvrage mémorial a aussi été préparé par l’auteur de
célèbres almanachs, Théodik. Des extraits en ont régulièrement
été publiés dans la presse diasporique. Les rééditions en fac
similé de 1985 et 1990 à Erevan, précédées d’une introduction
de l’historien Galouste Galoyan, constituent en elles mêmes
une étape dans la «récupération» de la mémoire à l’époque
soviétique. Il comprend des biographies et des photographies
des grandes gures déportées, des témoignages, un article
d’Aram Andonian, lui-même rescapé de la déportation. Jusqu’au
tournant du cinquantenaire en 1965 quand commencent les
manifestations de rue, la commémoration du 24 avril 1919 de
Constantinople servira de modèle au rituel du souvenir. A la
même époque, une autre commémoration a lieu dans la capitale
de l’ancien allié vaincu de l’Empire ottoman, à Berlin, où la
toute jeune République de Weimar essaie de se démarquer de la
politique du Reich et du Kaiser déchu. Le 14 mai, dans la grande
église catholique Ste Edwige, une messe de requiem, chantée
par la chorale de l’opéra de Berlin-Charlottenburg, est célébrée,
en présence de députés du Reichstag, du corps diplomatique, de
membres du clergé, d’intellectuels, de la presse. Auparavant, la
communauté arménienne de Berlin, qui avait été l’un des grands

lieux de formation des intellectuels avant 1914, avait organisé, le
20 mars, une soirée d’hommage dans la salle du théâtre Urania,
en présence du Professeur et arménologue Marquart. Armin
Wegner, ancien ofcier du Corps sanitaire allemand dans l’Empire
ottoman et, à ce titre, témoin oculaire des événements dont il
vient de publier le récit, y présente une conférence, «la tragédie
du peuple arménien dans les déserts de Mésopotamie», illustrée
par ses photographies personnelles qui constituent, à ce jour,
la principale documentation iconographique sur le génocide.
La soirée sera perturbée par une centaine d’étudiants turcs
dont le ls de l’ambassadeur ottoman, et leurs amis allemands.
Une bagarre s’ensuit provoquant l’intervention de la police.
Le long «oubli» de Erévan
La première cérémonie du souvenir ofcielle dans l’Etat arménien
ne semble avoir été organisée que l’année suivante, en avril
1920, sous la forme d’une messe de requiem spéciale, célébrée
par le catholicos Kévork V Souréniantz dans la cathédrale
d’Etchmiadzine, en présence de représentants des autres cultes
- catholique et protestant. Le catholicos annonce sa décision
de faire du 11/24 avril une «journée nationale du souvenir des
victimes de la Première guerre mondiale», «fête» religieuse à
introduire dans le calendrier liturgique dès l’année suivante.
Mais un an plus tard, en avril 1921, la République d’Arménie,
prise en tenaille entre la Russie bolchevique et la Turquie
kémaliste a été soviétisée (2 décembre 1920), retombant dans
l’orbite russe. Le traumatisme du génocide n’a pas été pour
rien dans la résignation à la perte de l’indépendance : «Mieux
vaut les Russes que les Turcs» sera le principal argument de
légitimation du régime soviétique en Arménie. Pour la nouvelle
Russie bolchévique et «internationaliste», l’»axe Ankara-Moscou»
devient le fondement des nouvelles relations entre les deux
pays «ennemis historiques» (treize guerres en deux siècles).
C’est l’alliance des Etats successeurs des défunts empires
tsariste et ottoman, unis par la défaite dans une commune
détermination à consolider leur nouveau régime respectif et
à s’afrmer comme puissances régionales face à l’Entente
franco-britannique victorieuse. S’il n’est pas exempt d’arrière-
pensée de part et d’autre, le traité d’Amitié soviéto-turc de
Moscou (16 mars 1921) scelle l’entente en xant les frontières
de Transcaucasie par dessus la tête des trois républiques
concernées, dont l’Arménie qui en est la grande perdante.
Dès lors, et jusqu’au cinquantenaire, le 24 avril ne sera plus
commémoré que dans l’émigration, non sans dissensions. Certes,
en diaspora, les tensions entre partisans et opposants du régime
soviétique se manifestent surtout autour des commémorations
à connotation directement politiques, comme l’anniversaire de
l’indépendance (28 mai 1918) ou celui de l’insurrection populaire
contre les bolchéviks du 18 février 1921, célébrés par le parti
Dachnaktsoutioun, tandis que la déclaration de soviétisation
(29 novembre 1920) est fêtée par les courants communistes et
les divers «compagnons de route». La journée du souvenir du
24 avril devient aussi l’enjeu de ces luttes au caractère parfois
extrême, suivant en cela les tensions provoquées par la volonté
de l’URSS d’une contagion révolutionnaire. En 1933, l’évêque
de New York, Mgr Levon Dourian, est assassiné en pleine messe
de Noël. Cette même année où les Etats-Unis avaient ni par
reconnaître l’URSS, la querelle autour du maintien du drapeau

tricolore de la république indépendante comme emblème national
s’était exacerbée et Mgr Dourian, primat d’un diocèse contrôlé
par le pouvoir soviétique par l’intermédiaire d’Etchmiadzine,
avait refusé de participer à une soirée organisée par l’Association
des amis des écrivains disparus le 24 avril, au prétexte que
le tricolore y était déployé. En France, autre grand terrain
d’affrontements entre pro- et anti-soviétiques, lieu de refuge
du gouvernement en exil de la République indépendante, on a
aussi des exemples des combats autour de cette commémoration.
Ainsi Missak Manouchian, lui-même orphelin de 1915, peut-
il écrire que cette cérémonie est un «attirail du bazar
nationaliste des dachnaks» qui «attise les haines raciales».
Il faudra attendre 1965 et le dégel post-stalinien, pour qu’à
l’occasion du cinquantenaire, le 24 avril devienne une journée
du souvenir autorisée, commémorée en général dans l’unité,
en diaspora comme dans la RSS d’Arménie. Pour la première
fois depuis la soviétisation, une messe est alors célébrée à
Etchmiadzine, tandis que les autorités organisent une cérémonie
à l’Opéra de Erévan, en présence des dignitaires du régime et
de personnalités de la diaspora. Pour la première fois aussi, une
énorme manifestation politique de 100 000 à 200 000 personnes
déferle dans les rues de Erévan aux cris de «justice» et «nos
terres», débordant le cadre feutré de la commémoration ofcielle.
Une manifestation plus modeste, mais fortement symbolique, se
déroule en même temps à Moscou devant l’ambassade turque.
Dans les mois qui suivent, la direction du parti est purgée
avec une mise en accusation en règle des «survivances du
nationalisme bourgeois». Néanmoins, la manifestation de rue à
l’occasion du 24 avril fera partie du nouveau rituel commémoratif
en Arménie, comme en diaspora, où jusque-là, la célébration
de cette journée du souvenir ne sortait pas des salles.
Ce n’est cependant que le 22 novembre 1988, dans le contexte
de la montée du mouvement démocratique et national que
le Soviet Suprême de la RSS d’Arménie fera du 24 avril une
journée nationale fériée du souvenir des victimes du génocide
des Arméniens. A l’automne 1990, alors que l’Arménie s’était
engagée dans le processus d’accès à l’indépendance par la voie
légale, Levon Ter Pétrossian, président du Parlement issu des
premières élections relativement libres, déclarait en privé que
ce vote constituait à ses yeux une des grandes victoires du
Comité Karabagh. C’était la première fois où, sous la pression
populaire, le Soviet suprême républicain sortait de son rôle de
chambre d’enregistrement des décisions du pouvoir central.
La création de lieux de mémoire
Au delà d’une date anniversaire symbolique, la mémoire
institutionnelle a besoin de lieux et de monuments pour s’incarner.
Dans ce domaine, on peut également constater le «retard» de
l’Etat arménien sur la diaspora. C’est en effet à Antelias, près de
Beyrouth, au siège du catholicossat arménien de Cilicie qu’est
érigé, dans les années 1950, le premier monument mémorial : une
chapelle votive où sont déposés des ossements recueillis dans le
désert de Deir-ez Zor. Le second monument du souvenir est érigé
en 1960, toujours au Liban, dans la cour du patriarcat catholique
arménien de Bzommar. C’est le début d’une longue série dont le
tableau permet de mesurer le dynamisme et le pouvoir d’inuence
des diverses communautés. La construction de ces monuments
 6
6
1
/
6
100%