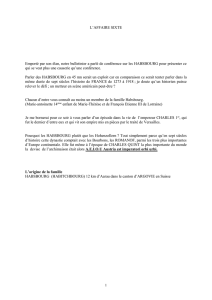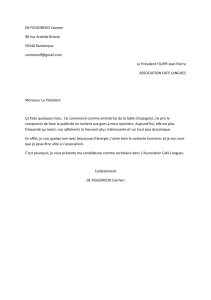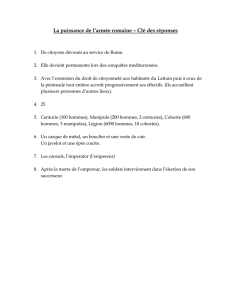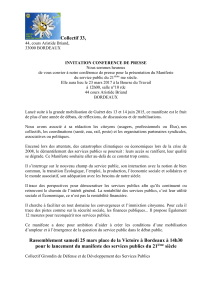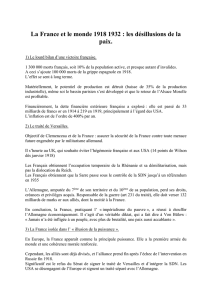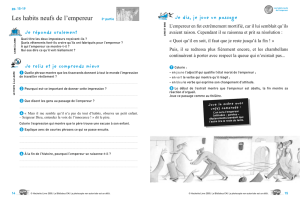l`alsace-lorraine enjeu de deux tentatives de paix avortées

L'ALSACE-LORRAINE
ENJEU DE DEUX TENTATIVES DE PAIX AVORTÉES
par M. René HOMBOURGER
I
La mission de Sixte de Bourbon auprès de l'Empereur d'Autriche
Au début du mois de juillet 1917, le Kronprinz, depuis son quartier
général de Charleville, adressait à son père, une lettre qui sera connue en
France en 1920, grâce à sa publication par le quotidien «Le Matin».
Après avoir dépeint le déplorable état d'esprit du peuple allemand, la
misère qui s'amplifie, le désespoir qui se manifeste ouvertement, la morta-
lité infantile croissante, le peu d'espoir que laisse la guerre sous-marine, le
Kronprinz affirmait que «si l'Allemagne n'obtient pas la paix avant la fin
de Tannée - 1917 - le danger d'une révolution sera imminent».
Et il ajoutait que l'Autriche se trouvait dans la même situation.
«L'Empereur Charles, écrivait-il, est certainement un de nos fidèles
amis,
mais s'il lui faut choisir entre la ruine complète de l'Autriche et un
moyen de la sauver, en nous abandonnant, son devoir envers ses peuples lui
commande de se séparer de nous.»
Après l'assassinat à Sarajevo, en 1914, de l'héritier présomptif du
trône d'Autriche-Hongrie, après la mort de l'Empereur François Joseph en
1916,
l'archiduc Charles, petit-fils du frère de ce dernier, avait vu retomber
sur ses jeunes épaules les écrasantes responsabilités du pouvoir.
Or, le nouvel empereur n'avait qu'une ambition, dégager son peuple
de l'effroyable bourbier de la guerre dans lequel il s'enlisait.
«Lorsque l'archiduc Charles devint empereur», a pu affirmer l'un de
ses intimes, le comte Poltzer-Hoditz (1), «son premier et plus pressant
souci fut de mettre rapidement un terme à la guerre. Il n'avait aucune res-
ponsabilité dans les événements qui l'avaient déchaînée. Il ne pouvait voir
dans sa continuation aucun avantage pour les peuples qu'il gouvernait; de
sorte qu'il considéra comme une question de conscience de ne pas laisser
(1) Comte Poltzer-Hoditz, L'Empereur Charles et la mission historique de l'Autriche.
84

ENJEU DE DEUX TENTATIVES DE PAIX AVORTÉES
supporter plus longtemps les sacrifices affreux que la guerre imposait. Il
voulait mettre fin à l'effusion de sang. Chacun de ses actes, durant son
règne éphémère s'inspira de cette pensée; elle est la clé de toutes ses déci-
sions.»
«Je veux, avait-il proclamé dans son premier message, rendre à mes
peuples les bienfaits de la paix et tout faire pour bannir dans le plus bref
délai les horreurs et les sacrifices de la guerre.»
En 1911, l'archiduc Charles avait épousé une princesse de Parme,
Zita de Bourbon, descendante de Henri IV, de Louis XIV et du petit-fils de
ce dernier, Philippe, duc d'Anjou, lui-même fils du Grand Dauphin,
devenu roi d'Espagne en 1701.
L'impératrice Zita avait deux frères, Sixte et Xavier cousins comme
elle-même, du souverain espagnol et de la reine Elisabeth de Belgique.
Lorsqu'éclata la guerre en 1914, Sixte et Xavier avaient eu pour uni-
que pensée : servir leur patrie.
Mais comme ils appartenaient à la Maison de France, l'armée fran-
çaise leur était interdite. Aussi revêtirent-ils l'uniforme de l'armée belge
dans laquelle ils servirent d'ailleurs avec bravoure.
Dès 1914, le prince Sixte avait tenté des démarches auprès de sa sœur,
en vue d'amener l'Autriche à se détacher de l'Allemagne. L'impératrice lui
répondit alors que l'heure n'était pas encore venue pour l'archiduc Char-
les,
d'intervenir.
En 1915, Sixte faisait remettre au Vatican une note, par laquelle il
priait le Souverain Pontife de s'entremettre auprès de l'Autriche en faveur
d'une paix séparée.
Victorieuse ou vaincue, tel est son avis, la Monarchie austro-
hongroise deviendrait une vassale de la Prusse.
Au mois de mars de la même année, Sixte était reçu par Benoît XV,
qui consentit à seconder les efforts du prince.
Au mois de janvier 1916, deux amis «sûrs» de Sixte et de son frère,
rencontrent M. William Martin, chef du protocole du quai d'Orsay, et lui
suggèrent la possibilité pour la France d'entrer en rapport avec la Cour
d'Autriche par l'intermédiaire des deux princes si les intérêts du pays
venaient à l'exiger.
Le 21 mai 1916, Poincaré, tenu informé de cette démarche, profite
85

L 'ALSACE-LORRAINE
d'un séjour sur le front pour remettre la croix de guerre à Sixte et à Xavier,
en même temps qu'à la reine des Belges. Ce sera, ainsi que l'écrira le prince
français sous l'uniforme belge, «une journée unique dans les fastes de
notre Maison».
Le 24 août Sixte et Xavier sont reçus par Poincaré à l'Elysée; le 26
octobre Sixte rencontre le Président du Conseil, Aristide Briand.
A peine l'archiduc Charles était-il monté sur le trône austro-hongrois
que sa belle-mère, la duchesse de Parme, informait ses deux fils, Sixte et
Xavier, qu'elle souhaitait les rencontrer en Suisse.
Autorisés par le roi des Belges, les deux frères se rendent à Paris, puis
munis de passeports diplomatiques français, à Neuchâtel en Suisse où la
duchesse leur remet une lettre autographe de l'impératrice Zita. Celle-ci
demande instamment à Sixte et Xavier leur aide en vue de concrétiser le
désir de paix de l'Empereur.
S'ils
ne peuvent aller à Vienne, leur écrit-elle, Charles leur enverra
une personne de confiance en Suisse.
Au cours de son entrevue avec sa mère, Sixte lui avait remis un aide-
mémoire, précisant que pour lui «toutes les conditions préparatoires à la
paix pour l'Entente doivent comporter les sacrifices nécessaires, entre
autres :
1.) La restitution de l'Alsace-Lorraine à la France sans aucune compensa-
tion de sa part;
2.) Le rétablissement de la Belgique».
Rentrés à Paris les deux frères rencontrent M. William Martin ainsi
que M. Jules Cambon, alors secrétaire général du Quai d'Orsay.
«Si l'Autriche, affirme ce dernier, est toujours dans les intentions, il
faut qu'elle fasse vite et qu'elle accepte trois conditions essentielles :
PAlsace-Lorraine intégrale à la France, sans aucune compensation colo-
niale pour l'Allemagne - les promesses faites par la France à l'Italie doivent
être honorées.»
L'empereur d'Autriche avait exprimé le souhait de n'avoir pour
interlocuteur que le Président de la République.
Mis au courant, Poincaré suggéra que les deux princes reprissent le
chemin de la Suisse en vue de poursuivre les pourparlers.
Ils se conformèrent à ce désir et rencontrèrent à Neuchâtel un envoyé
spécial de l'Empereur, le comte Thomas Erdôdy.
86

ENJEU DE DEUX TENTATIVES DE PAIX AVORTÉES
«La mission de celui-ci, écrit Albert Chatelle (2), était de déclarer
secrètement que l'Empereur est favorable au retour à la France de l'Alsace-
Lorraine avec ses frontières d'avant 1814, c'est-à-dire avec la Sarre, Sarre-
louis,
Landau etc. à la pleine restauration de la Belgique y compris le
Congo, avec le libre accès en toute souveraineté d'Anvers par la voie flu-
viale, si la Hollande y consent.»
Suivaient quelques considérations relatives aux problèmes italien,
roumain et serbe.
Ayant pris connaissance de cette déclaration, le prince Sixte demande
à l'envoyé de l'Empereur de retourner à Vienne et d'en rapporter une note
fixant les conditions dans lesquelles une action diplomatique pourrait
s'engager.
Rendu à Vienne le 15 février, Erdôdy est reçu par l'Empereur dès le
lendemain au cours d'une audience à laquelle assiste également le ministre
des Affaires étrangères autrichien, le comte Ottokar Czernin.
Descendant d'une ancienne lignée tchèque, marié à une fille du prince
Kinsky, Czernin avait vu s'ouvrir devant lui une brillante carrière diploma-
tique.
Il y était entré à 25 ans par favoritisme sans avoir suivi les examens
réglementaires.
Nommé en 1913 ambassadeur à Bucarest, il sera choisi trois ans plus
tard par l'Empereur pour être son ministre des Affaires étrangères.
Or, ce ministre «manquait totalement d'expérience politique. Ses
armes préférées étaient la négation et la critique» (3).
Avant l'audience en question, Czernin savait, mais sans plus, que son
souverain avait trouvé une voie conduisant à des négociations avec la
France. C'est seulement au cours de l'entretien qu'il sera informé du rôle
dévolu au prince Sixte de Bourbon. Il se déclara favorable aux négociations
et attacha la plus grande importance à ce que Sixte se rendît directement à
Vienne. A cet effet, il remit à Erdôdy, une note relative à la poursuite des
pourparlers.
Il commença par y déclarer que l'alliance entre l'Autriche-Hongrie,
l'Allemagne, la Turquie et la Bulgarie est absolument indissoluble et
qu'une paix séparée d'un de ces Etats est pour toujours exclue.
(2) Albert Chatelle, La paix manquée.
(3) Poltzer-Hoditz, ouvrage cité.
87

L'ALSACE-LORRAINE
Il précisa que si l'Allemagne voulait renoncer à l'Alsace-Lorraine,
l'Autriche-Hongrie n'y formerait naturellement pas d'obstacle, de même,
il estimait que la Belgique devait être rétablie et dédommagée par tous les
belligérants.
Suivait une affirmation qui pèsera lourd du côté français dans les
pourparlers de paix futurs : «C'est une grande erreur, écrivait-il, de croire
que l'Autriche-Hongrie se trouve sous la tutelle politique de l'Allemagne.
Par contre, en Autriche-Hongrie, l'opinion est répandue que la France agit
complètement sous la pression de l'Angleterre».
De sa main, l'Empereur ajoutait au document de Czernin une note
secrète par laquelle il affirmait : «Nous aiderons la France et par tous les
moyens nous exercerons une pression sur l'Allemagne.
"Nous avons les plus grandes sympathies pour la Belgique et nous
savons qu'elle a éprouvé une injustice. L'Entente et nous, nous réparerons
ses grandes pertes.
"Nous ne sommes absolument pas sous la main allemande : c'est
ainsi que, contre la volonté de l'Allemagne, nous n'avons pas rompu avec
l'Amérique».
En outre l'Empereur croit pouvoir affirmer à son tour qu'en Autri-
che «on pense que la France est tout à fait sous l'influence anglaise».
Muni de la note secrète de Charles et du document dicté par le minis-
tre,
le comte Erdôdy retrouve en Suisse le prince Sixte. Celui-ci en prend
connaissance et brûle la note secrète ainsi que l'a d'ailleurs souhaité l'émis-
saire autrichien.
Le prince Sixte reconstituera ce texte de mémoire, à la demande qui
lui sera faite, pour éviter que la note de Czernin seule subsistante n'empê-
che la poursuite des négociations.
A présent la balle se trouve dans le camp de la diplomatie française.
Des conversations vont s'engager entre le prince et les autorités au plus
haut niveau : Président de la République et Président du Conseil. Aux yeux
de Poincaré, la note du comte Czernin est «tout à fait insuffisante et
impossible à montrer aux alliés», en revanche la note secrète donne une
base possible. «Je communiquerai ces textes au Président du Conseil en lui
faisant promettre le secret absolu» devait déclarer Poincaré.
A la suite de quoi Sixte rédige une lettre par laquelle il priait son
beau-frère d'accepter sans ambiguïté les quatre points déjà évoqués qui
constituent les conditions sine qua non à l'égard de l'Autriche.
88
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%