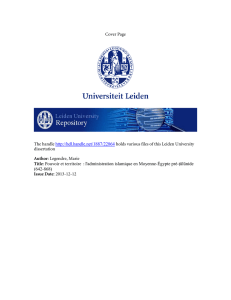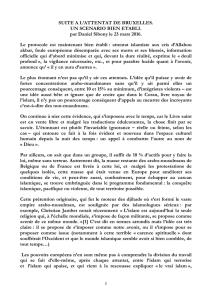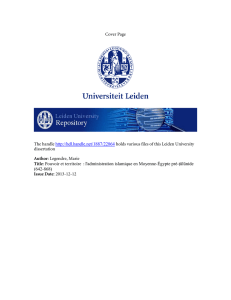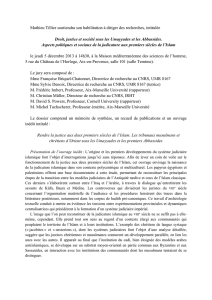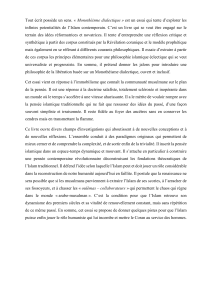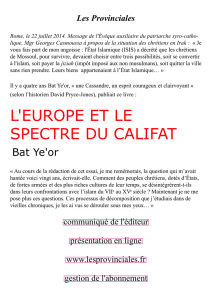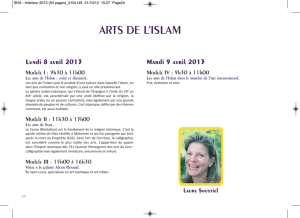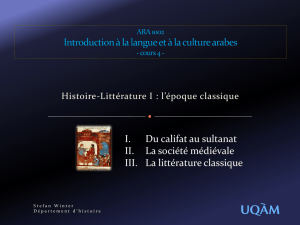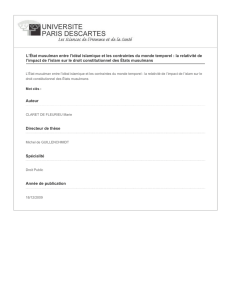Une histoire provinciale ou une histoire impériale pour la campagne

Conclusion
Une histoire provinciale ou une histoire impériale pour la
campagne égyptienne des premiers siècles de l’Islam ?
Au-delà du silence des sources narratives sur la campagne égyptienne, la Moyenne-
Égypte des deux premiers siècles de l’Islam apparaît, au terme de cette étude, comme une
région à part entière de l’Égypte islamique. Si son intégration à la province de Miṣr ne faisait
pas de doute, elle restait perçue avec beaucoup de distance. Les détails du développement de
sa géographie politique, de son administration et des populations qui la représentent suivent le
rythme des deux premières dynasties musulmanes et contribuent directement à notre
connaissance de la formation de leur autorité au niveau local. Les vestiges de terrain et les
dynamiques d’occupation, la géographie administrative et les informations données par les
papyrus, et enfin les représentations littéraires présentent chacun une histoire de cette région
selon des temporalités différentes que nous avons proposé d’accorder dans les quatre
chapitres qui ont composé cette étude. Cette investigation a permis de dresser l’histoire de la
région entre Byzance et l’Islam suivant son évolution entre la géographie administrative
byzantine et l’image construite dans les sources littéraires arabes qui dominent les deux
extrémités de notre chronologie. Cette étude montre, au cours de notre chronologie
d’investigation, l’intégration aussi bien administrative que symbolique de la région dans
l’Égypte des premiers siècles de l’Islam.
Une chronologie de la conquête de la région en amont de l’année 642 a tout d’abord
été proposée. La chronique de Jean de Nikiou indique que la conquête aurait débuté par
l’Arcadie, plus que par Babylone qui est la version prônée par les sources islamiques. Les
sources littéraires, quelles qu’elles soient, indiquent que les armées arabes se seraient tournées
vers la vallée dès 641. Les documents confirmant la présence des amīrs dès le premier mois
de l’année 642.

Conclusion
278
Les modalités de passation de pouvoir au niveau local nous sont ensuite connues avec
beaucoup de détails, grâce aux archives des administrateurs de l’Hermopolite dans les années
640. Elles révèlent leur intérêt immédiat pour la mise en valeur des territoires conquis. La
présence d’amīrs et de leurs garnisons au niveau local permet d’assurer auprès de
l’administration locale, le pagarque d’Hermopolis et le duc d’Antinoé, la mise en œuvre de
larges réquisitions nécessaires à leur installation dans la province, notamment pour la
construction de leur capitale et la subsistance de leurs armées. La documentation de cette
période permet de mettre en évidence des modalités de coopération entre conquérants et
conquis qui se retrouvent des siècles plus tard dans la tradition islamique. Le texte connu sous
le nom de « pacte de ‘Umar » d’après le nom du calife ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (717-720) en
est un exemple. Les documents des archives de Sénouthios montrent que l’administration
locale affectait des individus portant le titre de boukkelarios à certains moagaritai afin de les
mener en différents endroits de la pagarchie hermopolite pour assurer la gestion de leurs
réquisitions
1
. Le rayonnement des conquérants dans la région avec l’aide de l’administration
locale devait bien avoir permis à ces moagaritai ou sarakenoi de se familiariser avec le
territoire conquis, ses routes, ses toponymes et sa population. Une image similaire est donnée
dans le pacte de ‘Umar qui liste un certain nombre de règles que les populations chrétiennes
de Syrie auraient dû suivre pour assurer le bon déroulement de leurs relations avec les
communautés musulmanes. Un des préceptes de ce texte se présente comme un écho
intéressant des informations données par les papyrus dans les années 640 quand il indique que
les conquis avaient à charge de renseigner les musulmans sur les ponts et les routes de leur
région
2
.
Au cours des décennies incertaines entre la conquête et la fin de la première guerre
civile (655-661), nous avons ensuite mis en évidence la mise en place d’une supervision des
régions rurales de la province depuis la nouvelle capitale. Dès la période de la conquête, il y
avait un centre politique en Égypte où les nouveaux conquérants étaient implantés, identifié
comme Babylone dans les papyrus grecs, puis comme Fusṭāṭ ou fossaton à partir du début de
l’époque umayyade
3
. Jusqu’au début de la période marwānide, l’administration médinoise
puis umayyade, se repose, pour un temps, sur les anciens gouverneurs de provinces
1
Document inédit décrit dans : MORELLI (Federico), L’archivio di Senouthios anystes e testi connessi : Lettere
e documenti per la costruzione di una capitale, CPR XXX, Vienne, 2010, p. 14.
2
COHEN (Mark R.), « What was the Pact of `Umar? A Literary-Historical Study”, JSAI 29 (1999), p. 100-157.
3
P.Apoll. 6, 3 (Edfou, fin du 3e et du début du dernier quart du VIIe siècle).

Conclusion
279
byzantines, les ducs. Leurs administrations, mais aussi la carte administrative de l’Égypte sont
refondues au rythme d’un système qui s’inspire de l’ordre local comme des initiatives des
nouveaux maîtres du pays.
L’administration de la Moyenne-Égypte prend effectivement une forme nouvelle, à
partir du règne de Mu‘āwiya (661-680). Au VIIe siècle, les documents grecs et coptes rendent
toute l’ampleur de l’activité administrative d’Antinoé et de sa zone d’influence. Dès le début
du VIIIe siècle, son nom arabe apparaît dans les documents, et on peut suivre l’histoire
d’Anṣinā qui se place ensuite, dès les premières décennies du VIIIe siècle, dans l’ombre de sa
voisine Ašmūn. Dans ce processus, le découpage provincial et en son cœur la Thébaïde, est
adapté à la philosophie de l’Empire, pour ne garder qu’une division entre Haute et Basse-
Égypte. Le duc présente un profil progressivement islamisé à différents niveaux de
représentation de sa fonction, comme dans les documents que sa chancellerie émet. La
chronologie de cette évolution était déjà connue dans son ensemble au niveau des plus grands
centres de l’Empire
4
, mais nous avons pu donner, dans le troisième chapitre, le détail de
l’application des mesures impériales au sein de la province.
Au tournant de l’époque marwānide, la région intègre ensuite directement des acteurs
nouveaux. Des fonctionnaires de nom arabe interviennent directement au niveau local, ils
portent tout d’abord le titre d’epikeimenos dans les documents arabes et acquièrent ensuite
directement un ancrage territorial au sein de la région. Ils remplacent alors les élites locales
dans la gestion des affaires administratives de la région. La création de ce corps de
l’administration local au niveau de la kūra constitue l’aboutissement des mesures mises en
place dès le début de l’époque umayyade, et témoigne d’une volonté impériale de
structuration de l’administration des provinces dans leurs différents niveaux hiérarchiques.
L’investissement du gouvernement provincial par l’envoi des epikeimenos arabes à partir de
705, l’implantation d’un corps de l’administration arabe en tant que tel au niveau de la kūra
d’Ašmūn à partir de 714 et la disparition progressive du duc de Thébaïde de la hiérarchie
provinciale dans les années 720, représentent trois volets intimement liés et consécutifs de ce
processus, si ce n’est directement contemporains. On trouve des epikeimenos arabes alors que
le duc est toujours en poste, puis epikeimenos et pagarques arabes finissent par se confondre
en une seule fonction.
Cet examen nous permet réellement de placer un tournant dans l’administration de la
Moyenne-Égypte autour des années 710 et du règne du calife al-Walīd (705-715). Les
4
Comme l’indique P. Brown, la période 632-809 est celle du « monde antique sous la domination de l’Islam » :
The World of Late Antiquity, Londres, 1971, p. 194-203.

Conclusion
280
informations que nous avons eu l’occasion d’examiner pour d’autres régions ne permettent
pas de douter que cette chronologie soit applicable pour d’autres régions. Au cours de ce
passage, nous avons pu présenter l’examen des titres trouvés dans les papyrus concernant les
administrateurs de l’Hermopolite/kūra d’Ašmūn. Ils révèlent une distinction nette entre l’élite
traditionnelle de la pagarchie, qui porte le titre de pagarques ou ṣāḥib, alors que les
représentants directs de l’État islamique portent le titre de ‘āmil dans les documents arabes et
ne portent pas de titre dans les documents grecs et coptes. De manière générale, les
administrateurs représentants l’État islamique, le duc, les epikeimenos ou les ‘āmils, sont
souvent connus avec le titre d’amīr dans les documents grecs et coptes.
En comparant nos conclusions concernant l’époque de la conquête à celles du début de
la période umayyade, nous pouvons séparer les mesures had hoc et temporaires des initiatives
structurelles ayant des conséquences à long terme. La nomination d’amīr pour le contrôle de
la vallée et la gestion des grandes réquisitions nécessaires à l’installation des armées se
présentent comme des mesures immédiates mais temporaires. La reprise de l’administration
locale par une société issue de la conquête se recompose à chaque pallier de notre étude. La
formation de l’État islamique se présente pas à pas comme celle d’un système politique qui
allie les conquérants et conquis, et, à terme, les chrétiens et les musulmans, assurant
conjointement l’exploitation et l’administration de la région. Des mécanismes de coopération
et d’intégration variés se développent entre cette classe d’administrateurs locaux et le pouvoir
central, pour forger progressivement l’identité de l’État islamique. Au fil de cette adaptation,
la formation d’un système étatique propre au pouvoir islamique recompose peu à peu
l’identité byzantine de l’administration et il devient impossible de distinguer les conquérants
des conquis. A l’étude de la Moyenne-Égypte, il semble bien, cependant, que l’identité
islamique la plus courante au cours des deux premiers siècles de l’Islam est bien celle de
l’administration.
Nous avons pu révéler la place capitale de la ville d’Antinoé/Anṣinā et de
l’administration de son duc pour l’histoire de l’Égypte umayyade, malgré le peu de place
accordée dans les sources arabes à cette ville. Le rôle du duc d’Antinoé dans la formation de
l’ordre umayyade au niveau local est représentatif des conclusions de P. Bourdieu sur la
naissance de l’État : « L’Etat, quand il réussit, se fait donc oublier et fait oublier qu’il a dû
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%