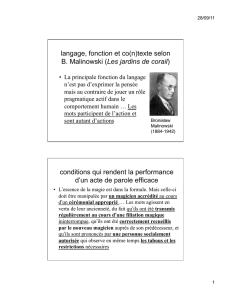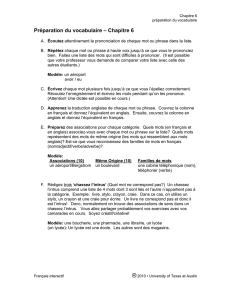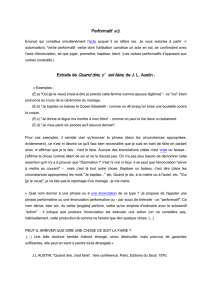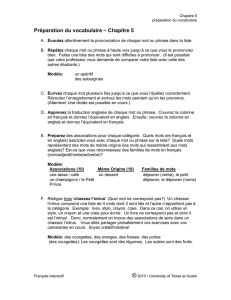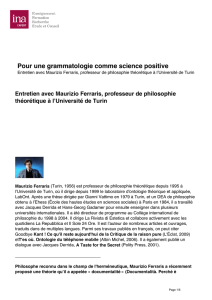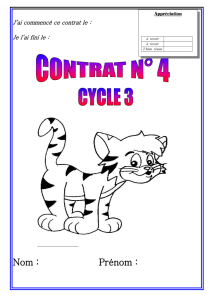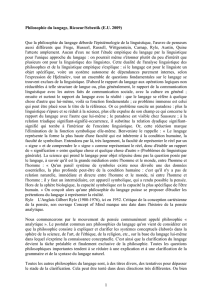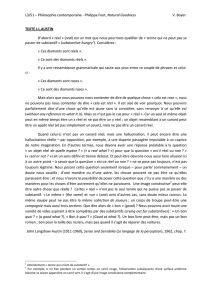Austin et la philosophie du langage ordinaire : La pertinence

Austin et la philosophie du langage ordinaire : La
pertinence toujours actuelle de la critique de l’illusion
descriptive
Bruno Ambroise
To cite this version:
Bruno Ambroise. Austin et la philosophie du langage ordinaire : La pertinence toujours actuelle
de la critique de l’illusion descriptive. 2016. <hal-01292701>
HAL Id: hal-01292701
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01292701
Submitted on 23 Mar 2016
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,
´emanant des ´etablissements d’enseignement et de
recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires
publics ou priv´es.

Austin et la philosophie du langage ordinaire :
La pertinence toujours actuelle de la critique de l’illusion descriptive
! " #$#$ ! %% !&'
#(!)*(+((*+##,##"
)$!&!)#)(!###
!#$#$-*1' ("#$#$!%%
!&!.+%)))#!/0!)#)(!1
, 0 ( #* #$#$* ) 2 34 ! !
)56760#*/(*+##)")(&
## ( */( %! ! !,) ! #*
#$#$* (, # ( 28 !)/( 2 +)%! ! (
,#),9!##!!#$#$!
%% * # ! ## *+ + )
((
:+! ) , ! ( , )$!
##2,))!+#(#-!%
*+(, ()# #$#$(#8 :+
# # ! , + ! #$#$ !+ 9
#*+#+)%!(!(!)8(+%!
#) !+ #9 ( , 2 (#! +9 ##
)#$#$* ! #$#$ ; +!) *+!2 !
#(#(!<,,!)#2(##
#$#$ -* ! %% (# !)#
#(!,+(!!)($#$#$*%.
* 9 # ( ! #)##) !
=8 > # 4# 8 Philosophical Analysis in the Twentieth Century >8 ?; The Age of
Meaning(;(,-?668
?=8 > 8 8 8 @(A Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic Philosophy B!;
(AC7##8DEE?8
1

#$#$-*(#8 ( ( #9+(!
()#8B%3F(#,4#,G48
: ( # # 0 9 # (#. (
(2(*#, (()0*()(#
##2#$#$-*(*9H
#( ) 2 * ! ,))58 ## +(
(*#((#!!,))0
,G(*!)I!((#!
,))(,))(#!(0*H!)( *+,,
9!+-!%%!%/(!(!+-
#$#$* %))8 J+ ( K # , #9
( ( 2 " ,)) 2 #(& #
( # (( !+ #( ! %% ,
###)8+(((-2(<!
%*%%,2%!!8
,!+,2( !)I4#$#$*
9 ,! 4 )) !)( ! )%
%, * # !+ 2 ( ( ! ,));
(*!+!(#,(#!(#*
!)#8:+4%*(),",(&
,) #$#$ ! %% ! # , + ,
#(!)!+8#)()9,!
!4 % # 4 %)) (!)) (
!)( *)),()!)76#L($!+(H)
:$8!+8
: # #)() # *+ !)( +9 ( !
( #) !+- ! #*8 ! (
#)!(,,"&2,
, # ! (, #K 2
=8>8B%"B+(!%%( #%*&8B%M$8
$)!8John L. Austin et la philosophie du langage ordinaire@!$;3?6##85E8
D=8>8GWhen Words Are Called For!%8;@,!,-?6?8
5=8+!)*!(#4,4!:8$84"N$B%(F(
&8B%M$8$)!8 John L. Austin et la philosophie du langage ordinaireop.
cit.##8E?68
2

#( 9(8 9( 9 + ! ! *
(* ! + !(#, 9 ((;
#(2+ /**!,))#
( * # %)) #$#$ !
#$#$ -* ! %% # ! #$#$ 0
!#$#$!%%8
1. Quel est l’enjeu de la méthode philosophique d’Austin6 ? Retour sur
« Plaidoyer pour les excuses » (texte particulièrement dense d’Austin)
O !, ( ! ! -* ! (
# ! "+- %*& #$#$ (
"#$#$!%%!&7%4(H)
! B8 P% ! "(!& * ! 8 F8 C L8 - :8 38
8 */( * , , 8 + #
) %) ( %# ! #$#$ 4
#*.$))%.(+(###*+
,!*# ## ,; #) ) ! ## -# !
#$#$ ! *+ ($($ 2 !) ! ! !
"#$))% %*& 0 #( *+ (!)
* */( )#8*+)
'(*+#,(( *;
Q!4(*!*!*#-
!*%!#
"%/(&**+)%))!
#,(R,!((( /)
*,!# /#(#*+
7=8##*+*))(!)/8888@(A Wittgenstein’s Place
in Twentieth Century Analytic Philosophy, op. cit.!8#,!))
!#) ! ,4 !+ * # ! ( K ! #()!
,!*)8
=8%8 Philosophical Analysis in the Twentieth Century, Vol. 2 : The Age of Meaningop8
cit.
E=83#2 (!)2()%!*+#!,!8,,2"
%&!,(#,2(,(8
3

# + ! #$).8 "!- # 4(& #8
DD9
N +#(# ! "#$))% %*;+(
#) # , *+ *+
(#)$ #(# ! #$). !
!8O ((#!!4($;#*%%!
+% ! ! %% * (#! # !
($* (/* (8 #(. (# !
#(# /)! )R * % #)(/* !
%%!4*, ##8
!%.(!.*%%!
#,#1-#!+%*+((#(*+
-!4%!($!!%!4
* %% #$#$* * !)($) ! % #*8 B
%%!(%#(*##;
# ($ !
#*!,!(83+,(
!)/#S,;(-!4
(#!)!!*,
) 2 % ! 8 " & Cahiers de
Royaumont : La philosophie analytique##8D8
#!,##
! *+ - ! * #
#10;(+,!%%*#,(
!!*9
!)92 ! # ! !8 *+ , !
=
8:8B8" 4(&57 Philosophical Papers34 !;34 !,-
##85?6DR!8 8B8M8B8@(A"!-#4(&:8B8
Écrits philosophiques;D##8768
6=83#T!-!#(#0#*1
#!+ !")!(&0#!.!;#%
((##* * 1###(,# !
#K*+8>,4!$8N,*!#(#8
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%