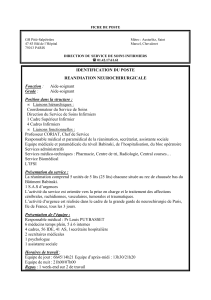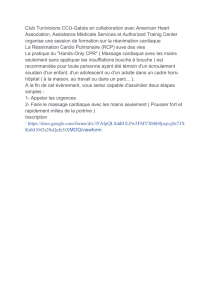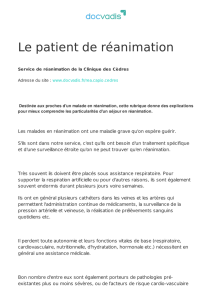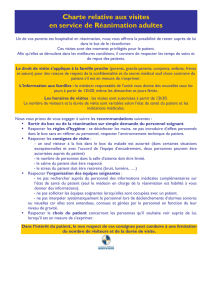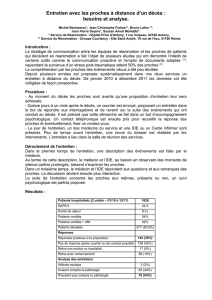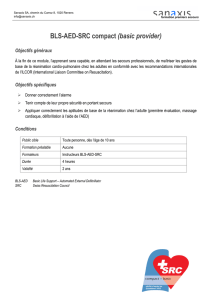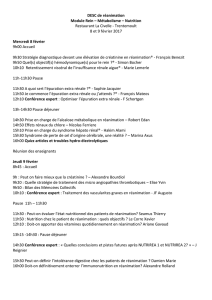Télécharger le PDF

CHRONIQUE JURIDIQUE
La réanimation. Et après ?
C. Sicot*, D. Baranger
Le Sou Médical, 130, rue du Faubourg Saint-Denis, 75466 Paris cedex 10, France
(Reçu le 14 novembre 2001 ; accepté le 15 novembre 2001)
HISTOIRE CLINIQUE
M. Y., 18 ans, était victime d’un accident de la voie
publique le 26 février 1994 sur une autoroute du centre
de la France. Il était passager arrière non ceinturé dans
une voiture qui avait été percutée par l’arrière. Après
désincarcération, il était transféré dans le coma (Glas-
gow à 6) au centre hospitalier universitaire. Clinique-
ment, il existait une hémiplégie droite, une contusion
de l’épaule et une plaie du sourcil gauches. L’examen
tomodensitométrique cérébral mettait en évidence une
hémorragie méningée avec une contusion frontale bila-
térale à prédominance gauche. En l’absence d’indica-
tion neurochirurgicale, M. Y. était dirigé sur le service
de réanimation du Pr R. avec poursuite de la ventilation
mise en place sur les lieux de l’accident. Au bout de
48 heures, un nouvel examen tomodensitométrique
cérébral montrait une rétrocession des images de contu-
sion cérébrale. La sédation était alors diminuée et le
score de Glasgow mesuré à 11. L’état neurologique
continuant à s’améliorer, la sédation était arrêtée le
8 mars. Les anticomitiaux étaient institués à partir du
10 mars. Le malade pouvait alors être mis au fauteuil
mais il persistait une aphasie d’expression et une hémi-
parésie droite. L’hyperthermie apparue le 3 mars était
traitée par antibiothérapie. M. Y. pouvait être extubé le
11 mars. Le 15 mars, il était décidé de le diriger vers le
centre de rééducation de S. mais cela ne pouvant être
réalisé qu’une semaine plus tard, le patient était trans-
féré dans le service de neurochirurgie du Pr C.
À son arrivée dans ce service, M. Y. était somnolent
avec des phases d’hallucination mais l’état de cons-
cience était jugé en amélioration. Il répondait aux ordres
simples. La température était toujours oscillante entre
38 et 39 °C. La diurèse était minime. Il existait un
amaigrissement manifeste avec un pli cutané signant
une déshydratation. L’alimentation était très légère car
M. Y. avalait difficilement et faisait, de temps à autre,
des fausses routes. À noter que lors de son admission en
neurochirurgie, M. Y. était porteur d’une sonde naso-
gastrique qui assurait jusqu’alors son alimentation, mais
il l’avait arrachée le 16 mars et elle n’avait pas été remise
en place. Le dimanche 20 mars, l’interne de garde
demandait un ionogramme sanguin (premier iono-
gramme réalisé dans le service de neuro-chirurgie depuis
l’admission le 15 mars). Il mettait en évidence une
« déshydratation extra et intracellulaire très marquée
avec hypernatrémie ». Une réanimation apportant qua-
tre litres de solutés était alors prescrite.
Le lendemain matin, vers 12h30, une assistante hos-
pitalière tentait de faire avaler un peu de semoule à M.
Y., mais celui-ci toussait. L’assistante hospitalière arrê-
tait l’alimentation, remontait le malade dans son lit et
allait porter le bol de semoule à l’office. En revenant,
elle trouvait le malade « bleu ». Elle appelait l’infirmière
ainsi que l’anesthésiste qui venaient rapidement. Ce
dernier intubait le patient et commençait la réanima-
tion mais sans succès. Le décès de M. Y. était constaté à
13h10. La nécropsie permettait d’affirmer que le décès
était dû à une fausse route alimentaire par inhalation.
Le père de M. Y. (médecin) déposait une plainte
pénale (article 221-6 du Code pénal) pour homicide
involontaire et le juge d’instruction décidait de mettre
en examen le Pr C. chef de service de neurochirurgie, le
Dr A. médecin assistant et M
lle
G. faisant fonction
d’interne en neurochirurgie.
L’article 221-6 du Code pénal énonce que : « Le fait
de causer par maladresse, imprudence, inattention,
*Correspondance et tirés à part.
Adresse e-mail : [email protected] (C. Sicot).
Réanimation 2002 ; 11 : 375-7
© 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés
S162406930200258X/MIS

négligence ou manquement àune obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la
mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni
de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs
d’amende. En cas de manquement délibéréàune obli-
gation de sécuritéou de prudence imposée par la loi ou
les règlements, les peines encourues sont portées àcinq
ans d’emprisonnement et à500 000 francs d’amende ».
Par ailleurs, d’après la jurisprudence, le lien de causa-
litéentre la faute et le préjudice (décès) doit être cer-
tain. En fonction de ces données, les responsabilitésdu
Pr C. chef de service de neurochirurgie, du Dr A.
médecin assistant et de M
lle
G. faisant fonction d’interne
sont-elles pénalement engagées ? D’autres responsabili-
tés sont-elles àrechercher ?
INSTRUCTION DU DOSSIER
Le juge d’instruction chargéd’instruire le dossier dési-
gna comme expert un professeur des universités, chef de
service de neurochirurgie d’un CHU. Celui-ci estima
qu’il n’y avait pas eu de problème de surveillance ou de
traitement du blessédans le service de réanimation.
Tout en excluant toute faute dans la prise en charge
assurée par le service de neurochirurgie, l’expert souli-
gna que des ionogrammes auraient dûêtre réalisés plus
précocement pour mettre en évidence la déshydratation
liéeàl’alimentation insuffisante et l’hyperthermie, et
qui, àson avis, avait étéàl’origine de la dégradation de
l’état de conscience décrite par les infirmières et les
agents hospitaliers du service de neurochirurgie.
Àla demande de la partie civile, et notamment du
père (médecin) du jeune homme, le magistrat instruc-
teur accepta de demander une contre-expertise dont les
conclusions furent les suivantes : «La réanimation n’a
pas permis de rétablir l’état antérieur dans la mesure oùM.
Y. était un patient présentant d’une part, des séquelles
neurologiques et d’autre part, une dénutrition et une
déshydratation importantes. Son état de conscience était
altéréaprèsl’accident dont il a étévictime mais cet état a
pu être aggravépar la déshydratation. Il n’y a pas de lien
direct entre la déshydratation et la fausse route mais la
déshydratation, ainsi que les troubles neurologiques dont
souffrait le patient, sont, en partie, la cause de l’échec de la
réanimation ».Àla suite du dépôt de ce deuxième
rapport, le juge d’instruction décida de renvoyer devant
le Tribunal correctionnel les trois médecins mis en
examen.
Se fondant notamment sur le deuxième rapport
d’expertise, les magistrats du Tribunal correctionnel
estimèrent que «(ces) trois médecins avaient par leur
manquement fautif de vérification, laissé s’installer chez
M. Y. un état sévère de déshydratation en ne demandant
aucun ionogramme avant le jour du décès ; que cet état
avait contribué à faire échec aux mesures de réanimation,
que la mort résultait de cet échec et qu’il s’en suivait que
leur faute avait concouru directement au décès ».Le
24 février 1999, ils condamnèrent chaque médecin à
un emprisonnement de trois mois avec sursis ainsi qu’à
une peine d’amende de 30 000 francs pour le chef de
service de neurochirurgie et de 10 000 francs pour les
deux autres médecins.
Le chef de service de neurochirurgie ainsi que le
Ministère Public ayant fait appel, l’affaire revint devant
la Cour d’appel en novembre 1999. Reprenant les
termes des deux rapports d’expertise, les magistrats
soulignèrent que le premier expert ne s’était pas pro-
noncésur la relation de cause àeffet entre la déshydra-
tation et le décès. Quant aux seconds experts, ils avaient
conclu qu’il n’était pas possible d’imputer àla déshy-
dratation la cause directe du décès, lequel était dûàune
fausse route bronchique mais qu’avec l’état neurologi-
que du malade, la déshydratation avait sa part de res-
ponsabilitédans l’échec de la tentative de réanimation.
En conséquence, «l’on ne pouvait affirmer que si le
malade n’avait pas été en état de déshydratation, une
réanimation aurait été possible ; que si le dossier faisait
apparaître que la surveillance hydrique avait été insuffi-
sante, néanmoins la relation de cause à effet entre cette
faute et le décès n’était pas établie ; que si l’utilisation
d’une sonde naso-gastrique pour nourrir et hydrater le
malade aurait sans doute réduit le risque de fausse route,
elle ne l’aurait pas supprimé et que d’autre part, les méde-
cins n’avaient pas décidé d’enlever cette sonde mais de ne
pas la remettre une fois que le malade l’ait arrachée, qu’il
s’agissait peut-être d’une erreur médicale mais pas d’une
faute pénale ».
Pour ces motifs, la Cour d’appel relaxa les prévenus et
débouta la partie civile.
COMMENTAIRES
Sur le plan juridique, ce dossier n’appelle pas de remar-
que particulière. Devant la justice pénale, un médecin
ne peut être condamnéque:a)s’il a commis une faute
ayant la qualification d’une infraction pénale et b) s’il
existe une relation certaine entre cette faute et le préju-
dice causéau patient, en l’occurrence son décès. Les
juges de première instance avaient retenu contre les
médecins poursuivis, une faute de négligence en raison
d’une absence de surveillance clinique et biologique du
patient ayant abouti àun état sévère de déshydratation
et avaient attribuéàcette faute le décès du patient. En
revanche, rétablissant la véritédes faits, les magistrats
d’appel rappelèrent que le décès de ce jeune garçon était
liéàune fausse route bronchique et qu’il n’était pas
possible d’évoquer une relation de causalitécertaine
entre la fausse route bronchique et l’absence de sur-
376 C. Sicot, D. Baranger

veillance du ionogramme plasmatique àpartir de
l’admission en neurochirurgie.
D’un point de vue médical, ce dossier pose le pro-
blème du devenir des malades àla sortie des services de
réanimation. Transférer vers les unitésd’hospitalisa-
tion, des patients ayant toujours une charge en soins
élevée, n’est pas une solution [1]. En Grande-Bretagne,
oùle nombre de lits de soins intensifs est très insuffisant
par rapport aux besoins, il a étémontréqu’une telle
attitude était génératrice d’une surmortalitéhospita-
lière [1, 2]. Cette mortalitépeut être diminuéede30%
en différant de 48 heures le transfert de certains malades
identifiés comme «àrisque »[2]. Si le problème ne se
pose pas dans les mêmes conditions en France, il n’en
reste pas moins que le transfert d’un malade d’une unité
de réanimation dans un service oùles moyens humains
et matériels sont, par définition, plus limités, est une
décision qui doit être mûrement réfléchie et qui ne peut
s’envisager que si l’on a la certitude que la continuitédes
soins nécessaires au malade sera assurée. Dans le cas
contraire, il est évident que la responsabilitédu méde-
cin senior ayant décidé(ou couvert) un tel transfert
serait engagée. Si tel n’a pas étéle cas dans ce dossier,
c’est vraisemblablement parce que la plainte de la famille
visait essentiellement les médecins du service de neuro-
chirurgie, qu’un délai de sept jours s’était écouléentre la
sortie du service de réanimation et le décès et que le juge
d’instruction n’a pas cru bon d’orienter son enquête
dans cette direction. Il n’en reste pas moins que le
premier rapport d’expertise rédigépar un neurochirur-
gien se terminait par cette phrase : «Mais il est bien
certain qu’un service de neurochirurgie n’est pas une
structure adaptée pour suivre les malades de traumato-
logie puisque les neurochirurgiens envoient leurs
patients graves en réanimation pendant une certaine
période ». Certes, lorsque ce jeune garçon a quittéle
service de réanimation, il avait retrouvéune autonomie
respiratoire, mais il restait fébrile et, compte tenu de son
état de vigilance, son hydratation dépendait essentielle-
ment des apports hydriques faits par l’intermédiaire de
la sonde naso-gastrique poséeenréanimation. Après
que le patient l’ait retirée et que les médecins du service
de neurochirurgie n’aient pas jugénécessaire de la repo-
ser, les risques de déshydratation et de fausse route
bronchique étaient nettement accrus ce qui aurait dû
justifier une surveillance renforcée. A posteriori, l’idéal
aurait étéqu’après transfert de ce patient, les médecins
des services de réanimation et de neurochirurgie puis-
sent se concerter sur la meilleure attitude àadopter
concernant la repose (ou non) de la sonde naso-
gastrique, les modalitésdelarééquilibration hydro-
électrique, la fréquence des contrôles biologiques{
Évidemment, rien ne permet d’affirmer qu’une telle
concertation aurait pu éviter la fausse route responsable
du décès mais, comme l’ont estiméles juges d’appel, si
l’attitude adoptée ne saurait constituer une faute pénale,
«peut-être s’agit-il d’une erreur médicale ».
CONCLUSION
Le transfert d’un malade de réanimation dans un autre
service doit se faire aprèss’être assuréqu’il n’existe plus
de critères justifiant le maintien en réanimation et que
le service d’accueil, est en mesure d’assurer la continuité
des soins. Un compte rendu détaillédu séjour en réa-
nimation mentionnant l’état àla sortie, le traitement à
poursuivre et la surveillance àmaintenir ainsi qu’un
contact (ne serait-ce que téléphonique) avec les méde-
cins du service d’accueil dans les jours suivants le trans-
fert en sont les meilleurs garants.
RE
´FE
´RENCES
1 Smith L, Orts CM, Neil LO, Batchelor AM, Gascoigne AD,
Baudoin SV. TISS and mortality after discharge from intensive
care. Intensive Care Med 1999 ; 25 : 1061-5.
2 Daly K, Bealer, Chang RWS. Reduction in mortality after
inappropriate early discharge from intensive care unit : logistic
regression triage model. BMJ 2001 ; 322 : 1274-6.
La réanimation. Et après? 377
1
/
3
100%