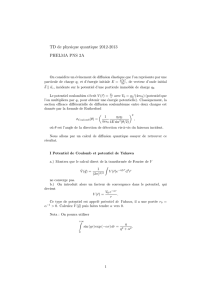Analyse propédeutique

Analyse prop´edeutique
Hansklaus Rummler
remani´e et augment´e par
Patrick Ghanaat
D´epartement de Math´ematiques
Universit´e de Fribourg, Suisse
Version 2016

(empty page)

Isaac Newton, 1642/43∗) - 1727
Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 - 1716
Leonhard Euler, 1707 - 1783
∗) Selon le calendrier julien, encore en vigueur en Angleterre jusqu’en sep-
tembre 1752, Newton est n´e le 25 d´ecembre 1642. Cette date correspond
au 4 janvier 1643 du calendrier gr´egorien, d´ej`a en vigueur dans la plupart
des pays du continent.
iii

Pr´eface
Ce cours a surtout deux buts : on va revoir et compl´eter l’enseignement math´e-
matique re¸cu au gymnase et vous fournir ainsi un certain arsenal de techniques
math´ematiques utiles pour vos ´etudes et vos futures activit´es dans la vie profes-
sionnelle. Et vous allez vous familiariser avec des raisonnements math´ematiques,
afin de comprendre des ´ecrits scientifiques qui font appel `a des connaissances
math´ematiques. La connaissance du langage et de la pens´ee math´ematiques vous
permettra aussi de parler avec un math´ematicien si, plus tard, vous avez besoin
d’outils math´ematiques plus d´evelopp´es que ceux que vous verrez dans ce cours.
Afin d’atteindre ces buts, un certain effort de votre part est indispensable.
Travail individuel. La dur´ee du cours ´etant tr`es limit´ee, il n’est gu`ere possible
d’en assimiler la mati`ere sans la revoir `a la maison. Pour ce travail individuel,
la devise doit ˆetre : Comprendre avant d’apprendre ! Plus pr´ecis´ement : il ne
sert `a rien d’apprendre par cœur des d´efinitions ou des formules sans en avoir
vraiment compris le sens. Ainsi il est recommand´e de compl´eter la liste des
exemples pr´esent´es dans le cours, car en en construisant soi-mˆeme, on comprend
mieux la signification d’une d´efinition ou d’un th´eor`eme. Il est aussi vivement
recommand´e de voir comment d’autres auteurs expliquent la mˆeme mati`ere, car
un autre point de vue peut aider `a la compr´ehension.
Exercices. La pratique d’un sport ou d’un instrument de musique ne s’apprend
pas en regardant les sportifs d’´elite `a la t´el´evision ou en ´ecoutant des enregis-
trements d’une virtuose : il faut l’essayer soi-mˆeme et il faut l’exercer. Le mˆeme
principe est valable pour les math´ematiques, o`u les exercices vous donnent l’oc-
casion d’entraˆıner vos talents. Afin de d´evelopper la facult´e de communiquer ses
raisonnements `a d’autres gens, il est vivement recommand´e de travailler `a deux.
Cette fa¸con de travailler en (petits !) groupes vous donne aussi un contrˆole de
votre travail, car c’est en l’expliquant `a une autre personne que l’on voit si on
a vraiment compris quelque-chose.
Dass dieses Skript zu einer auf Deutsch gehaltenen Vorlesung auf Franz¨
osisch
geschrieben ist, ist eine Art Selbsthilfe: Die franz¨
osischsprachige Literatur auf
diesem Gebiet entspricht weniger gut unseren Vorlesungen als die deutschspra-
chige, so dass eher der Bedarf nach einem franz¨
osischen Skript besteht. Ich hoffe
aber, dass auch deutschsprachige H¨
orer von diesem Skript profitieren.
Fribourg, septembre 2004
Hansklaus Rummler
Diese Vorlesungsnotizen sind aus einem Manuskript entstanden, das Hansklaus
Rummler f¨ur das akademische Jahr 2004–2005 angefertigt hat. Ich danke Gau-
tier Berck, Matthieu Gendulphe, Genevi`eve Perren und Florence Yerly f¨ur ihre
Hilfe bei der Korrektur fr¨uherer Versionen des franz¨osischen Textes. Jean-Paul
Berrut hat die Vorlesung im Jahr 2013–2014 gehalten und zahlreiche Korrektu-
ren und Verbesserungen beigetragen.
Fribourg, August 2014
Patrick Ghanaat
iv

Table des mati`eres
1 Fonctions 1
2 Limites et continuit´e 12
3 Calcul diff´erentiel 24
4 Formule de Taylor et s´eries enti`eres 35
5 Calcul int´egral 46
6 Logarithmes et fonctions exponentielles 60
7 Equations diff´erentielles : introduction 69
8 Equations diff´erentielles lin´eaires 83
9 Les nombres complexes 98
10 Gradient et d´eriv´ees partielles 110
11 Extrema des fonctions `a plusieurs variables 123
12 Int´egrales multiples 136
13 S´eries de Fourier 146
v
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
1
/
158
100%