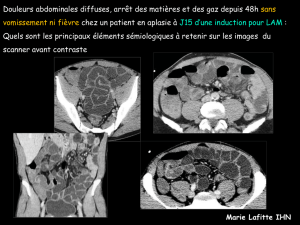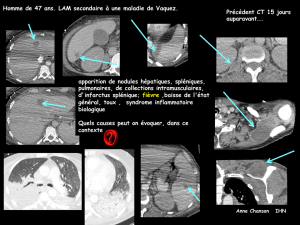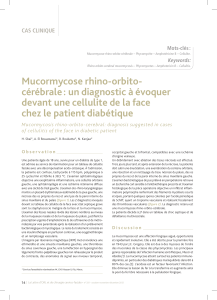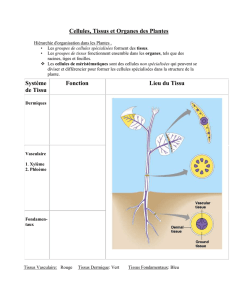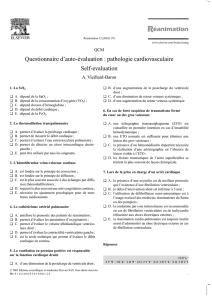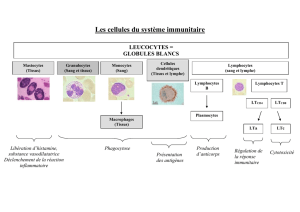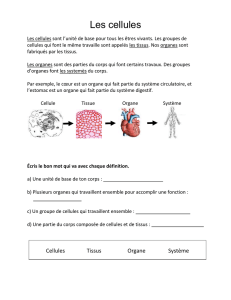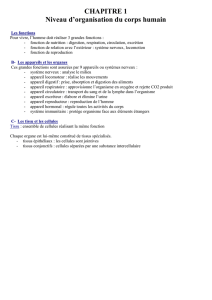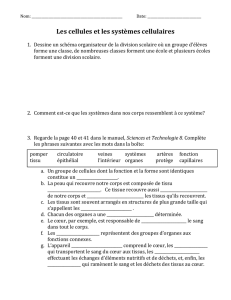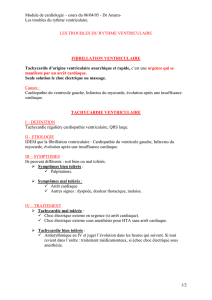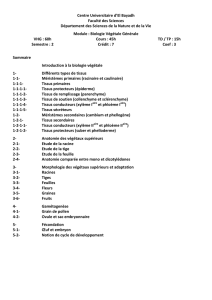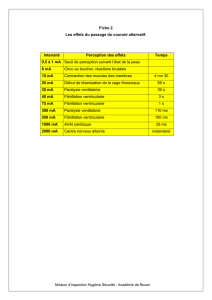L`endoscopie ventriculaire comme moyen du diagnostic et du

MUCORMYCOSE CEREBRALE AVEC ATTEINTE DU
VENTRICULE LATERAL
L’endoscopie ventriculaire comme moyen du diagnostic
et du traitement: à propos d’un cas
D. Lisii, F. Caire, A. Alfieri, J. Vidal, A. Ben Ali, P. Hallacq,
JJ. Moreau
Service de Neurochirurgie
CHU Limoges
Mots clés : mucormycose cérébrale, endoscopie ventriculaire.
Dan Lisii
DIS Neurochirurgie
CHU Limoges
2, av Martin Luther King
0555056521

Résumé:
La mucormycose est une infection opportuniste rare, causée par des
champignons ubiquitaire dans la nature de la classe de Phycomycetes.
Intéressant dans la quasi totalité des cas les patients immunodéprimés,
l’infection est le plus souvent d’évolution défavorable, avec un taux
de mortalité estimé de 70% à 100% des cas. Les forme les plus
classiques sont la mucormycose rhynocérébrale et pulmonaire, mais
tout organe peut être atteint. Dans les cas d’atteinte cérébrale le
traitement est basé essentiellement sur une chirurgie d’exérèse et
débridement des tissus nécrotiques et l’administration précoce des
antifongiques par voie intratecale et/ou intraveineuse. Notre
observation concerne un patient immunocompétent, chez qui une
mucormycose cérébrale isolée avec atteinte du ventricule latéral a été
diagnostiqués. L’atteinte de la corne frontale avec exclusion
ventriculaire avais permis la réalisation du geste endoscopique pour
mettre en évidence la colonisation au niveau de l’épendyme ainsi que
de réaliser une exérèse généreuse des tissus nécrotiques. D’après nos
recherches bibliographiques, c’est le premier cas présenté d’utilisation
de l’endoscopie intracérébrale pour réaliser une exérèse des tissus
nécrotiques d’un abcès fongique. L’acte endoscopique a permis, d’une
part, de poser le diagnostic d’abcès fungique et d’instituer un
traitement précoce avec Amphotericine B, et d’autre parts de réaliser
une exérèse des tissus nécrotiques. L’évolution a été favorable avec le

retour à ces activités précédentes. Les facteurs d’une évolution
favorables sont discutés et recherchés dans la littérature.
Présentation du cas :
Monsieur CM, 40 ans a présenté un syndrome infectieux, qui avait
initialement correspondue à une broncho-pneumopathie jusqu'à la
survenue d’un syndrome méningé. Celui-ci a été confirmé par une
ponction lombaire qui a mis en évidence une hyper –cellularité isolée
et dont la culture bacterienne s’avère négative ainsi que la recherche
d’antigènes solubles urinaires pour Légionella et Pneumocoque. La
radiographie du thorax objectivait une pneumopathie bilatérale
diffuse. L’évolution sur le plan réspiratoire a été favorable sous
Rocephine i.v. puis relais par des céphalosporines per os.
Après deux semaines du traitement le patient est réhospitalisé pour
des céphalées et confusion, associés à une amnésie et ralentissement
idéomoteur. Le scanner réalisé en urgence retrouve une exclusion et
dilatation du ventricule latéral droit avec un engagement sous-
falcoriel. (fig.1)
Une dérivation ventriculaire externe est mise en urgence. L’IRM
confirme l’existence d’une lésion hétérogène au niveau de la corne
frontale droite avec une prise de contraste périventriculaire.(fig. 2)
L’endoscopie mettait en évidence une lésion blanchâtre, légèrement
surélevée au dessus de l’épendyme ventriculaire, évoquant une

prolifération fungique. Ca localisation au niveau de la corne frontale
est proéminente jusqu'à l’obstruction du trou de Monro, entraînant
l’exclusion du ventricule (fig.3 et vidéo). Une exérèse généreuse de la
lésion est réalisé par aspiration et a l’aide des pinces à biopsie. La
procédure a été complétée par une septostomie, afin d’établir une
communication entre les ventricules latéraux à travers le septum
pellucidum. L’analyse en microscopie, sans que la culture soit
positive, retrouve une mucormycose. Un traitement est débuté par
AMBISONE par voie intraveineuse. Parallèlement à cela il a toujours
présenté de douleurs du rachis exploré par l’IRM et qui vont retrouver
une discite au niveau D11-D12. L’étiologie de cette discite,
probablement de même origine, n’a pas été confirmée par les
prélèvements répètes.
L’évolution a été très favorable au plan neurologique, ce qui amène à
l’ablation de la dérivation externe. Après trois semaines on constate
une nouvelle aggravation avec apparition d’un déficit de l’hémicorps
gauche, dont le bilan retrouve une hydrocéphalie aiguë et imposant
une dérivation externe à nouveau. Devant la persistance de la
symptomatologie avec des lésions stable sur le plan de l’imagerie un
traitement intra ventriculaire avec AMPHOTERICINE B a été débuté
en complément au traitement systématique. L’AMPHOTERICINE B
intra ventriculaire a été poursuivi sur 35 jours consécutifs avec une
nouvelle amélioration du déficit de l’hémicorps gauche. Le traitement
systématique avec AMPHOTERICINE B a été arrêté après 150 jours.

L’IRM cérébrale et du rachis met en évidence une régression des
lésions, mais du fait de la persistance d’une dilatation ventriculaire
une dérivation ventriculopéritonéale droite à été mise en place. Dans
les suites on marque une amélioration de son état clinique avec le
retour a un état de conscience normale et reprise de ces activités.
Discussion :
La mucormycose est une infection opportuniste, rapidement
progressive, causée par un champignon de la classe de Phycomycètes.
Le pronostic de cette maladie est sévère, notamment dans les formes
cérébrales avec un taux de mortalité de 70% à 100% des cas. Les
Phycomycètes sont ubiquitaire dans la nature est représentent des
saprophytes. Ils peuvent se révéler pathogènes dans des cas
particuliers est notamment chez les patients immunodéprimés. Dans
75% des cas on retrouve un diabète sucré décompensé avec une
cétoacydose. (1). Parmi les autres facteurs prédisposant on note le
traitement par les corticostéroïdes, la greffes des organes, les
traumatismes et les brûlures, le syndrome d’immunodéficience
acquise ainsi que le traitement par déferoxamine.
Les formes cliniques les plus agressives sont la Mucormycose
rhynocérébrale, avec une atteinte des sinus paranaseaux et
envahissement par contiguïté des orbites, de la cavité crânienne, et la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%