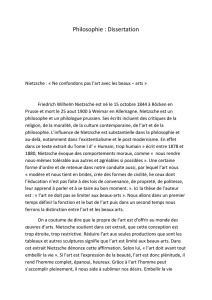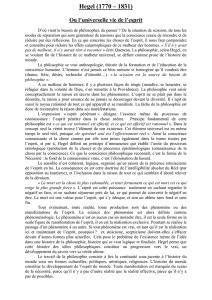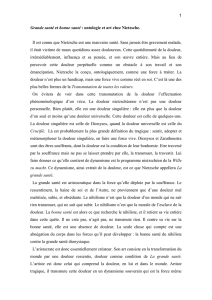La philosophie allemande et la glorification du travail par Christine

La philosophie allemande et la glorification du travail
par Christine Noël
Le regard et l’intérêt que les philosophes portèrent au travail se
transforma radicalement dès la fin du XVIIIème siècle et au cours
du XIXe siècle. Des auteurs tels que Kant, Fichte, Hegel ou encore
Nietzsche attestent de ce mouvement. Les réflexions de Hegel et
de Nietzsche, aux antipodes l’une de l’autre, méritent une attention
toute particulière. Si Hegel contribue à faire du travail un vecteur
de reconnaissance sociale, Nietzsche jette le soupçon sur les
arrière-pensées des bonnes âmes qui se font l’apôtre d’une
glorification du travail au nom de ses vertus économiques et
morales.
Hegel et la positivité du travail
Contrairement aux autres penseurs libéraux tels que Locke ou
Constant, Hegel souligne l’aspect formateur et libérateur du travail
tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Au fil de ses
écrits, Hegel considère le travail comme la manifestation concrète
de l’essence de l’homme. Le travail est défini par le philosophe
allemand comme le produit d’une double médiation : une première
médiation entre le désir et la jouissance et une seconde médiation
entre le particulier et l’universel. Ces deux dimensions permettent
de définir le travail comme une catégorie anthropologique, c’est-à-
dire comme une activité qui caractérise l’homme en propre et qui
le libère. Dans Le système de la vie éthique, le travail est tout
d’abord ce qui différencie le désir de la jouissance. Le travail est
une réponse au besoin, mais cette réponse implique de différer la
jouissance, de la réfréner. L’être de l’homme suppose le désir,
défini comme une tension vers un but qu’on imagine source de
satisfaction. En tant que manque, générateur de souffrance, le
désir exige sa propre suppression. Tandis que l’animal supprime
ses désirs par une jouissance immédiate, l’homme parvient à
différer la jouissance par la médiation de son travail. Car si la
jouissance supprime l’objet du désir, le travail le remplace par un

autre objet. Ainsi le travail est « désir refréné, évanescence
contenue » (Hegel, Phénoménologie de l’esprit). Il est en cela
l’objet d’une valorisation puisqu’il permet le passage du monde
naturel au monde culturel.
Le travail est également l’objet d’une dialectique de l’universel et
du particulier. L’universel est ce qui renvoie à une infinité
d’applications potentielles. Le particulier renvoie à ce qui
n’appartient qu’à un certain nombre et est unique. Cette
dialectique passe par l’usage de l’instrument qui permet à
l’individu de satisfaire ses besoins particuliers et il est lui-même le
fruit du travail concret de son inventeur. Mais transmis de
génération en génération, l’instrument est sans cesse amélioré.
Cette transmission dans le temps permet à la fois une
incorporation par l’individu du savoir de l’espèce et une
augmentation potentielle du savoir collectif. En outre, en se
servant de l’outil l’individu se socialise car il se soumet aux règles
universelles qui régissent tout travail. L’instrument permet ainsi de
passer du travail purement répétitif au travail cumulatif, du
particulier à l’universel. Dans la philosophie hégélienne, le travail
n’est pas un instinct de l’espèce. Il s’agit d’une activité rationnelle
qui suppose la mise en œuvre de règles universelles. « Il y a une
méthode universelle, une règle de tout travail qui est quelque
chose qui existe pour soi, qui apparaît comme un être extérieur,
comme nature inorganique et qui doit être apprise. » (Hegel, La
philosophie de l’esprit de 1805).
L’enjeu de cette définition est considérable. Le travail n’est pas,
loin de là, une activité vile et abrutissante. Hegel reconnait la
fonction éducatrice du travail qui permet l’acquisition d’une
culture théorique et d’une culture pratique (Hegel, Principes de la
philosophie du droit, § 197). La culture théorique est la culture de
l’entendement en général et celle du langage. L’entendement serait
ainsi aiguisé, selon Hegel, par l’exercice d’une activité de travail.
De par les connaissances qu’il doit appliquer, les informations
qu’il doit transmettre dans son activité, le travailleur se construit

nécessairement en travail. Seul le travailleur est habile car il
parvient à dompter la nature en produisant un objet qui correspond
à un projet humain. La culture pratique renvoie à la fonction
disciplinaire du travail, qui produit une « habitude de l’occupation
en général, une sorte de socialisation par l’effort » (Hegel,
Principes de la philosophie du droit, § 197). Cette culture pratique
permet à Hegel de distinguer le barbare de l’homme cultivé.
Tandis que le barbare est paresseux, l’homme cultivé doit
constamment s’affairer.
La dialectique du maitre et des esclaves illustre parfaitement cette
valorisation du travail. Ce texte de la phénoménologie de l’esprit
présente un conflit pour la reconnaissance entre deux consciences
qui se lancent dans une lutte à mort. L’une des deux consciences
ayant davantage peur de la mort que l’autre, elle accepte de céder
et accepte de devenir l’esclave de l’autre conscience, qui devient
dès lors le maître. Or grâce au travail, ce rapport de servitude de
l’esclave vis-à-vis du maitre s’inverse progressivement. Le maître
ne travaille pas. Il est sans projet. Il est un pur jouisseur sans
rapport immédiat avec la nature. L'esclave, au contraire, travaille,
et ce travail lui procure à la fois une identité, une existence hors de
lui et une prise sur la nature qu'il transforme et qui le transforme
en retour. Paradoxalement l’esclave devient maître de lui-même
car il est capable de réfréner ses désirs et maître du maître qui a
désespérément besoin de lui.
Si le travail est exalté pour sa valeur éducatrice, Hegel reconnait
que l’essor du machinisme défini comme une « tricherie de
l’homme face à la nature » (Hegel, La philosophie de l’esprit),
peut favoriser un abrutissement du travailleur. L’homme tente de
supprimer la nécessité de son labeur en inventant des machines.
Mais sa tentative se retourne contre lui. Car si les machines ont
des effets avantageux car elles diminuent le temps de travail et
elles permettent une augmentation de la productivité, elles ont
également des effets néfastes non négligeables.
Cette valorisation du travail, de ses vertus propres, conduit Hegel
à reconnaître à ceux qui sont contraints de travailler pour subvenir

à leurs besoins un statut politique par l’intermédiaire de leur
appartenance aux corporations. Le système électoral esquissé par
Hegel dans les Principes de la philosophie du droit suppose que
l’exercice d’une profession n’est pas un élément susceptible de
s’oppose à l’obtention de la qualité de citoyen à part entière,
rompant ainsi avec les systèmes politiques dominants au XIXème
siècle pour lesquels la propriété privée constitue l’unique critère
de dignité politique.
Nietzsche et les pièges de la glorification du travail
Le regard que Nietzsche porta sur le travail est souvent jugé
scandaleux par son extrémisme. Pourtant, la crudité des propos
nietzschéens ne doit pas nous conduire à abandonner leur
recension. Il semble en effet que l’analyse que Nietzsche consacra
au travail et à l’idéologie de sa glorification se présente comme un
acte de dévoilement des arrière-pensées qui fondent les valeurs
phares de notre civilisation.
Deux définitions distinctes émergent des textes que Nietzsche
consacre au travail. Ces deux définitions permettent de distinguer
le travail des autres formes d’activités. Le travail est tout d’abord
défini d’une manière assez classique comme le moyen de subvenir
à ses besoins. Le travail est une nécessité pour la survie biologique
de l’individu et de l’espèce. Il est la seule réponse possible à la
satisfaction de nos besoins matériels. Cette définition n’est pas en
soi originale puisqu’elle puise sa source dans la philosophie
grecque. L’activité de travail en tant que moyen de survie nous
rapproche de la sphère de la nécessité et de l’animalité. Le travail
est ainsi caractérisé par deux éléments : son caractère nécessaire et
sa pénibilité. « Le besoin nous contraint à un travail dont le
produit sert à satisfaire le besoin. La renaissance perpétuelle des
besoins nous accoutume au travail. » (Nietzsche, Humain trop
humain, I, § 611). « Tous s’échinent à perpétuer misérablement
une vie de misère, et sont contraints par cette effroyable nécessité
à un travail exténuant.» (Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra,
prologue, § 5).

Dès lors, l’appréhension du travail comme une distraction voire un
plaisir ne peut être que le signe d’une dégénérescence de l’instinct.
Si l’exercice d’une profession devient le centre de gravité de
l’existence, phagocytant tous les autres pôles d’intérêts, ce
n’est pas parce que le travail est source de plaisir, mais plutôt
parce qu’il est une nécessité.
Une seconde définition du travail émerge dans certains aphorismes
nietzschéens. Si le travail est un avilissement, comment pouvons-
nous expliquer que l’ennui « vienne nous surprendre lors des
pauses où les besoins sont apaisés, et pour ainsi dire,
endormis » ? (Nietzsche, Humain trop humain, § 611). Le travail
né du besoin devient lui-même un besoin artificiel, produit par
l’habitude et la pression sociale. Nietzsche décortique le processus
infernal [besoin-travail-besoin du travail] par lequel le travail
laisse sa marque sur l’homme. Ainsi apparaît la seconde définition
du travail, plus timide sans doute mais présente malgré tout, celle
d’une transformation de l’homme. L’habitude du travail produit un
animal servile, bridé, usé, incapable de la moindre créativité.
L’habituation au travail produit un type d’homme insipide et
docile, capable de supporter avec résignation l’ennui et la fatigue,
une sorte de « fourmi travailleuse » : le type du Chinois
(Nietzsche, Aurore, § 206).
Nietzsche décrit les effets de ce qu’on pourrait qualifier comme
une véritable discipline voire d’un dressage par le travail. Le
travail « tient chacun en bride et (…) s’entend vigoureusement à
entraver le développement de la raison, des désirs, du goût de
l’indépendance » (Nietzsche, Aurore, § 173). Et le philosophe
conclut : « une société où l’on travaille sans cesse durement
jouira d’une plus grande sécurité : et c’est la sécurité que l’on
adore maintenant comme divinité suprême » (Nietzsche, Aurore, §
173). Le travail engendre un processus de déshumanisation.
Contrairement aux doctrines socialistes, Nietzsche ne met pas en
cause les conditions de travail ou les rapports de production. A ses
yeux, le travail manuel est avilissant en soi, car il dompte les
individus et broie leur singularité, leurs aspirations les plus
profondes et leur créativité. Selon Nietzsche, le travail ouvrier
n’est guère plus enviable que l’esclavage. Cette disciplination,
dénoncée par Nietzsche, est encore renforcée par le discours
ambiant de « bénédiction du travail ». La société sacralise le
 6
6
1
/
6
100%





![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)