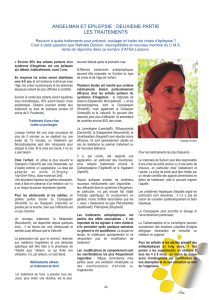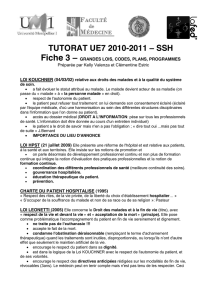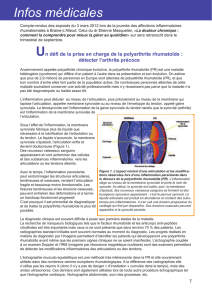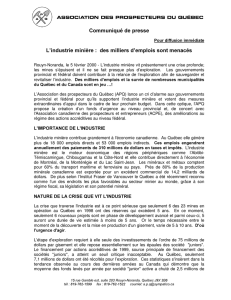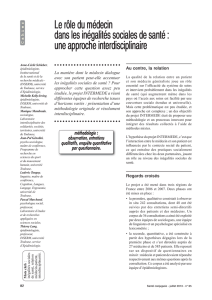Article (accès gratuit) - Institut universitaire en santé mentale de

!"#$%$&%'()*$%+%
%
!"#$%"&'%()%'*+,+$-%./0'(.$+)'1%23('%#"%4($%+%0'0%0#*$'%)/+%5+&%)0#"&&+$*"6")'%0'0%,0*$7$0%"'%
,+-$.01%!"5").+)'8%$-%)3(&%+55+*+9'%$)'0*"&&+)'%."%-"%*").*"%.$&53)$:-"%53(*%*07-";$3)%"'%
+55*373).$&&"6")'%./()%&(<"'1%
%

Université de Montréal
3URJUDPPHLQWpJUpSRXUSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶XQ
trouble concomitant de psychose et toxicomanie :
contribution des ergothérapeutes
par
Gisèle Séguin
3URJUDPPHG¶HUJRWKpUDSLHeFROHGH5pDGDSWDWLRQ
Faculté de Médecine
Travail dirigé présenté à la Faculté des études supérieures
HQYXHGHO¶REWHQWLRQGXJUDGHGH0DvWULVH
en ergothérapie
décembre, 2009
© Gisèle Séguin, 2009

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales
Ce travail dirigé intitulé:
3URJUDPPHLQWpJUpSRXUSHUVRQQHVDWWHLQWHVG¶XQWURXEOHFRQFRPLWDQWGHSV\FKRVHHW
toxicomanie : contribution des ergothérapeutes
Présenté par :
Gisèle Séguin
a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Catherine Briand, directrice de recherche
Alexandre Dumais, examinateur externe

i
Résumé
Contexte : 6XLWHjO¶pFKHFGHVDSSURFKHVWUDGLWLRQQHOOHVSRXUWUDLWHU les individus souffrant
G¶XQ WURXEOH FRQFRPLWDQW GH SV\FKRVH HW WR[LFRPDQLH, les programmes de traitements
intégrés constLWXHQW DXMRXUG¶KXL O¶DSSURFKH GH SUpGLOHFWLRQ SRXU WUDLWHU FHWWH FOLHQWqOH
Toutefois, aucun ergothérapeute ne figure parmi les intervenants traditionnellement
impliqués dans ces programmes. Le but de cHWUDYDLOHVWGRQFGHGpWHUPLQHUO¶LPSOLFDWLRQ
potHQWLHOOHGHO¶HUJRWKpUDSHXWHGDQV les programmes de traitements intégrés.
Objectifs : 1) Définir en quoi consiste un programme intégré et quelles sont les
composantes essentielles à sa mise en place. 2) Documenter et décrire les meilleures
«interventions» et/ou pratiques à incorporer dans le programme intégré. 3) Documenter les
PRGqOHVHWLQWHUYHQWLRQVHQHUJRWKpUDSLHDILQGHGpWHUPLQHUOHVTXHOVSRXUUDLHQWV¶DUULPHU
DYHFO¶DSSURFKHLQWpJUpH.
Méthodologie : Le guide des meilleures pratiques pour les troubles de santé mentale et
G¶DOFRROLVPHHWGHWR[LFRPDQLHDLQVLTXHOHOLYH
Intregrated treat
m
ent for dual disorders
ont servi de base pour ce travail. Une recension de la littérature de 1996 à 2009 a été
réalisée dans la base de données Pubmed pour les objectifs #1 et #2. Puis, afin de répondre
au troisième objectif, une investigation jO¶DLGHGXPRWHXUGHUHFKHUFKH$WULXPHWXQHUHYXH
des documents reçus pendant le cursus universitaire ont été effectuées.
Résultats : 1) La définition et les composantes du programme intégré ont été décrites à
partir des écrits de Mueser. /¶HQWUHYXHPRWLYDWLRQQHOOHHQFRPELQDLVRQDYHFODWKpUDSLH
cognitive-comportementale HVWO¶DSSURFKHSV\FKRVRFLDOHjSUpFRQLVHUDYHFFHWWHFOLHQWqOH
/H PRGqOH GH O¶RFFXSDWLRQ KXPDLQH DLnsi que le processus de remotivation peuvent
V¶DUULPHUIDFLOHPHQWDYHFOHSURJUDPPHLQWpJUp /¶LQWpJUDWLRQGHVUpVXOWDWVa été présentée
via une vignette clinique.
Conclusion : Les rôles des ergothérapeutes en santé mentale, la philosophie sous-jacente à
OHXU SURIHVVLRQ DLQVL TXH OHV PRGqOHV HW DSSURFKHV SURSUHV j FHWWH SURIHVVLRQ V¶DUULPHQW
parfaitement au programme intégré élaboré par Mueser. Toutefois, actuellement, plusieurs
EDUULqUHVIUHLQHQWO¶LPSODQWDWLRQGHFHWWHDSSURFKHLQWpJUpH
Mots-clés du titre : Programme intégré, trouble concomitant, psychose, toxicomanie,
ergothérapeutes
Autres mots-clés : SURFHVVXVGHUHPRWLYDWLRQPRGqOHGHO¶RFFXSDWLRQKXPDLQHHQWUHYXH
motivationnelle, thérapie cognitive-comportementale, santé mentale, troubles mentaux

ii
Table des matières
Liste des tableaux .................................................................................................................... iv
Liste des abréviations ............................................................................................................... v
Remerciements ........................................................................................................................ vi
Introduction ........................................................................................................................... 1-3
Chapitre 1: Méthodologie ..................................................................................................... 4-7
Définir en quoi consiste un programme intégré et quelles sont les composantes
essentielles à sa mise en place ........................................................................................... 4
Documenter et décrire les meilleures "interventions" et/ou pratiques à incorporer dans
le programme intégré ......................................................................................................... 6
Documenter les modèles et interventions en ergothérapie, afin de déterminer lesquels
pourraient s'arrimer avec l'approche intégrée .................................................................... 7
Chapitre 2: Résultats .......................................................................................................... 8-32
Résultats relatifs à l'objectif 1: Définir en quoi consiste un programme intégré et
quelles sont les composantes essentielles à sa mise en place ................................... 8
Définir un programme intégré ........................................................................................ 8
Les composantes essentielles du programme intégré..................................................... 9
Le partage de décision ...................................................................................... 10
1. L'intégration des services ............................................................................. 10
2. Comprehensiveness ...................................................................................... 11
3. Approche
outreach
ou
assertiveness
............................................................ 12
4. Réduction des méfaits ou des conséquences négatives ................................ 13
5. Engagement à long terme ............................................................................. 13
6. Traitement basé sur la motivation ................................................................ 14
7. Modalités psychothérapeutique .................................................................... 17
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
1
/
77
100%