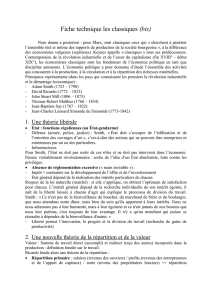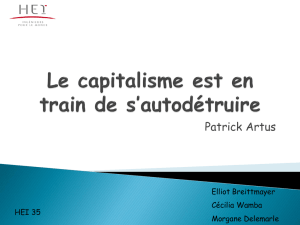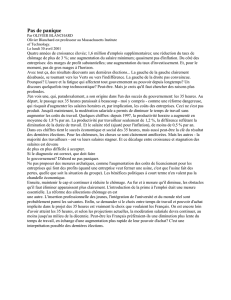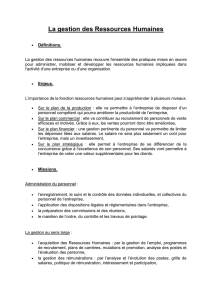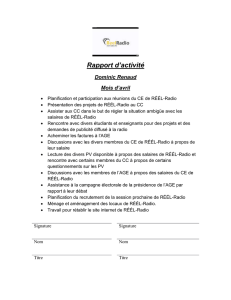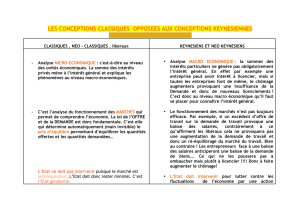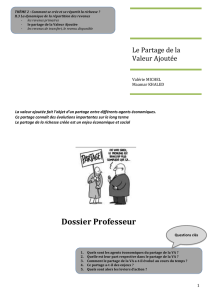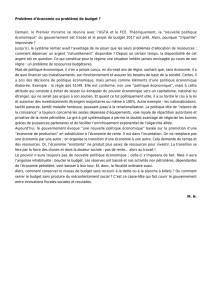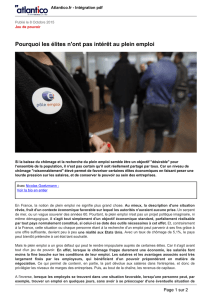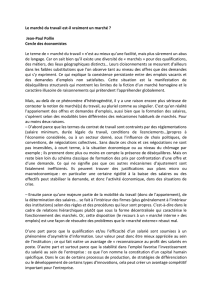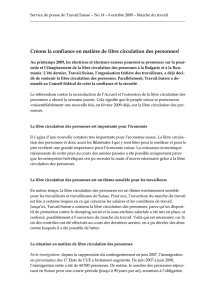Caractéristiques propres à certains marchés

12
Caractéristiques propres à
certains marchés
L’étude des marchés aux trois chapitres précédents est restée très générale, en ce
sens que, mise à part la distinction entre produits et facteurs, elle ne repose en rien
sur ce que sont, matériellement, les biens économiques échangés. Or la nature de
ces biens joue un rôle, elle aussi, dans la manière dont leurs marchés respectifs
fonctionnent et évoluent au cours du temps.
Le but de ce chapitre est d’examiner, du point de vue de ce que l’on échange,
quelques grandes catégories de marchés, afin de repérer leurs caractéristiques
propres, et de mieux les comprendre à la lumière des principes généraux qui ont
précédé. Nous passons ainsi de l’analyse économique « pure » à l’analyse
« appliquée ».
•La section 12.1 distingue quatre types différents de marchés de produits, sur la
base de caractéristiques qui entraînent des différences importantes dans leurs
fonctionnements respectifs.
•La section 12.2 considère divers aspects des nombreuses formes que prennent
les marchés du travail, parmi lesquels le processus des négociations collectives,
l’institution de la sécurité sociale, et surtout le phénomène du chômage, qui reçoit
ici une définition microéconomique rigoureuse.
•La section 12.3 est consacrée aux marchés du capital financier, appelés aussi
marchés des capitaux. On y montre comment, à la bourse des valeurs, les instruments
de financement des entreprises que sont les actions et les obligations sont émis (marché
primaire) et échangés (marché secondaire), ainsi que ce qui en découle pour
comprendre les déterminants fondamentaux des cours boursiers.
•La section 12.4 traite des marchés des ressources naturelles et des «rentes» qui
s’y forment en raison des particularités de l’offre de ces biens.
•Enfin, la section 12.5 développe les thèmes plus généraux du niveau des profits
et de leur «rabotage» par le processus compétitif.

234 PARTIE I ANALYSE MICROÉCONOMIQUE
Figure 12.1 La distribution
Section 12.1
Les marchés des produits
§1 Biens stockables et biens non stockables
a Les biens stockables et la distribution
Les biens stockables sont ceux pour lesquels l’activité de production et celle de
consommation peuvent être séparées dans le temps.
Ils font alors l’objet de stockage, qui peut être considéré lui-même comme une
activité de production : en effet, il requiert des inputs (hangars, surveillance, énergie
pour maintenir une température donnée, etc.) ; et ses outputs sont alors les biens
stockés remis en bon état en fin de période. En fonction du caractère du bien, par
exemple périssable, les coûts de stockage varient considérablement.
Une caractéristique des biens stockables est que leurs marchés sont fractionnés
en un nombre de lieux géographiques distincts. Une forme typique de ce fraction-
nement est donnée par la distinction bien connue entre marchés de gros et de
détail.
Sur la figure 12.1 le premier graphique représente le marché de gros, où l’offre
Op est celle des producteurs et la demande Dd est celle des détaillants ; le second
graphique est le marché de détail, où l’offre Od provient des mêmes détaillants et la
demande Dc, des consommateurs. L’offre des détaillants se construit à partir de
l’offre des producteurs, égale à la somme « horizontale » de leurs coûts marginaux
(cf. chapitre 5), augmentée des coûts propres des détaillants (transport et stockage).
De la même manière, la demande des détail-
lants sur les marchés de gros se construit à
partir de celle des consommateurs sur les
marchés de détail.
Il résulte de cette distinction que pour un
même produit, la formation de son prix sur
les marchés de détail ne se fait pas nécessaire-
ment de la même manière que sur les marchés
de gros : chaque stade intermédiaire (et il peut
y en avoir plus de deux) est susceptible de
présenter des structures propres (concurren-
tielles, oligopolistiques ou monopolistiques),
des rationnements propres, voire des barrières
à l’entrée différentes.
L’ensemble des marchés successifs d’un
même bien constitue ce que l’on appelle
E
U
R
O
S
E
U
R
O
S
MARCHÉ DE GROS MARCHÉ DE DÉTAIL
0qe
pg
Op
Dd
Dc
0qe
pd
Op
Dc
Od
qq
12.1

CHAPITRE 12 CARACTÉRISTIQUES PROPRES À CERTAINS MARCHÉS 235
habituellement le secteur de la « distribution» de ce bien. Au sein de celle-ci, une
partie importante des activités de stockage s’explique par la connaissance incertaine
qu’ont les distributeurs du niveau de la demande finale. Selon que leurs prévisions
se réalisent ou pas, il y aura stockage ou déstockage (avec à la limite la «rupture de
stock », situation de rationnement des acheteurs clients de la firme). On voit ainsi
que les stocks permettent d’atténuer ou réduire les rationnements; en fait, ils
contribuent à une meilleure adéquation de l’offre à la demande.
Par ailleurs d’autres activités de stockage sont motivées par des objectifs de
spéculation : celle-ci consiste à acheter ou vendre un bien dans l’intention exclusive
de faire l’opération inverse après quelque temps, en vue de bénéficier de la variation
du prix susceptible de survenir pendant cette période. Bien des économistes
défendent la thèse que la spéculation atténue, quant à elle, les fluctuations de prix;
mais cette thèse est controversée : quoique fondée sur une application stricte de la
loi de l’offre et de la demande, son degré de vérification varie très fort d’un marché
à l’autre.
b Les biens non stockables ou « services »
Les biens non stockables, aussi appelés services, ont pour caractéristique que la
capacité de production (c’est-à-dire le producteur lui-même, et ses inputs) doit
être disponible au moment même où la demande se manifeste.
Si cette condition n’est pas remplie, il y a automatiquement rationnement des
demandeurs. Graphiquement, cela signifie que la demande des consommateurs
rencontre directement la courbe d’offre des producteurs (elle-même égale à leur
coût marginal) sans l’intermédiaire de distributeurs ou détaillants.
Lorsqu’il y a rationnement des demandeurs par indisponibilité d’une capacité
suffisante, le rationnement prend diverses formes, selon le type d’industrie en
cause : le cas extrême est celui de la coupure du service (électricité), mais des cas
intermédiaires sont par exemple l’encombrement (réseau téléphonique) et les files
d’attente (service au guichet dans une banque). Le rationnement se traduit ici par
une dégradation de la qualité du service.
D’autre part, il y a rationnement des offreurs si, pour le niveau auquel la demande
s’exprime, la capacité est excédentaire. Ainsi par exemple, dans le cas d’un salon de
coiffure installé avec dix fauteuils et un personnel en nombre suffisant pour servir
dix clients à la fois, s’il n’y a jamais que six clients en même temps dans le salon.
« Surcapacité» et rationnement de l’offreur sont ici synonymes.
En cas de rationnement d’un côté ou de l’autre du marché, les variations de prix
(du type de celles étudiées plus haut) sont fréquemment employées comme moyens
de le réduire : tarifs de jour plus élevés que ceux de nuit en électricité et au télé-
phone; loyers plus élevés « en saison » que « hors saison» pour les locations de
villas de vacances, pour les transports ou pour les spectacles, etc. Ces cas illustrent
particulièrement bien en quoi les variations du prix d’un bien ou service (qui par
ailleurs reste le même) peuvent avoir pour rôle de remédier aux rationnements.
12.2

236 PARTIE I ANALYSE MICROÉCONOMIQUE
§2 Biens durables et non durables
a Les biens non durables
Les biens non durables sont caractérisés par le fait que l’activité de leur consom-
mation entraîne immédiatement leur disparition, ou leur transformation en biens
distincts.
Pour les biens de ce type qui sont nécessaires à l’existence, cette caractéristique
implique que les achats se répètent dans le temps ; ils sont donc fréquents. De ce
fait, l’information des consommateurs sur la nature et la qualité des produits est
acquise par eux quasi automatiquement, grâce aux essais successifs (par exemple :
biens alimentaires). La condition d’information parfaite de la concurrence tend
donc à se réaliser, non pas dans l’instantané mais par un processus d’apprentissage
au fil du temps.
b Les biens durables
Les biens durables sont caractérisés par le fait que leur consommation, qui est
surtout une « utilisation», n’entraîne pas immédiatement leur disparition.
Le plus souvent, ils se détériorent néanmoins, soit sous l’effet de l’usure (perte de
leurs propriétés physiques d’origine) ou de l’obsolescence (désuétude technique
due au fait que le progrès amène sur le marché de nouveaux produits remplissant
le même rôle — c’est-à-dire satisfaisant le même besoin — mais de manière plus
efficace).
Du fait de leur durabilité, ces biens font l’objet d’achats qui sont moins répétitifs
et fréquents que les biens non durables; de ce fait, les consommateurs sont moins
bien informés — par leurs achats — sur les mérites et qualités des diverses marques
concurrentes : ils ont donc besoin d’autres sources d’information que celle de leur
propre utilisation, et cela explique en partie l’importance de la publicité pour
certains biens de ce type (appareils électroménagers, voitures…), ainsi d’ailleurs
que l’activité des associations de consommateurs.
D’autre part, la durabilité de ces biens entraîne aussi le développement des
marchés d’occasion. Les relations qui existent entre marché du neuf et marchés de
l’occasion peuvent être analysées formellement en distinguant plusieurs graphiques
d’offre et de demande, parmi lesquels le premier représente le marché du neuf, et
les autres représentent les occasions en fonction de leur âge; et en considérant que,
du côté des demandes, le degré de vétusté joue un rôle semblable à celui de la
différenciation des produits. Du côté des offres, si celle du marché du neuf
est déterminée par les coûts de production, celles des marchés d’occasion sont
déterminées par les quantités produites antérieurement, et le désir des propriétaires
de se défaire de leur bien.
12.3
12.4

CHAPITRE 12 CARACTÉRISTIQUES PROPRES À CERTAINS MARCHÉS 237
Section 12.2
Les marchés du travail
§1 Formes et implications de l’hétérogénéité du travail
a Autant de marchés que de professions
Davantage que le capital physique ou financier, le travail est par nature un bien
très hétérogène, dans la mesure où l’on doit tenir compte de la multitude des
activités, et de la variété des aptitudes et des compétences individuelles. Pour chaque
type de travail, il faut donc considérer un marché distinct : celui des maçons, celui
des comptables, des informaticiens, des infirmières, des avocats, etc.
b La mesure du travail
À cette hétérogénéité entre les types de travail s’ajoute celle des méthodes par
lesquelles on mesure les quantités de travail. Souvent on mesure celles-ci en
nombre d’heures (ou de jours, ou de mois) prestées ; c’est ce que nous avons fait
au chapitre 7. Mais souvent aussi on les mesure en unités d’output obtenus (nombre
de pièces par unité de temps). Cette différence a une implication quant à la forme
de la rémunération : salaire horaire (journalier, mensuel,…) dans le premier cas,
salaire à la pièce, au pourcentage ou « forfaitaire» (devis) dans le deuxième cas.
Notons que la forme de rémunération choisie implique le report de l’incertitude,
quant à l’effort nécessaire et au résultat du travail, sur le travailleur lui-même dans
le deuxième cas, et sur l’entreprise ou l’employeur dans le premier cas.
c Travail indépendant et travail dépendant
Enfin, on retrouve une considérable hétérogénéité au niveau du statut des travail-
leurs. On distingue généralement (1) le travailleur indépendant qui, travaillant
pour lui-même, doit être vu comme étant simultanément offreur et demandeur
de travail ; sa rémunération est en fait assurée par le prix auquel il vend son output;
et (2) le travailleur dépendant, ou salarié, qui, lié par un contrat à un demandeur
de travail, voit sa rémunération fixée à l’avance, sur base de la valeur de son output
(sa productivité marginale en valeur) telle qu’elle est présumée par l’employeur.
§2 La formation des salaires du travailleur dépendant
a Selon la loi de l’offre et de la demande, en concurrence
Dans chaque profession, le salaire sur le marché résulte de la rencontre entre l’offre
totale de travail, composée de la somme des offres individuelles des travailleurs
(chapitre 7), et la demande totale de travail, semblablement composée des
demandes individuelles provenant des employeurs (chapitre 5).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%