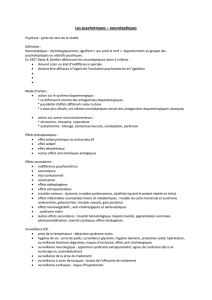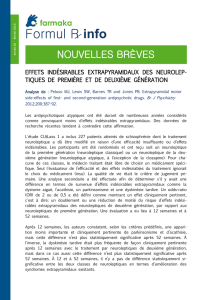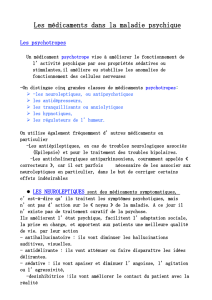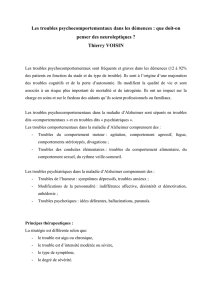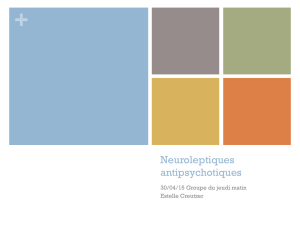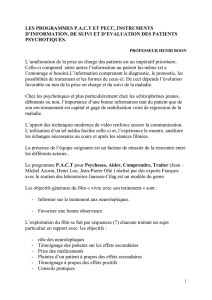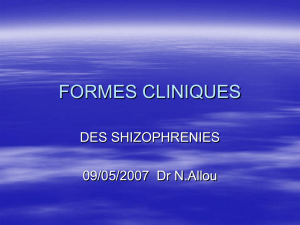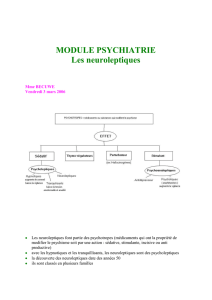Télécharger cet article en PDF

Psychiatries dans l’histoire, J. Arveiller (dir.), Caen, PUC, 2008, p. 241-248
NEUROLEPTIQUES ET PARKINSONISME.
Une conviction scientifique erronée
et ses vraies implications psychopathologiques
Dans la présente communication, j’évoquerai une page de l’histoire des médications
antipsychotiques qui, en tant que «conviction scientifique » qui s’est avérée par la suite
erronée, a joué un certain rôle dans la constitution de leur identité thérapeutique et
a eu d’importants prolongements dans l’exploration et l’approfondissement psycho-
pathologique de leurs effets thérapeutiques. Cette « conviction scientifique erronée » a
trait à leurs effets secondaires somatiques, et plus particulièrement neurologiques, et
peut s’énoncer comme suit : « les effets neurologiques des neuroleptiques, et notam-
ment le parkinsonisme, sont nécessaires au développement des effets thérapeutiques
de ces médicaments ».
Naissance et propagation d’une conviction scientifique
Comment va naître cette conviction scientifique ?
On sait ce que la découverte du premier antipsychotique doit à l’empirisme de l’ob-
servation clinique, et même au hasard : la chlorpromazine était au départ une phéno-
thiazine dont les effets antihistaminiques, en traitement préopératoire, pourraient
être utiles pour potentialiser l’action des anesthésiques. Laborit, qui a été le premier
à utiliser la molécule dans ce sens, a publié ses observations en février 1952, en souli-
gnant que ce « nouveau stabilisateur végétatif » utilisé en anesthésiologie pourrait avoir
des applications psychiatriques du fait d’un effet de « désintéressement du malade
pour ce qui se passe autour de lui ». Il n’est pas sans importance, pour notre propos
d’aujourd’hui, de rappeler que la toute première communication sur l’utilisation du
nouveau produit en psychiatrie, signée de Hamon et de ses collaborateurs du Val-de-
Grâce (1952), ne concerne pas des cas de schizophrénie ou de psychose mais bien un
cas de manie. Compte tenu du caractère central du syndrome psychomoteur dans cette
pathologie, on peut y voir déjà la prémonition de l’importance qui sera accordée aux
effets neurologiques moteurs dans le développement des effets thérapeutiques de la
nouvelle classe de molécules.
Les premières publications de monothérapie à la chlorpromazine seront signées,
trois mois après la publication de Hamon, par Delay et Deniker (1952) sur une qua-
rantaine de cas cliniques qui, eux non plus, ne concernent pas majoritairement des

242 Vassilis Kapsambelis
psychoses chroniques : il s’agit surtout d’états d’agitation et d’excitation, de manie,
de bouffée délirante et de confusion mentale. D’emblée, les auteurs souligneront le
« syndrome d’indifférence psychomotrice », effet clinique central de la nouvelle molé-
cule, bien avant que des termes comme effet « antidélirant » ou « antihallucinatoire »
ne soient prononcés.
C’est donc dans la suite logique de ces premières observations et publications que
les termes qui vont caractériser la nouvelle classe de médicaments évoqueront princi-
palement l’effet psychomoteur : soit d’un point de vue clinique (« effet sédatif », «effet
ataraxique »), soit directement d’un point de vue neurologique et neurophysiologi-
que : médicaments « ganglioplégiques » (c’est-à-dire impliquant les noyaux gris cen-
traux), ou encore « neurolytiques » ou « neuroplégiques », chaque terme renvoyant à
ce même effet de « prise sur les nerfs ». C’est cette même conception qui aboutira au
terme de « neuroleptique » qui finira par s’imposer pendant des décennies, d’autant
plus que, à partir de 1954-1955, Delay et Deniker décriront avec précision ce qu’ils appel-
lent déjà le « parkinsonisme thérapeutique » induit par les neuroleptiques et son impli-
cation dans le processus thérapeutique.
Enfin, en 1957, à partir des similitudes entre certains effets des neuroleptiques et
les manifestations décrites après la Première Guerre mondiale dans les suites de l’en-
céphalite léthargique, Delay et Deniker consolident leur conviction que les effets thé-
rapeutiques des neuroleptiques sont inséparables des modifications psychomotrices,
neurologiques qu’ils peuvent engendrer. Ils rejoignent en cela une hypothèse largement
présente chez les auteurs du milieu du siècle, dont notamment Paul Guiraud, selon
laquelle les troubles de la schizophrénie impliquent des dérèglements sous-corticaux ;
c’est ce que soutient également Steck, de Suisse, dans une publication de 1954 dans les
Annales médico-psychologiques. Delay et Deniker peuvent donc, en mai 1957 au congrès
de Milan, présenter les « caractéristiques psychophysiologiques des neuroleptiques »
en cinq points, qui resteront longtemps classiques, et dont quatre comportent une réfé-
rence directe à leur effet moteur : 1) la création d’un état d’indifférence psychomotrice
(la lenteur des mouvements, l’amimie, l’indifférence psychique, la neutralité émotion-
nelle) ; 2) l’effet clinique consécutif sur les états d’excitation et d’agitation ; 3) la réduc-
tion progressive de troubles psychotiques aigus et chroniques (seule référence à un
effet directement antipsychotique) ; 4) la production de syndromes extrapyramidaux,
et 5) les effets sous-corticaux dominants, impliquant notamment le diencéphale et la
substance réticulée, et rendant compte des effets neurologiques précédemment cités.
La propagation de la conviction scientifique qui nous préoccupe ici sera très rapide.
Les deux premières publications nord-américaines concernant la chlorpromazine
apparaissent dans les Archives, signée de Lehmann, en février 1954, et dans l’American
Journal of Psychiatry, signée de Kinross-Wright, en juin 1955. Leur contenu est carac-
téristique : Lehmann présente la chlorpromazine comme un nouvel inhibiteur de l’ex-
citation psychomotrice, notamment dans les états maniaques ; Kinross-Wright décrit
la chlorpromazine comme une molécule efficace dans le contrôle de l’excitation psy-
chomotrice de toute origine, alors même qu’il note l’amélioration de la communication
et la diminution de la désorganisation idéo-affective chez les patients schizophrènes ;

Neuroleptiques et parkinsonisme… 243
il conclut que le mode d’action du médicament est sous-cortical. Goldman en 1957,
puis Hasse en Allemagne et Fluegel aux États-Unis, en 1959, soutiennent que le syn-
drome parkinsonien doit être considéré comme une « condition préalable » (a prere-
quisite), une conditio sine qua non pour obtenir des résultats thérapeutiques. Goldman
écrit en 1955 : « Mon opinion est que le parkinsonisme ne doit pas être considéré comme
un effet toxique des neuroleptiques », au sens d’un effet secondaire, latéral, car il cons-
titue l’élément central à partir duquel les effets thérapeutiques sont produits. Au congrès
de Montréal de novembre 1960, intitulé « Système extrapyramidal et neuroleptiques »,
cette question est discutée à fond. Comme la plupart des participants, Lambert et Brous-
solle soutiennent qu’il existe une « relation de contiguïté entre activité thérapeutique
et syndrome extrapyramidal » ; d’autres, plus prudents comme Cole et Clyde, avancent
l’hypothèse qu’une partie de la propension à produire des effets extrapyramidaux peut
être associée à l’activité thérapeutique, mais que la production de tels effets dans un
plus grand pourcentage n’améliore pas nécessairement la réponse thérapeutique.
Enfin, un autre aspect de cette conviction scientifique sera la non-acceptation de
molécules qui, bien qu’ayant des effets antipsychotiques attestés par la pratique, ne
développent pas d’effets extrapyramidaux. Hippius a décrit avec humour, en 1989, les
paradoxes qui ont entouré le cheminement d’une molécule comme la clozapine : uti-
lisée pour la première fois au milieu des années 1960 comme potentiellement antidé-
pressive, elle a fait preuve de bons résultats antipsychotiques, mais elle s’est heurtée
au « dogme psychopharmacologique » selon lequel les effets extrapyramidaux vont
de pair avec l’efficacité antipsychotique – or, la nouvelle molécule n’avait pas d’effets
extrapyramidaux ! Tant et si bien que, pendant des années, le laboratoire qui avait syn-
thétisé le produit a différé la décision de sa commercialisation, et ce, jusqu’à ce que
l’apparition d’effets secondaires hématologiques mette fin à cette première période
de la vie de la clozapine. Il s’agit peut-être d’un des rares cas où un médicament n’est
pas mis sur le marché par son découvreur, non pas parce qu’il n’est pas assez efficace,
mais parce qu’il n’a pas suffisamment d’effets indésirables.
Le processus psychopathologique
Il serait erroné de penser que la conviction scientifique dont nous suivons le parcours
n’a pas connu de contradicteurs. Dès 1959 Freyhan déclare que ses propres résultats
ne corroborent pas la conviction (belief) que le parkinsonisme, par le simple fait qu’il
survient, contribue au développement d’effets thérapeutiques favorables. Il fait remar-
quer avec bon sens que le syndrome neurologique ne se manifeste pas avec la même
fréquence chez les hommes et chez les femmes, alors qu’il n’y a pas de différence de
genre dans les résultats thérapeutiques…
Toutefois, si les psychiatres impliqués dans la recherche, et plus encore sans doute les
fondamentalistes, pensaient (bien qu’il n’y eût peut-être pas, après tout, de raison théo-
rique bien solide pour considérer que des pathologies directement liées à la pensée
humaine comme les psychoses seraient en rapport avec une maladie neurologique de la

244 Vassilis Kapsambelis
motricité comme la maladie de Parkinson), qu’il y avait bien une raison – certes moins
scientifique, mais tout aussi solidement ancrée dans la pratique – pour considérer la liai-
son entre parkinsonisme et effets antipsychotiques comme évidente ; et cette raison était
que les cliniciens et praticiens de terrain observaient tous les jours, dans le quotidien de
leur pratique, la liaison entre effets thérapeutiques et effets secondaires neurologiques.
Mais qu’est-ce qu’ils observaient ? Ils observaient des patients qui étaient admis
dans leurs services dans un état délirant et hallucinatoire aigu. Leur agitation était sou-
vent extrême, leur verbe haut et prolixe. Ils étaient entourés d’excitations sensorielles
de toute sorte, aussi bien celles que nous partageons tous, de notre réalité extérieure
commune, que celles que fabrique l’activité hallucinatoire. Happés par le bombarde-
ment sensoriel environnant, saisis par la multitude des sensations qui les submergeaient,
ils parlaient sans cesse des expériences qu’ils vivaient, ils décrivaient comment tout,
autour d’eux, devenait signe – un signe qui leur était personnellement destiné : les cou-
leurs des voitures qui passaient, le vol des oiseaux, le regard des passants, les annonces
du métro, les questions de l’interlocuteur médical et soignant prenaient immédiate-
ment un sens particulier, les investissaient d’une mission spéciale, les unissaient au
monde des humains et des choses qui les entouraient par des liens d’amour ou de haine,
de passion et de persécution, qui constituaient pour eux une formidable force motrice.
De ce fait, ils n’avaient de cesse que de se mouvoir, ils étaient agités et parfois agressifs,
et pouvaient parcourir des kilomètres de quête exaltée dans un état de complet désin-
térêt de soi, sans être conscients de la faim, de la soif, de la fatigue et du manque de
sommeil, avant que les soins ne leur soient imposés.
Mis sous les nouveaux médicaments, ces patients s’apaisaient progressivement
dans un sens très particulier. L’agitation progressivement régressait, le sommeil reve-
nait, ainsi que la sensation de la faim – et d’ailleurs très vite les psychiatres de l’épo-
que observeront des conduites d’hyperphagie, voire de boulimie. Une indifférence par
rapport au monde environnant s’installait progressivement, qui semblait aller de pair
avec la réduction, puis l’extinction de l’activité hallucinatoire. On dirait que, de la même
façon que leur psychisme au moment de la crise ne faisait pas de différence entre sti-
mulation sensorielle extéroceptive et activité hallucinatoire, de la même façon l’indiffé-
rence par rapport aux stimulations extérieures s’associait à la diminution de l’activité
hallucinatoire, comme si cette dernière, prise pour une activité d’origine « externe »,
suivait jusqu’au bout le destin des autres stimulations d’origine externe. Ainsi, leur
débit verbal et leur prolixité sous traitement neuroleptique diminuaient au cours des
entretiens, ces derniers devenant de plus en plus pauvres, les patients étant de moins
en moins intéressés par ce qui les entourait et par ce qui leur était dit.
Cependant, cette indifférence pour le monde extérieur n’était pas pour autant une
indifférence complète. En effet, la plupart des auteurs de l’époque avait remarqué le
parallélisme entre deux processus: d’une part, la baisse de l’activité délirante et halluci-
natoire, et plus généralement l’intérêt pour le monde extérieur et ses stimuli ; d’autre
part, le développement progressif de préoccupations de plus en plus pressantes con-
cernant le corps et son fonctionnement (le blocage moteur, le tremblement, mais aussi
la constipation, la sécheresse de la bouche, etc.). Certains auteurs, comme Kammerer

Neuroleptiques et parkinsonisme… 245
et ses collaborateurs en 1965, avaient même noté que les manifestations motrices dues
aux neuroleptiques formaient de véritables « pantomimes délirantes » : « Tout se passe
comme si ce nouvel état psychomoteur était utilisé par le malade pour exprimer son
délire et comme si son corps, dans son nouvel équilibre moteur et tonique, était vécu
comme un milieu expressif plus riche ». Lanter et Heinrich rapportent, dans les Anna-
les médico-psychologiques de 1960, leurs observations à partir du traitement d’états
maniaques par neuroleptiques et concluent que les manifestations motrices peuvent
être considérées comme une «véritable névrose psychomotrice de substitution», abréac-
tion des troubles psychotiques. On peut trouver des remarques assez semblables dans
certains articles de Pierre Deniker qui, avec l’acuité du regard clinique qui le caracté-
risait, remarquait que certaines manifestations dyskinétiques aiguës étaient difficile-
ment explicables par le seul effet neurophysiologique des neuroleptiques, tant et si
bien qu’il jugeait légitime de les qualifier d’« hystériformes », s’accompagnant d’an-
goisse intense et cédant par suggestion.
Bref, ce que les cliniciens et praticiens observaient dans le quotidien de leur pra-
tique, et qui corroborait à leurs yeux la conviction scientifique que nous étudions,
était que les effets secondaires neurologiques semblaient se développer en lieu et place
de l’activité délirante et hallucinatoire, comme s’ils en prenaient le relais. C’est cette
observation, me semble-t-il, qui soutenait la nécessité de la liaison thérapeutique entre
effets antipsychotiques et effets neurologiques. Et cette liaison n’était pas seulement « glo-
bale », comme un fait de constatation empirique, mais allait même plus loin, précisant
et catégorisant les sous-liaisons qui le fondaient. Ainsi, par exemple, Conté décrit en
1963 certaines formes de corrélation entre les différents syndromes extrapyramidaux
et les mutations psychiques sous traitement neuroleptique : l’akinésie va de pair avec
le ralentissement de l’idéation, l’indifférence affective (« neutralité émotionnelle ») et
la stagnation des pensées ; le syndrome akinéto-hypertonique s’associe à une indiffé-
rence qui peut devenir stupeur, ou à un sentiment de «vide mental » avec connotation
dépressive de l’humeur.
Hypocondrie et psychoses
En résumant ces observations et hypothèses scientifiques des années 1950 et 1960 à la
lumière de ce que nous savons aujourd’hui, nous pourrions dire: si les effets secondaires
neurologiques ont pu apparaître comme très importants pour le développement des
effets thérapeutiques des neuroleptiques, alors que nous savons maintenant que cette
importance n’est pas fondée au plan physiologique, c’est que le parkinsonisme iatrogène
apparaissait nécessaire au processus thérapeutique, non pas en soi, mais pour ce qu’il
signifiait pour le patient. En d’autres termes, ce qui était en rapport avec le processus
thérapeutique de la psychose aiguë était en fait la qualité particulière de l’investisse-
ment de ce parkinsonisme de la part du patient. On prenait pour nécessité neurophy-
siologique ce qui était un indice des processus et des transformations psychiques, que les
neuroleptiques mettaient en route dans le cadre de leur action thérapeutique.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%