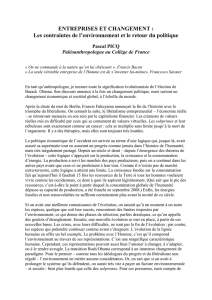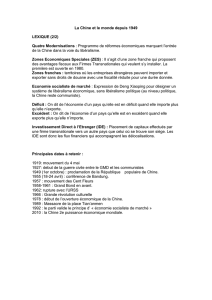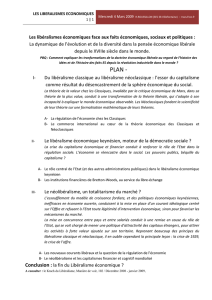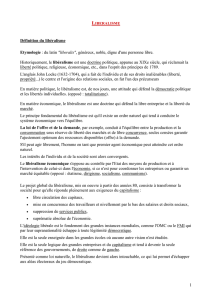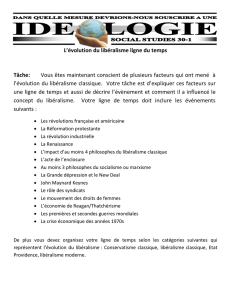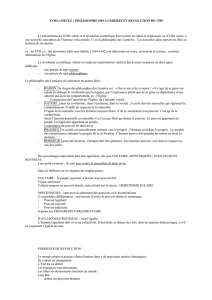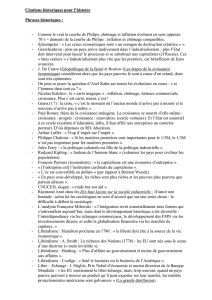Qu`est-ce que le libéralisme ? Le grand récit des

1
Qu’est-ce que le libéralisme ? Le grand récit des origines
Je souhaiterais partir d’une thèse ordinaire, ou d’une certaine figure du « grand
récit » des origines du libéralisme, avant même l’apparition du terme au début du XIXe
siècle1. Avant que le « néo-libéralisme » ne s’impose comme une idéologie et une rationalité
politique, le libéralisme « classique » fut généralement assigné à deux formes distinctes : le
libéralisme politique, souvent défini comme une théorie des droits, une théorie de l’individu
porteur de droits ou de libertés que l’État a pour vocation de protéger ; le libéralisme
économique, comme théorie de l’harmonie spontanée des intérêts particuliers, qui considère
l’intervention de l’État dans l’économie comme potentiellement oppressive, arbitraire et
nocive.
On oppose souvent ces deux formes de libéralisme, pour accorder à l’un ce que l’on
refuse à l’autre : le libéralisme politique aurait eu le mérite d’émanciper l’individu, de le
libérer à l’égard de tutelles religieuses et politiques, d’assurer la liberté de ses activités et de
ses jouissances dans une sphère protégée par le droit. En revanche, le libéralisme
économique, défendant l’autorégulation du marché, la liberté dans la sphère du travail et
des échanges, serait l’auteur de tous les maux (accroissement des inégalités, pillage des
ressources naturelles, soumission de la vie sociale dans son ensemble à la sphère des
rapports marchands et à son exigence de profit). D’un côté, donc, une théorie de la liberté,
à l’origine des droits de l’homme – le gouvernement modéré ou limité, contre la
souveraineté absolue ; de l’autre, une théorie de l’optimisation économique en situation de
concurrence, une doctrine de la liberté des prix et des salaires ajustés selon l’offre et la
demande, une vision optimiste de l’allocation des ressources, à l’origine d’une véritable
faillite. La face brillante de la médaille : Locke en héros des droits naturels de l’individu,
1 Voir Ph. Raynaud, « Libéralisme », in Dictionnaire de philosophie politique, Ph. Raynaud et S. Rials éds.,
Paris, P.U.F., 1996, p. 338-344 ; D. Deleule, « Libéralisme », Dictionnaire européen des Lumières, M. Delon éd.,
Paris, P.U.F., 1997, p. 645-648 ; Ch. Lazzeri, « Libéralisme », Cités, n° 2, 2000, p. 199-206.

2
justifiant le droit de résistance à l’oppression ; ou encore Montesquieu, en apôtre de
l’équilibre et de la distribution des pouvoirs, seul moyen de préserver l’individu de
l’arbitraire. Et son revers : les Physiocrates campés en défenseurs des lois naturelles de
l’économie qui doivent être laissées à elles-mêmes (fût-ce au moyen du « despotisme
légal »), ou encore Adam Smith, formulant dans la Richesse des nations le paradigme de la
« main invisible » : chacun, en recherchant son intérêt propre, contribue sans le savoir ni le
vouloir à la prospérité de la société.
Or cette scission au cœur du « grand récit » des origines est non seulement
problématique, mais, dans une large mesure, illusoire. Sans revenir ici sur le caractère
incertain et protéiforme du « libéralisme avant le libéralisme »2, il convient donc de mettre à
jour un paradoxe : l’idée selon laquelle le libéralisme est une constellation cohérente est
partagée par des auteurs situés sur toute la palette de l’échiquier politique et idéologique. Si
l’on en croit les partisans de l’histoire intellectuelle du libéralisme (dont les représentants
éminents, en France, sont Marcel Gauchet, Pierre Rosanvallon, Bernard Manin, Pierre
Manent et Philippe Raynaud) autant que les tenants d’une généalogie foucaldienne de la
gouvernementalité libérale (Christian Laval, Pierre Dardot, Wendy Brown)3, il est vain
d’opposer un « bon » libéralisme issu de Locke et de Montesquieu, à un « mauvais »
libéralisme, celui de la mystique du marché et de l’individu égoïste et cupide, calculateur
étroit – l’homo œconomicus. Le « grand récit » du libéralisme ne peut opposer ces deux voies
sans se dissoudre. Plutôt que de mettre en regard deux figures intangibles du libéralisme, il
faudrait donc distinguer deux moments historiques qui articulent différemment
l’économique et le politique. Le premier moment court jusqu’aux échos, au XIXe siècle, de
la Révolution Française : dans le « grand récit » des origines, le libéralisme est censé jouer
alors un rôle émancipateur. En revanche, il faut comprendre pourquoi ce rôle émancipateur
s’est retourné, jusqu’à faire du « néo-libéralisme » un pouvoir largement destructeur.
I. La puissance émancipatrice du libéralisme
Que l’on ne puisse si simplement disjoindre le libéralisme politique du libéralisme
économique, la défense de la liberté de l’homme face aux abus de pouvoir et le plaidoyer
contre la régulation dirigiste de l’économie, telle est la doctrine de nombreux historiens du
2 Voir l’introduction de B. Bachofen à Inventions et critiques du libéralisme. Le pouvoir, la personne, la
propriété, B. Bachofen éd., Lyon, ENS Éditions, 2008, p. 7-27.
3 Tous sont bien entendu tributaires de M. Foucault, Naissance de la Biopolitique, Paris, Seuil-Gallimard,
2004. Par ailleurs, P. Rosanvallon a fait partie du séminaire de M. Foucault au Collège de France.

3
libéralisme classique. Bernard Manin a interrogé la pertinence de cette distinction : le
libéralisme économique ne peut faire abstraction de la question de l’ordre politique
souhaitable : la question des limites du pouvoir a été élaborée par le libéralisme économique
autant que par le libéralisme politique. À ce titre, la distinction entre « libéralisme du
marché » (supposant la délimitation des sphères de compétence) et « libéralisme des contre-
pouvoirs » (appelant la division et la distribution des pouvoirs) n’incite pas à briser l’unité
du phénomène libéral. Tous deux font surgir l’idée d’automatisme ou d’équilibre : le simple
jeu de la pluralité (des intérêts, des pouvoirs) produit spontanément une société viable4.
À bien des égards, l’histoire corrobore cette thèse d’une fausse rupture entre les
libéralismes. Locke est donné comme le contempteur de la monarchie absolue et l’ancêtre
du gouvernement limité, mais il est aussi celui qui a ancré dans l’individu le droit naturel à
la propriété. C’est le droit naturel de chacun sur son propre corps, et sur ce qui résulte de
son usage par le travail, qui justifie la limitation du gouvernement, dont la seule raison
d’être est de protéger la propriété (vie, biens, liberté)5. L’exemple de Montesquieu est plus
révélateur encore : prônant la liberté entendue comme opinion que l’on a de sa sûreté, le
philosophe dénonce les risques d’abus de pouvoir. L’Esprit des lois défend les pouvoirs
intermédiaires qui permettent de résister à l’absolutisme ; en même temps, l’ouvrage
critique la politique colbertiste qui combine régulation administrative tatillonne et
protectionnisme agressif, mettant la puissance militaire au service de l’économie et vice versa.
Comme Locke, Montesquieu invoque l’autonomie relative des phénomènes monétaires à
l’égard du politique : toute intervention arbitraire conduit à l’impuissance du prince et à la
misère du peuple. C’est un seul et même combat qui le conduit à dénoncer le
« mercantilisme » et le despotisme6.
À cet égard, les historiens du libéralisme comme Pierre Manent sont formels : les
origines du libéralisme économique et politique peuvent être retracées à partir d’une même
fin, à savoir la critique de l’absolutisme. L’émancipation à l’égard du pouvoir de l’Église et
du pouvoir de Roi s’opère de concert : succédant à l’Ancien Régime, le libéralisme imagine
une toute nouvelle organisation de la vie politique et sociale. À l’arbitraire du pouvoir, à sa
tendance naturelle à l’abus, il oppose la confiance dans les lois immanentes de la société :
4 B. Manin, « Les deux libéralismes : marché ou contre-pouvoirs », Intervention, n° 9, mai-juillet 1984,
p. 10-24.
5 Locke, Le Second traité du gouvernement, trad. J.-F. Spitz, Paris, P.U.F., 1994.
6 Sur ce point, que je ne peux développer ici, je me permets de renvoyer à mes ouvrages : Montesquieu,
Pouvoirs, richesses et sociétés, Paris, P.U.F., 2004 ; Montesquieu et l’émergence de l’économie politique, Paris, Champion,
2006.

4
nul n’est besoin du commandement arbitraire du prince puisque la société civile, dans une
large mesure, est capable de s’autoréguler7. Alors que d’autres interprètes remettent en
cause l’unité originaire du libéralisme, fût-il économique (opposant au libéralisme
physiocratique de l’ordre naturel le libéralisme incitatif et thérapeutique de Hume8), la
théorie de l’unité perdure. Au fond, Locke et Smith s’accorderaient sur l’essentiel : le
caractère autonome de l’économie et la nature instrumentale de l’autorité politique9. Le
désir de produire une explication homogène du libéralisme invite à minorer les divergences
et les ruptures. Pour ses partisans comme pour ses adversaires, il existe un « paradigme »
libéral, associé au langage des droits, dont les dimensions historiographiques et politiques
sont indissociables10.
II. Le « doux commerce » : une utopie libérale?
Dans ce grand récit des origines, une théorie joue un rôle privilégié : celle du « doux
commerce »11. Telle est la voie incarnée par Montesquieu ou James Steuart : l’essor de
l’économie serait porteur, non seulement de prospérité, mais aussi de paix et de liberté
politique. Dans L’Esprit des lois, l’analyse de l’invention de la lettre de change, qui permit de
déterritorialiser les richesses et de soustraire un temps les Juifs à la persécution du pouvoir,
est paradigmatique. Comme le souligne encore P. Manent, l’intérêt des princes ne parle pas
le même langage au temps de Montesquieu et au temps de Machiavel : loin de susciter de
violents « coups d’autorité » destinés à conforter leur pouvoir, la nécessité conseille désormais
aux monarques de modérer leur désir de domination12. Le commerce ayant acquis son
autonomie relative peut influencer en retour les processus politiques, et se présenter
comme un rempart au despotisme. L’intérêt apprivoise le désir de gloire aristocratique ; les
rapports marchands substituent la négociation à la prédation, la régularité à la cruauté. De
Montesquieu à Benjamin Constant, le passage de l’esprit de conquête à l’esprit de commerce
consacre le triomphe des effets pacificateurs de la rationalité intéressée sur la violence
militaire et civile.
7 Voir les travaux de P. Manent (préface à l’anthologie Les Libéraux, Paris, Hachette, 1986) et de
M. Gauchet (préface aux Écrits politiques de Benjamin Constant, Paris, Gallimard, 1997).
8 Voir D. Deleule, Hume et la naissance du libéralisme économique, Paris, Aubier, 1979.
9 P. Manent, Les Libéraux, op. cit., p. 315.
10 Voir J.-F. Spitz, La Liberté politique, Paris, P.U.F., 1995.
11 Sur le « doux commerce », voir A. O. Hirschman, Les Passions et les Intérêts, trad. P. Andler, Paris,
P.U.F., 1997 ; C. Larrère, L’Invention de l’économie, Paris, P.U.F., 1992.
12 De l’esprit des lois, XXI, 20. Voir P. Manent, La Cité de l’homme, Paris, P.U.F., 1997, p. 62-67.

5
La fonction du mythe doit dès lors être cernée. Selon P. Rosanvallon, la notion de
« marché » apparue au XVIIIe siècle renvoie à une problématique de la régulation sociale et
politique13. Le libéralisme économique n’est pas seulement une idéologie accompagnant le
développement des forces productives et la montée de la bourgeoisie ; il ne s’est pas
contenté de traduire l’émancipation de l’économie vis-à-vis de la morale14. L’idée de marché
renvoie à l’histoire intellectuelle de la modernité. Si les théories du contrat social avaient
conçu l’institution autonome de la société, elles présentaient en effet un double écueil :
incapables de penser de façon convaincante la paix entre les nations, elles étaient centrées
sur la question de l’institution plutôt que de la régulation de la société. La représentation de
la société civile comme marché répondrait à ces deux difficultés : la théorie de l’échange
permet de concevoir que les rapports économiques entre les nations, contrairement aux
rapports militaires, constituent un jeu à somme non nulle ; elle rend en outre possible le
traitement simultané et cohérent du problème de l’institution et de la régulation du social.
L’intérêt qui régit les rapports sociaux produit la paix et la liberté. Aussi le doux commerce fut-
il opposé, au XVIIIe siècle, à la dureté des relations de pouvoir : « Montesquieu fut l’un des
premiers à développer ce grand topos libéral dans L’Esprit des lois (1748) : le commerce
adoucit les mœurs et dispose à la paix. Un véritable changement du monde humain se
profilait ainsi pour lui dans cet avènement d’une société de marché. À l’ère des autorités
dominatrices allait succéder celle du règne des mécanismes neutres (ceux du marché), le
temps de l’affrontement entre les grandes puissances allait s’effacer et céder la place à une
période de coopération entre des nations commerçantes »15.
Vision utopique de l’économie ? Encore faut-il comprendre ce qui s’est joué dans
l’attirance pour ce modèle de la société de marché. Le grand récit des origines atteint ici le
sommet de sa narrativité ou l’apothéose de sa romance : le libéralisme répondrait à
l’aspiration à dédramatiser le face-à-face des individus, à dépassionner leurs relations, à
désamorcer la violence virtuelle des rapports de force. Pour P. Rosanvallon, le secret de
l’unité du libéralisme est ainsi décelé : les idées de marché, de pluralisme politique, de
tolérance religieuse et de liberté participent d’un même refus, celui d’accepter un certain
mode d’institution de l’autorité. Partout œuvre un même principe d’autonomie, fondé sur le
refus de la souveraineté absolue16. La thèse est reçue : il existe un lien consubstantiel entre
démocratie et libéralisme. À cet égard, le libéralisme n’est pas seulement une doctrine ; il
13 P. Rosanvallon, Le Libéralisme économique. Histoire de l’idée de marché, Paris, Seuil, 1989, introduction.
14 Voir L. Dumont, Homo æqualis. Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, Paris, Gallimard, 1977.
15 Ibid., p. IV. Je discute cette thèse dans Montesquieu et l’émergence de l’économie politique, op. cit.
16 Ibid., p. VI.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%