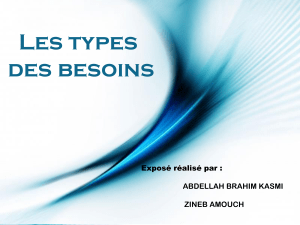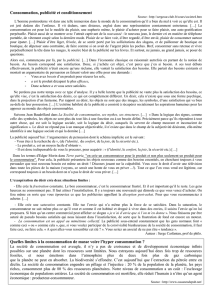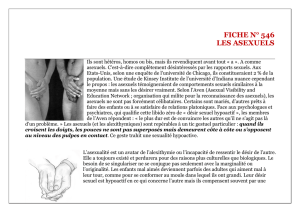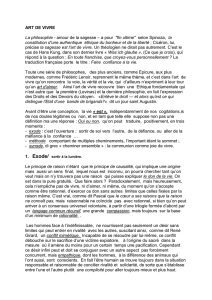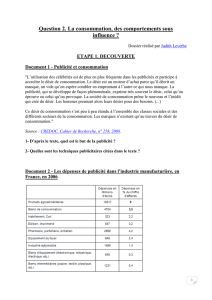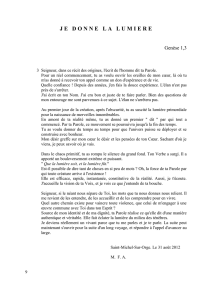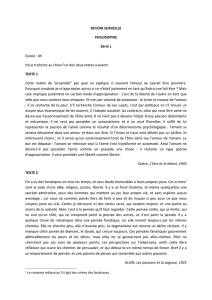Fragments d`un discours amoureux

Bertrand Vaillant - Promotion XXXIX°Φ
AMOUR ET CONDITION HUMAINE
Professeur référent : Madame G. de Chefdebien
29 mars 2010

2
Qu'est-ce que je pense de l'amour? - En somme, je n'en
pense rien. Je voudrais bien savoir ce que c'est, mais, étant
dedans, je le vois en existence, non en essence. (…)
Je suis dans le mauvais lieu de l'amour, qui est son lieu
éblouissant :
« Le lieu le plus sombre, dit un proverbe chinois, est
toujours sous la lampe. »
Roland BARTHES
Fragments d’un discours amoureux

3
Le philosophe et l’artiste ont en commun d’être frappés, lorsqu’ils se
penchent sur la condition présente de l’homme, par l’omniprésence et
l’enchevêtrement du désir, de l’amour, des passions, de l’attirance ou encore de
l’avidité. Là où l’artiste va chercher à reproduire, à manifester, à mettre en lumière,
il appartient au philosophe de chercher à comprendre. Le désir semble en effet à la
fois le plus grand moteur de nos actions et la cause de toutes nos souffrances,
l’amour est à la fois ce que tous recherchent et ce qui noue les tragédies
cornéliennes. L’expérience amoureuse est à la fois très commune et, de l’aveu
général, terriblement complexe. Tous y aspirent, beaucoup y goûtent ou croient y
goûter, mais bien peu revendiquent de le comprendre. Il apparait pourtant si
capital dans la vie humaine que le philosophe ne peut guère faire l’économie d’un
questionnement sur l’amour. Et s’interroger sur l’amour, c’est d’abord s’interroger
sur le désir. Car l’expérience que tous partagent, avant celle de l’amour ou même
celle qu’ils prennent peut-être pour de l’amour, c’est l’expérience du désir. Il
importe donc de voir comment désir et amour s’articulent, et quel rôle peut et doit
jouer l’amour dans une vie humaine emplie par l’expression de nos désirs.
***
Tout homme désire naturellement. Quels que soient les objets désirés, dont
la variété s’étend à l’infini, il appartient à tout homme d’être un désirant, un être
tendu par l’appel impérieux du désir. Devant l’universalité de cette expérience,
nous sommes portés à voir dans cette tension du désir un caractère essentiel de la
condition humaine, sinon de la nature même de l’homme. Le fait ne lui est pourtant
pas propre, et l’animal est mû avant tout par des désirs simples comme la faim ou
la soif. Mais ces désirs sont aisément satisfaits, ils ne sont que l’expression du
conatus, de l’appel de la nécessité à se maintenir dans l’existence. Ils ont un terme
connu et déterminé dans lequel ils trouvent leur apaisement. Et c’est précisément
cet apaisement qui semble échapper à l’homme.
C’est ici qu’intervient l’expérience proprement humaine, celle de
l’insatisfaction. L’homme n’est pas seulement mu par la tension du désir, il est un

4
assoiffé permanent. Son désir ne trouve jamais de terme où s’apaiser, au contraire :
chaque atteinte, chaque acquisition d’un objet désiré ne fait que relancer le désir,
le rediriger, parfois même en en accroissant la force. Nous voulons toujours plus,
toujours autre chose que ce que nous possédons, et ce quel que soit l’état de
pauvreté ou d’abondance dans lequel nous nous trouvons. L’homme vit en
permanence au-delà, en avant de lui-même, il est tendu vers, mais la direction n’est
pas définie. Il marche vers l’horizon. Comme le marcheur, il se fixe des objectifs,
des buts, des étapes où passer la nuit. Mais au fond de lui, il est toujours porté vers
cet horizon qui se dérobe en même temps qu’il croit s’en approcher.
Il est évident que nous n’envisageons pas le désir comme une attraction
vague vers un but plus ou moins flou et indéfini. Le désir se fixe sur des objets
précis, il est toujours désir de quelque chose. Mais le fait est que l’atteinte de ces
buts ne constitue jamais un terme à notre désir, mais au contraire nous projette à
nouveau vers d’autres objets. L’homme ne cesse jamais d’être attiré par le poids de
son désir, incapable de trouver le repos dans ces biens déterminés. « En ces choses
point de repos : elles ne sont pas stables, elles s’écoulent (…) Qui peut les saisir,
même quand elles sont présentes ? » dira Saint Augustin
1
. Le mode d’être de
l’homme est dès lors la poursuite, la recherche, la chasse, la quête. Si
l’insatisfaction est chez l’homme un état de fait, ce n’est pas comme une incapacité
passive et paralysante mais comme un élan dynamique, une course effrénée dans
la quelle le coureur se trouve toujours déjà pris, et n’a de cesse de poursuivre un
but qu’il ne peut jamais atteindre.
Le décalage entre la soif de l’homme et l’incapacité du monde à la combler
semble révélateur d’une dimension supérieure de l’homme. S’il n’était qu’une
partie du monde comme les autres, alors on serait en droit de penser qu’il peut
trouver satisfaction dans les choses qui l’entourent. Mais l’obtention des biens
désirés, dans les faits, creuse le désir lui-même et l’accroit plus qu’elle ne l’apaise,
et celui qui possède ce qu’il désire est plus troublé encore par la crainte de le
perdre, c'est-à-dire par le désir de posséder toujours ces mêmes choses dans
l’avenir. Il semble donc que le désir et l’insatisfaction soient le signe de quelque
chose de plus grand en l’homme. C’est dans cette perspective que la philosophie
1
SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, IV, 10, trad. J. Trabucco, Garnier Flammarion, 1964, p.75

5
médiévale envisage l’insatisfaction, non comme un malheur indépassable avec
lequel il faut composer mais comme un symptôme dont il s’agit de découvrir le
sens.
A l’ « ascèse négative » de la morale épicurienne et stoïcienne s’oppose dès
lors une « ascèse positive », qui n’est plus un abaissement en-deçà du désir mais
une élévation au-delà de lui. « Au lieu de mutiler le désir en niant son objet, elle
comble le désir en lui en révélant le sens. »
2
Le désir semble en effet si
profondément ancré en l’homme qu’il semble vain de le rejeter absolument.
Néanmoins, l’état d’insatisfaction est le signe qu’il y a quelque chose d’autre en
nous que ce désir. En effet, s’il n’y avait en nous que les désirs, on ne voit pas
pourquoi l’homme demeurerait incapable de les satisfaire « dans un univers dont
leur intelligence met les ressources à leur disposition »
3
.
Si chaque objet déterminé, aussitôt possédé, s’avère incapable de nous
satisfaire, c’est que notre désir est infini. Et si même l’abondance la plus
exceptionnelle ne peut tempérer son ardeur, c’est qu’il n’est pas seulement un
désir infini, mais un désir de l’infini. Ce qui se cache derrière l’insatisfaction ne
peut être autre chose que ceci : la capacité infinie de l’homme à aimer. Dirigée vers
des objets finis, elle se heurte à cette finitude et les délaisse. Le désir singulier d’un
objet donné devrait s’apaiser dans sa possession. Si ce n’est pas le cas, c’est que
nous ne sommes pas tant tendus par un faisceau de désirs finis et déterminés,
dirigés chacun vers son objet, que par le pondus d’un amour lui-même infini. Reste
à savoir s’il peut trouver un objet où s’apaiser, ou si l’insatisfaction doit être
comprise non seulement comme le signe de l’amour, mais aussi comme celui de
son échec.
Dès le commencement, la philosophie s’est saisie du problème du désir.
Aussitôt qu’elle est devenue proprement morale, la pensée grecque s’y est
appliquée, et a cherché les moyens d’échapper à l’insatisfaction. Naît alors
l’éthique, qui est avant tout la science et l’art de diriger et de réguler ses désirs.
L’insatisfaction est considérée comme l’état de celui qui n’applique pas ses désirs
aux bons objets, et recherche l’apaisement sans ce qui ne peut le lui apporter. Les
2
E. GILSON, L’esprit de la philosophie médiévale, XIV, Vrin, 1978, p.268
3
Ibid., p.267
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%