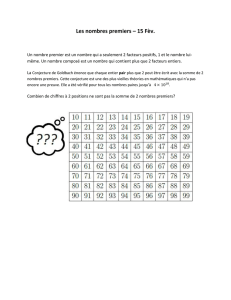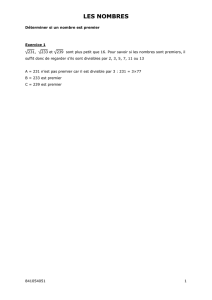combinatoire des mots et probl`emes diophantiens

Boris Adamczewski
COMBINATOIRE DES MOTS ET
PROBL`
EMES DIOPHANTIENS

Boris Adamczewski
CNRS & Institut Camille Jordan, Universit´e Claude Bernard Lyon 1,
21 avenue Claude Bernard, 69622 Villeurbanne cedex France.
E-mail : [email protected]

COMBINATOIRE DES MOTS ET PROBL`
EMES
DIOPHANTIENS
Boris Adamczewski


french 5
R´esum´e. — Le texte qui suit est issu de notes (plutˆot informelles) que j’ai uti-
lis´ees pour pr´eparer un mini-cours pour la conf´erence “D´eveloppements R´ecents en
Approximation Diophantienne” qui se d´eroulera au CIRM (Marseille) du 8 au 12
octobre 2007.
L’objet du cours, intitul´e “Combinatoire des mots et probl`emes diophantiens”, est
de pr´esenter trois probl`emes de th´eorie des nombres ayant connu des d´eveloppements
r´ecents qui mettent en avant une interaction entre la combinatoire des mots et l’ap-
proximation diophantienne :
1. la complexit´e de la suite des chiffres des nombres alg´ebriques ;
2. l’approximation des nombres r´eels par des entiers alg´ebriques de degr´e born´e ;
3. la recherche d’exemples explicites pour la conjecture de Littlewood.
Les mots finis ou infinis apparaissent naturellement en th´eorie des nombres d`es
que l’on souhaite repr´esenter tous les ´el´ements d’un certain ensemble (entiers, r´eels,
p-adiques...) de fa¸con unifi´ee. Ainsi, les d´eveloppements d´ecimaux, binaires ou en frac-
tion continue permettent d’associer `a tout nombre r´eel une unique suite finie ou infinie
de chiffres. On ´etudiera `a travers quelques exemples comment des propri´et´es combi-
natoires d’une suite de chiffres peuvent r´ev´eler certaines propri´et´es diophantiennes du
nombre correspondant.
Le comportement du d´eveloppement d´ecimal ou du d´eveloppement en fraction
continue de la plupart des nombres r´eels est bien compris grˆace aux propri´et´es er-
godiques de syst`emes dynamiques sous-jacents (associ´es `a l’application x7−→ 10x
mod 1 pour le d´eveloppement d´ecimal ou `a l’application de Gauss dans le cas du
d´eveloppement en fraction continue). En particulier, cela conduit, dans le contexte
appropri´e, `a la notion de ‘nombre normal’. En d´epit de sp´eculations audacieuses, dues
notamment `a ´
E. Borel et S. Lang, il est malheureusement difficile d’obtenir des ren-
seignements sur les suites des chiffres correspondant `a des constantes math´ematiques
classiques comme π,ζ(3) ou encore √2. On montrera comment un outil diophan-
tien puissant, le th´eor`eme du sous-espace de Schmidt, a r´ecemment ´et´e utilis´e afin
d’obtenir de nouveaux r´esultats sur les repr´esentations des nombres alg´ebriques (voir
[6, 3, 1, 4] et le survol [63]).
D’autre part, on expliquera comment certaines constructions combinatoires
donnent vie `a des nombres jouissant de propri´et´es diophantiennes remarquables.
Un exemple particuli`erement int´eressant vient de la d´ecouverte des nombres
extr´emaux par D. Roy (voir [54, 55, 56]). L’existence de tels nombres r´eels ´etait
totalement insoup¸conn´ee et a permis d’infirmer une conjecture qui semblait alors
naturelle sur l’approximation des nombres r´eels par des entiers alg´ebriques cubiques,
ainsi qu’une conjecture duale sur l’approximation simultan´ee et uniforme d’un nombre
r´eel et de son carr´e.
Un autre exemple dans la mˆeme veine est la construction donn´ee dans [2] de couples
explicites de nombres r´eels satisfaisant `a la conjecture de Littlewood.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
1
/
52
100%