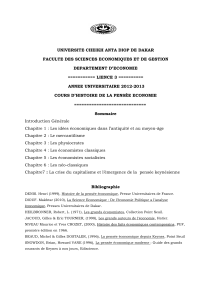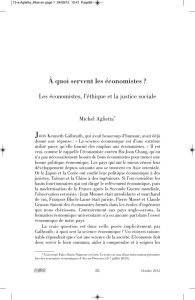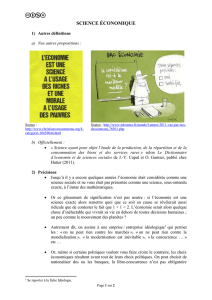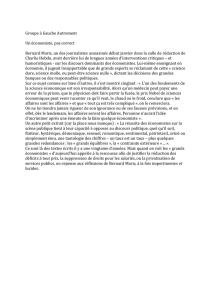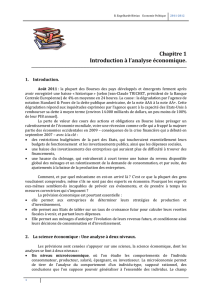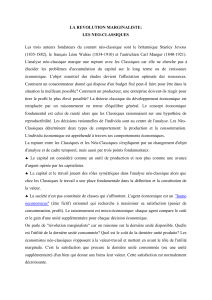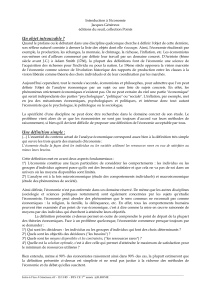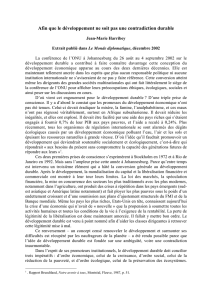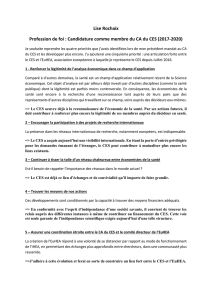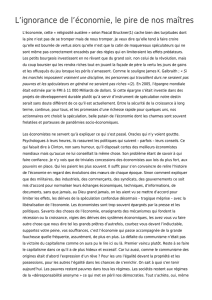La notion de « marché » : un piège pour la pensée critique

La notion de « marché » : un piège pour la pensée critique
S. Morel
Département des relations industrielles, Université Laval
Notes de la communication présentée au Colloque international L’accès des femmes à
l’économie à l’heure de l’intégration des Amériques : quelle économie ?, Montréal, 23-26 avril1.
Résumé de la communication
La notion de « marché », telle que communément véhiculée dans le discours économique ambiant,
toutes orientations politiques confondues, piège les féministes par le brouillage qu’elle opère dans
l’analyse des réalités économiques. En effet, la vision en termes de marché donne le plus souvent à
croire et à penser qu’il existerait réellement un ordre de faits économiques régulé de façon automatique,
dont la logique transcenderait la volonté humaine et s’imposerait en dehors de toute régulation sociale.
La vision orthodoxe de l’économie repose sur une telle croyance. Or, de façon paradoxale, cette
représentation coutumière de l’économie est souvent reprise par les féministes dans leurs propres
analyses, notamment lorsqu’elles élaborent celles-ci à partir de la triade « marché, État, économie
sociale ». Ce problème doit donc être sérieusement reconnu et corrigé car la perspective essentialiste de
cette vision de l’économie compromet la capacité des actrices et acteurs sociaux de fournir des
diagnostics pertinents des problèmes actuels ainsi que de proposer des solutions valables pour y
remédier. Cela parce que la catégorie « marché », et toute la construction théorique dans laquelle elle
s’insère, empêche de penser l’économie comme une science sociale, c’est-à-dire de construire
théoriquement les faits économiques comme des faits sociaux.
1. Un retour nécessaire sur la catégorie de « marché » : la réflexion qui est proposée ici
porte sur un terme si prégnant autour de nous qu’on ne l’interroge plus ou, à tout le moins, on
l’interroge mal : celui de marché. Ce terme a, non seulement envahi le débat public, mais
colonise tous les types de discours, y compris ceux qui se qualifient d’« alternatifs ». Ainsi, les
analyses de contestation de l’ordre « néo-libéral » se veulent une dénonciation des soi-disant
conséquences du « marché », mais omettent de soumettre la signification de ce dernier terme (et
la manière dont elle pervertit nos schémas de pensée) à un examen critique préalable. Autrement
dit, en général, la critique sociale remonte insuffisamment en amont dans la réflexion et,
également, insuffisamment au niveau théorique.
1 Ces notes seront reprises ultérieurement aux fins de la rédaction d’un article.

2
2. La notion de marché opère un brouillage dans l’analyse économique : l’idée
principale que nous allons défendre dans ce texte est à l’effet que la notion de marché, telle
qu’elle est le plus souvent utilisée aujourd’hui, risque de piéger les féministes parce qu’elle
fausse l’analyse des réalités économiques. Cela vient principalement de ce que la représentation
théorique qui est implicitement véhiculée par cette notion de « marché » est celle de l’économie
comme espace auto-régulé (un mécanisme automatique), dont la logique transcenderait la volonté
humaine et s’imposerait en dehors de toute régulation sociale. La notion de marché conduit donc
à endosser l’essentialisme, c’est-à-dire le recours à « des vérités éternelles, des principes premiers
ou des essences » (Bush 1993 :62). Dans cette perspective, les phénomènes économiques sont
intelligibles à partir d’une « essence », d’une « nature » dont il s’agirait simplement d’identifier
les attributs (les « lois économiques »). Ce naturalisme est en complète opposition avec la
conception de l’enquête scientifique sociale, beaucoup plus pertinente pour la recherche en
sciences sociales, selon laquelle il n’existe pas de vérités absolues, c’est-à-dire de « de vérités qui
ont une importance et une crédibilité en dehors du processus dont elles émergent et dont elles
sont déterminées être une partie » (Tool 1994 :205)2.
L’adoption de la perspective essentialiste interdit de penser la complexité des réalités
économiques. En outre, dans la mesure où elle conduit à séparer les espaces de la vie sociale en
autant d’entités isolées les unes des autres, avec des oppositions comme celle, par exemple, du
« marché » et de l’État, échappent à l’analyse :
- les créations hybrides entre le « public » et le « privé » ;
- les articulations entre les interventions d’entreprises et les interventions publiques ;
- la diversité des formes d’organisation sociale ;
- la diversité et l’imbrication des logiques d’action.
3. L’importance des catégories de pensée : les faits ne sont jamais donnés directement à
l’observateur mais sont des constructions élaborées par celui-ci. Les faits sont donc rendus
intelligibles par des schèmes cognitifs qui intègrent des représentations, des valeurs, des théories,
des coutumes ou encore des intérêts. Il faut donc accorder de l’importance à nos catégories de
pensée, car la manière dont nous pensons le monde économique est déterminante pour
2 Cette conception de l’enquête sociale renvoie à John Dewey, l’un des fondateurs du pragmatisme américain,
courant philosophique dont l’influence a été déterminante sur la première génération des économistes

3
l’orientation de nos actions politiques ; il faut viser à utiliser des catégories d’analyse
« politiquement utiles ». Cela signifie également que la « théorie », souvent méprisée dans les
cercles militants, revêt une importance fondamentale, dans la mesure où nous agissons à partir de
« visions du monde » qui sont, pour l’essentiel, des produits culturels, parmi lesquelles figurent
les constructions théoriques.
4. Le terme de marché est polysémique : la première raison pour laquelle la notion de
marché pose des difficultés pour l’analyse, c’est qu’elle revêt une pluralité de sens, ce qui génère
souvent de la confusion dans la mesure où le terme est souvent utilisé sans même être défini. R.
Frydman (1994) distingue trois niveaux d’acception du terme de marché. Ainsi, selon lui, le
terme de marché peut renvoyer à : 1) une réalité empirique (un mode concret d’organisation de
nos régimes économiques, c’est-à-dire « la place où les individus échangistes se rencontrent, là
où les produits changent de mains » ; 2) « un paradigme scientifique : la théorisation de
l’économie à partir des relations d’échange » ; 3) « le fondement même de toute économie ou son
objet générique, qui veut qu’aucune société ne peut échapper à la nécessité de mettre en place des
transactions marchandes ou quasi marchandes » (Frydman 1994 : 35). Comme l’indique l’auteur,
cet « emboîtement de signification comme le champ couvert par chacune d’entre elles font vite
problème » (Frydman 1994 : 35), ne serait-ce aussi qu’en raison du caractère éminemment
contestable de certains de ces présupposés. La première définition du marché, qui a trait au lieu
où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs (le supermarché, la boutique spécialisé, l’étal, etc.)
est une définition de sens commun. La dernière définition renvoie à une lecture historique du
« lien de marché », c’est-à-dire au fait que, dans l’histoire, les échanges marchands ont précédé
le capitalisme, point sur lequel nous reviendrons plus bas. Ce ne sont pas ces deux définitions qui
posent problème, mais plutôt la deuxième, celle ayant trait au « paradigme scientifique » sous-
tendant la notion de marché.
5. Le « paradigme scientifique » auquel renvoie la notion de marché : le cadre
théorique néo-classique : on ne peut parler aujourd’hui de la notion de « marché » sans faire
référence au cadre théorique des économistes qui lui fournit sa crédibilité. Comme la discipline
de l’économie est dominée actuellement par une école de pensée, celle des économistes dits
institutionnalistes américains (dont John R. Commons).

4
« néo-classiques », c’est donc du côté de ce discours économique orthodoxe qu’il faut aller
chercher les éléments théoriques nécessaires pour comprendre de quel type de contenu est chargé
le terme de marché ainsi que les enjeux qui en entourent l’utilisation. D’autre part, il est évident
qu’à partir du moment où l’on se réfère, par exemple, aux « forces de marché » ou encore aux
« lois du marché » pour rendre compte d’un phénomène économique, expressions colportées
naïvement dans le langage de tous les jours, le discours s’élabore, non plus en termes purement
descriptifs (ou de sens commun), mais en termes explicatifs. Aussi, puisque ces « forces » ou ces
« lois » deviennent des éléments d’une explication de la réalité économique, un schéma théorique
est donc implicitement présent. C’est précisément ce dernier qu’il importe de clarifier.
Pour la majorité des économistes, la « science économique » se résume à une seule école de
pensée : la théorie économique développée depuis la fin du XIXe siècle sous l’étiquette
« néoclassique » (ou, plus généralement, l’« économique ») . Selon l’économie néoclassique,
l’économie est la « science des choix » : « la science qui étudie le comportement humain en tant
que relation entre des fins et des moyens rares qui ont des usages alternatifs »3. Dans ce cadre
théorique, le marché est une forme abstraite qui représente le principal lieu de coordination des
activités économiques, où s’opèrent des « échanges » égaux (cette symétrie est postulée). Il est
posé comme un espace s’articulant autour de la confrontation de l’offre et de la demande, laquelle
génère des équilibres de prix et de quantités. Le marché est également présenté, de façon
progressiste, comme étant « autodynamique » : la croissance s’opère automatiquement par les
vertus de l’épargne. Le modèle de concurrence pure et parfaite est posé comme le modèle de
référence. La « société » est pensée, quant à elle, comme la collection des individus autonomes
(sur le type de l’homo oeconomicus), d’où l’adhésion des économistes néo-classiques à la
démarche de l’individualisme méthodologique (l’explication des phénomènes économiques à
partir de l’analyse des comportements individuels). Les sujets économiques, ou agents
économiques, sont postulés comme étant libres, égaux et rationnels. Selon le postulat de
rationalité, l’action économique est comprise comme étant un comportement utilitaire et
calculateur de « maximisation de l’utilité » (ou du profit) sous contrainte de budget (ou de coût).
La centralité du postulat de rationalité et le recours systématique à la formalisation mathématique
selon le paradigme des sciences dites « dures », permettent de considérer que l’économie néo-
classique se définit plus par sa méthodologie que par son domaine d’études. C’est à l’ensemble

5
de cette construction théorique, une physique sociale des échanges symétriques, que renvoie, au
niveau paradigmatique, l’utilisation du terme de marché.
Pour reprendre ces éléments de façon schématique, parler de « marché », dans ce cadre
théorique, signifie, parler en termes d’« offre », de « demande » et d’« équilibre », trois concepts
possédant eux-mêmes un sens théorique précis :
LOI OFFRE ET DEMANDE4
La loi de l’offre et de la demande est l’un des éléments essentiels expliquant le fonctionnement d’une
économie de marché. Elle indique comment se concilient, par l’arbitrage pacifique du marché, les intérêts
apparemment contradictoires des offreurs et des demandeurs.
En particulier la loi de l’offre et de la demande nous montre que, sur n’importe quel marché, il existe
toujours un niveau de prix qui supprime la pénurie (ou l’excédent) et qui équilibre la quantité offerte et la
quantité demandée. Un tel
niveau de prix est qualifié d’optimal, parce qu’il maximise les avantages et
minimise les inconvénients, pour les vendeurs comme pour les acheteurs.
Ce niveau de prix, qui résulte de l’offre et de la demande, détermine un équilibre qui est qualifié de
s
table, ce qui signifie que si l’on s’éloigne de cet équilibre, des mécanismes automatiques (ceux du
marché) ramènent vers l’équilibre; c’est ainsi, par exemple, que pour un niveau de prix inférieur à
l’équilibre, il existera un excès de la demande sur l’of
fre et cela va provoquer une hausse des prix qui se
poursuivra jusqu’au retour à l’équilibre; cette hausse des prix, en particulier, va pousser les producteurs à
augmenter l’offre, résorbant ainsi la pénurie potentielle.
Ce mécanisme de rééquilibrage repo
se naturellement sur la libre variation des prix. En ce sens, le blocage
des prix, leur fixation autoritaire par les pouvoirs publics, constituent toujours une aberration
économique. Si le prix est fixé à un niveau trop élevé, c’est la surproduction inévit
able; c’est par exemple
le cas de nombreux produits agricoles, à l’intérieur du marché commun, pour lesquels il existe des prix
garantis, qui favorisent une surproduction et créent les excédents que l’on connaît; un raisonnement
identique peut être appliqu
é au marché du travail, où un salaire minimum trop élevé est créateur de
chômage. En sens inverse, si le prix est fixé par les pouvoirs publics à un niveau trop bas (soi-
disant pour
empêcher l’inflation), c’est l’excès de la demande sur l’offre, c’est-à-di
re la pénurie, qui apparaît:
l’exemple des loyers bloqués à un niveau artificiellement bas est très significatif de ce phénomène et
explique largement les pénuries de logement que l’on a pu observer. Ce type de déséquilibre était encore
plus évident dans l
es économies planifiées, où tous les prix étaient bloqués, et où se développent les
pénuries, les files d’attente ou le marché noir.
Déjà à ce niveau, la représentation de l’économie par la « loi de l’offre et la demande »
comprend implicitement une idée de justice : puisque le « marché » est présenté comme étant un
mécanisme impersonnel, il est « censé profiter également à tous, donc juste » (Pontvianne 2000 :
187). De ce point de vue, il est infondé de critiquer l’approche « néo-libérale » parce qu’elle ne
3 Cette définition canonique est de : Robbins 1935.
4 Cet extrait est tiré d’un site Web qui fait la promotion « d’une lecture libérale des problèmes de la société française
et du monde contemporain » ; http://www.libres.org (voir sous « Encyclopédie »).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%