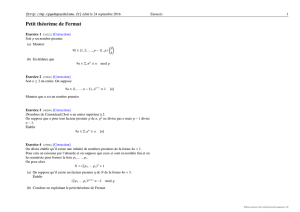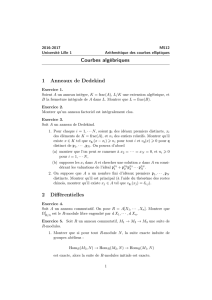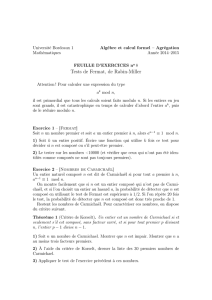Le théorème de Fermat - Université de Limoges

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LIMOGES, 2004-05
IREM et IUFM DU LIMOUSIN
Formation continue second degré Mathématiques actuelles
Le théorème de Fermat
pour prégulier, p6 | xyz
Stéphane Vinatier
Le dernier théorème de Fermat a été démontré par WILES en 1994, après plus de
trois siècles d’efforts des mathématiciens théoriciens des nombres. Il s’agit de mon-
trer que si nest un entier supérieur ou égal à 3, l’équation :
xn+yn=zn
n’a pas de solution entière (x∈Z,y∈Zet z∈Z) non triviale (xyz 6=0). Ce résul-
tat n’a pas de conséquences mathématiques notables ; cependant, les recherches qui
ont finalement abouti à sa résolution ont été sources de progrès considérables dans
plusieurs domaines des mathématiques.
FERMAT (1601-1665) était lui-même en mesure de démontrer son théorème pour
quelques petites valeurs de n, mais il ne pouvait soupçonner l’existence d’une dif-
ficulté cruciale pour n>19 : l’anneau dans lequel se font les calculs n’est alors
plus principal. A son époque, les notions de groupe et d’anneau sont inconnues,
le concept d’anneau non principal est à fortiori complètement hors d’atteinte.
Une étape importante vers la résolution a été franchie lorsque le mathématicien
allemand KUMMER a introduit en 1846 la notion d’idéaux dans le but de remédier
(partiellement) à cette difficulté : la propriété d’unique factorisation en produit d’ir-
réductibles n’est pas vraie pour les éléments de l’anneau quand celui-ci n’est pas prin-
cipal, mais elle est vraie pour les idéaux des anneaux qui interviennent ici. Nous
allons voir comment cette notion permet de démontrer le premier cas (p6 | xyz) du
théorème de Fermat pour un nombre premier n=prégulier (nous verrons plus loin
ce que cela signifie, c’est une hypothèse qui « adoucit » le fait que l’anneau ne soit pas
principal).
1 Echauffement
L’équation de Fermat pour n=2 a des solutions non triviales : on se ramène
à(x/z)2+ (y/z)2=1, donc à chercher les points du cercle trigonométrique à co-
ordonnées rationnelles (c’est-à-dire dans Q). On paramétrise le cercle en utilisant
cosθ=1−t2
1+t2et sinθ=2t
1+t2, où t=tan(θ/2); les valeurs rationnelles de tfournissent
les solutions.
1

Dès lors, montrer que l’équation de Fermat n’a pas de solution pour n≥3 se
ramène à montrer qu’elle n’en a pas pour n=4 et pour tout nombre premier impair
p. En effet,
xab +yab =zab ⇒(xa)b+ (ya)b= (za)b,
et tout entier supérieur à 3 est divisible par 4 ou par un premier impair. Enfin, on
se ramène aisément à montrer qu’il n’y a pas de solutions (x,y,z)avec x,yet zpre-
miers entre eux. FERMAT a traité le cas n=4 à l’aide du principe de la « descente
infinie » dont il est l’inventeur. Nous fixons désormais un premier impair pet consi-
dérons l’équation :
xp+yp=zp,x,y,z∈Zpremiers entre eux.
Le raisonnement dans le premier cas du théorème (p6 | xyz) est très simple pour
p=3 :
Exercice 1.1 Montrer que 36 | x entraîne que x3≡ ±1 mod 9 ; faire de même pour y3et
z3, en déduire que x3+y3=z3est impossible si 36 | xyz.
La même méthode s’applique pour p=5 en considérant des congruences modulo
25. Par contre, ça ne marche plus pour 7 : 17+307≡317mod 49, et on peut montrer
qu’il y a des solutions modulo toutes les puissances de 7.
Le second cas du théorème pour p=3 (3|xyz) est une bonne introduction aux
méthodes qui serviront dans le premier cas pour p≥5 régulier. Nous commençons
donc par celui-ci.
2 Le second cas pour p=3
Ici p=3 et on suppose qu’il existe une solution (x,y,z)de l’équation de Fermat
avec x,y,z∈Zpremiers entre eux et 3|xyz. En écrivant
x3+y3+ (−z)3=0 ,
on voit que, quitte à permuter x,yet z, on peut supposer que 3 divise z, si bien que
3 ne divise pas xet y.
On revient à l’équation sous la forme x3+y3=z3; puisqu’il est divisible par 3,
l’idée « naturelle » est de factoriser le membre de gauche. Pour cela, on introduit une
racine cubique de l’unité, que l’on note j: c’est l’une des solutions non réelles de
l’équation X3=1, donc une solution de X2+X+1=0.
Exercice 2.1 Vérifier que x3+y3= (x+y)(x+j y)(x+j2y).
On note que 1 +j+j2=0, si bien que j2=−1−j; comme j3=1, toutes les
puissances positives de js’écrivent a+b j avec a∈Zet b∈Z.
2

2.1 L’anneau Z[j]
On est ainsi amené à travailler avec des nombres qui se trouvent dans l’anneau :
Z[j] = {a+b j,a∈Z,b∈Z},
qu’on peut voir comme un sous-anneau de C, c’est-à-dire que l’addition et la multi-
plication s’y font de la manière habituelle. Cet anneau est principal, ce qui entraîne
que tout élément s’écrit de manière unique produit d’une unité par des irréductibles.
Définition 2.2 Un anneau A est dit intègre si, pour a,b∈A, ab =0 entraîne a=0
ou b=0. Si tel est le cas, un élément a∈A est une unité s’il admet un inverse b∈A :
ab =1 ; un élément a∈A est irréductible si a=b c avec b∈A et c∈A entraîne b
est une unité ou cest une unité.
L’ensemble des unités de A est noté A×.
Exemple 2.3 L’anneau Zest intègre. Ses unités sont 1 et −1 ; ses irréductibles sont les
nombres premiers (et leurs opposés). Tout nombre entier s’écrit de manière unique
±1 multiplié par des nombres premiers positifs : 1728 =26×33.
De même, Z[j]est intègre, car c’est un sous-anneau de C. En plus de ±1, il admet
jet j2(et leurs opposés) comme unités, puisque j×j2=1. Ce sont les seules :
Z[j]×={±1, ±j,±j2}.
Pour prouver cette assertion, on introduit l’application norme :
N : Z[j]−→ Z
a+b j 7−→ (a+b j)(a+b j 2)
On note que comme jet j2sont conjugués pour la conjugaison complexe ({j,j2}=
{e2iπ/3,e−2iπ/3}), la norme est égale au carré du module :
N(a+b j)=(a+b j)(a+b j ) = |a+b j|2.
Exercice 2.4 Etablir l’égalité : N(a+b j )=(a+b)2−3ab . En déduire que N(a+b j) =
1si et seulement si a +b j ∈ {±1, ±j,±j2}.
L’assertion sur Z[j]×découle maintenant de la proposition suivante.
Proposition 2.5 Soit u ∈Z[j], alors u ∈Z[j]×si et seulement si N(u) = 1.
Preuve. Supposons que usoit une unité, alors il existe v∈Z[j]tel que uv =1, d’où
N(uv) = N(1), c’est-à-dire N(u)N(v) = 1. Il s’ensuit que N(u) = ±1, puis N(u) = 1
car la norme est positive.
Supposons que N(u) = 1, alors uu=1, donc uest une unité.
3

La norme donne aussi un critère pour repérer les irréductibles de Z[j]: si N(s)
est premier, alors sest irréductible (exercice). Ainsi, 1 −jest irréductible :
N(1−j)=(1−j)(1−j2) = 3 .
Notons au passage qu’on obtient la décomposition de 3 en produit d’une unité par
des irréductibles :
3= (1−j)(1−j2) = j2(1−j)×j(1−j2) = −j2(1−j)2.
Par contre, la réciproque n’est pas vraie : 5 est irréductible dans Z[j], mais N(5) =
5×5=25 n’est pas premier.
2.2 La descente infinie
On note λ=1−jet, pour s∈Z[j], on note vλ(s)l’exposant de λdans la
décomposition de sen produit d’une unité par des irréductibles. Par exemple :
vλ(λ) = 1 , vλ(1−j2) = 1 , vλ(3) = 2 , vλ(j) = 0 .
De plus, vλ(z)≥2 car 3 divise z.
Le principe de la « descente infinie » est le suivant : à partir de notre solution
(x,y,z)de l’équation de Fermat, on va construire une solution (x0,y0,z0)de :
(x0)3+ (y0)3=u0(z0)3,x0,y0,z0∈Z[j]premiers entre eux,
vλ(x0) = vλ(y0) = 0 , vλ(z0)≥1 , (1)
où u0∈Z[j]×et
vλ(z0) = vλ(z)−1 .
Pour ce faire, on utilisera uniquement le fait que (x,y,z)est solution de :
x3+y3=uz3,x,y,z∈Z[j]premiers entre eux,
vλ(x) = vλ(y) = 0 , vλ(z)≥1 , (2)
avec u∈Z[j]×(bien sûr, u=1, mais on ne s’en servira pas).
A partir d’une solution au problème (2), on construit une solution au problème
(1), qui satisfait les mêmes hypothèses et telle que vλ(z0) = vλ(z)−1. Ce procédé
est récursif (rien n’empêche de l’itérer), et aboutit clairement à une contradiction :
l’exposant de λdans la troisième composante de la solution diminue de 1 à chaque
étape, mais doit rester supérieur ou égal à 1... Il ne reste donc qu’à montrer que cette
construction est possible pour achever la preuve du théorème de Fermat pour p=3.
Lemme 2.6 Pour tout s∈Z[j], on a s≡0,1 ou −1 mod λ(c’est-à-dire s−0, s−1
ou s+1 est divisible par λdans Z[j]).
4

Preuve. Ecrivons s=a+b j avec a,b∈Z, alors s=a+b+b(j−1) = a+b−bλ,
donc s≡a+bmod λ. Or a+b∈Zdonc a+b≡0,1 ou −1 mod 3, donc aussi mod λ
puisque λdivise 3.
Lemme 2.7 Si s ≡ ±1 mod λ, alors s3≡ ±1 mod λ4.
Preuve. On traite le cas s≡1 mod λ, alors s−1=tλpour un t∈Z[j], d’où
s3−1= (s−1)(s−j)(s−j2)=(s−1)(s−1+1−j)(s−1+1−j2) = tλ(t+1)λ(t−j2)λ.
Comme t≡0,1 ou −1 mod λd’après le lemme qui précède et j2≡1 mod λ, ceci en-
traîne s3≡1 mod λ4. L’autre cas est analogue.
On en déduit (exercice) :
vλ(z)≥2 .
Il s’ensuit que vλ(z3)≥6. On utilise alors la factorisation établie dans l’exercice 2.1 :
(x+y)(x+j y)(x+j2y) = u z3.
L’un des facteurs est forcément divisible par λ2; on peut supposer que c’est x+y, et
on montre qu’alors vλ(x+j y) = vλ(x+j2y) = 1 :
x+j y =x+y+ ( j−1)y=x+y−yλ
et vλ(y) = 0. On note t=vλ(x+y) = 3vλ(z)−2. Comme Z[j]est principal, la
notion de pgcd existe comme dans Z.
Lemme 2.8 Le pgcd de x +y et x +j y est (x+y,x+j y) = λ.
Preuve. Supposons que r∈Z[j]divise x+yet x+j y, alors rdivise la différence λy
et rdivise (x+y)−j2(x+j y)=(1−j2)x=−j2λx; comme xet ysont premiers entre
eux, ceci entraîne que rdivise λ. Or on vient de voir que λdivise effectivement x+y
et x+j y.
On montre de manière analogue que (x+y,x+j2y)=(x+j y,x+j2y) = λ. Il s’ensuit
que
x+y=w1s3
1λt,x+j y =w2s3
2λ,x+j2y=w3s3
3λ,
avec w1,w2,w3∈Z[j]×,s1,s2,s3∈Z[j],vλ(s1) = vλ(s2) = vλ(s3) = 0 et (s1,s2) =
(s2,s3)=(s3,s1) = 1.
On rappelle que 1+j+j2=0 ; il s’ensuit que (x+y)+ j(x+j y)+ j2(x+j2y) = 0,
d’où l’on déduit :
w1(s1λvλ(z)−1)3+j w2s3
2+j2w3s3
3=0 ,
soit
(x0)3+"(y0)3=u0(z0)3,
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%