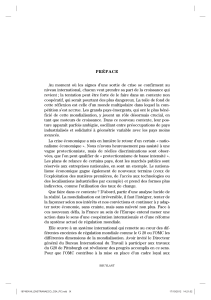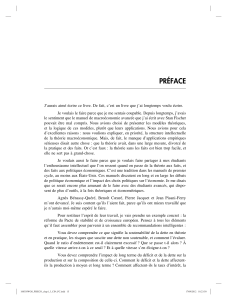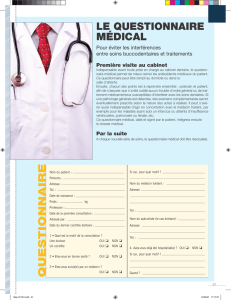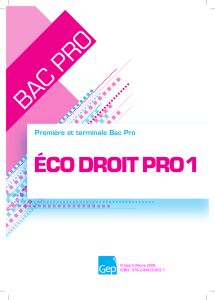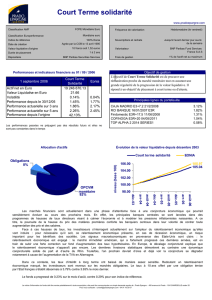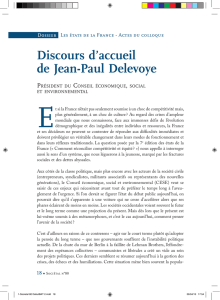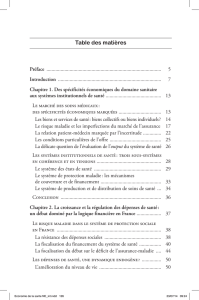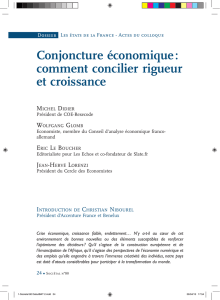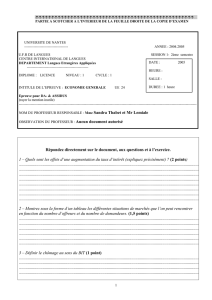P olitique économique

Politique économique
La politique économique est en pleine
mutation. La crise financière et les déboires
de la zone euro ont ébranlé les certitudes
passées. Elles ont contraint gouvernements
et institutions à sortir des sentiers battus et
à rouvrir des chapitres oubliés de la théorie
économique.
Les questions qui se posent sont plus
pressantes que jamais. La politique
budgétaire est-elle efficace pour combattre
une crise ? Quelles sont les limites de
l’endettement public ? Que peut la politique
monétaire lorsque l'inflation est voisine de
zéro ? L’État doit-il sauver les banques ?
Quelles contraintes impose la participation
à une union monétaire ? Jusqu’où doit
aller la progressivité de l’impôt ? Comment
stimuler la croissance ? Comment réformer
l’assurance-chômage ?
Les outils disponibles pour répondre à ces
questions sont dispersés dans des champs
disciplinaires distincts et il existe souvent
une fracture entre la réflexion théorique et le
débat de politique économique.
Parce qu’il réunit, dans un seul volume,
les faits essentiels, les principaux
enseignements théoriques et l’analyse des
débats actuels, Politique économique
s’est imposé, dès sa première publication
en 2004, comme la référence pour les
étudiants et les praticiens qui cherchent
à se fonder sur l’analyse des faits et sur
des bases théoriques solides.
L’ouvrage a donné lieu à une édition
américaine (Oxford University Press, 2010)
et une traduction chinoise est en cours.
Cette troisième édition a été entièrement
refondue pour tirer les leçons des
bouleversements récents.
La démarche est d’abord méthodologique,
puis thématique. Elle met l’accent sur
l’utilisation pratique des outils de
l’analyse économique, avec un souci
constant de rigueur scientifique et en
mobilisant les théories les plus récentes.
L’exposé est clair et pédagogique :
• la formalisation est présentée en encadré,
ce qui permet différents niveaux de
lecture de l’ouvrage ;
• les chapitres thématiques sont structurés
en trois parties : enjeux, théories,
politiques, ce qui permet à chacun
d’organiser sa lecture selon ses besoins.
L’ouvrage s’adresse ainsi un public très
large : étudiants en licence ou master
d’économie, de gestion ou de sciences
politiques, candidats aux concours
administratifs, praticiens et observateurs de
la politique économique, acteurs de la vie
économique.
Agnès Bénassy-Quéré
est Professeur à l’École d’économie de Paris -
Université Paris 1 et Président délégué du Conseil
d’Analyse Économique.
Benoît Cœuré
est Membre du directoire de la Banque centrale
européenne et Professeur associé à Sciences-Po.
Pierre Jacquet
est Président du Global Development Network
(GDN).
Jean Pisani-Ferry
est Directeur du « think tank » Bruegel (Bruxelles) et
Professeur associé à l’Université Paris-Dauphine.
Avec la collaboration de Pierre-Emmanuel Darpeix.
Politique économique
ISBN 978-2-8041-7090-5
ISSN 2030-501X
PISECO
Clair, rigoureux et complet :
la nouvelle référence pour comprendre la politique économique.
A. Bénassy-Quéré
B. Cœuré
P. Jacquet
J. Pisani-Ferry
www.deboeck.com
http://noto.deboeck.com : la version numérique de votre ouvrage
• 24h/24, 7 jours/7
• O ine ou online, enregistrement synchronisé
• Sur PC et tablette
• Personnalisation et partage
Politique
économique
Agnès Bénassy-Quéré • Benoît Cœuré
Pierre Jacquet • Jean Pisani-Ferry
Préface d'Olivier Blanchard
3e édition
PISECO-cover.indd 1-3 17/12/13 14:49


Politique
économique
PISECO-pgLim.indd 1 12/12/13 10:56

OUVERTURES ÉCONOMIQUES
PISECO-pgLim.indd 2 12/12/13 10:56

Politique
économique
Agnès Bénassy-Quéré • Benoît Cœuré
Pierre Jacquet • Jean Pisani-Ferry
Préface d'Olivier Blanchard
3e édition
ÉCONOMIQUES
OUVERTURES
BALISES
PISECO-pgLim.indd 3 12/12/13 10:56
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
1
/
98
100%