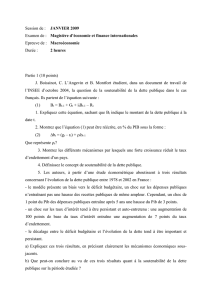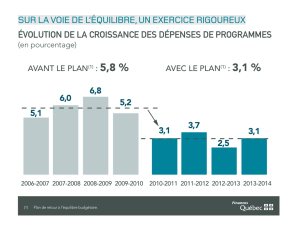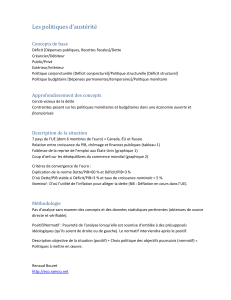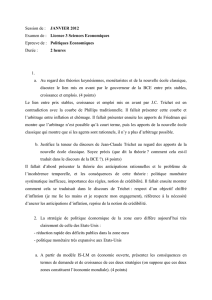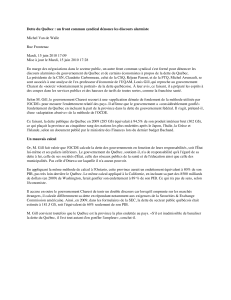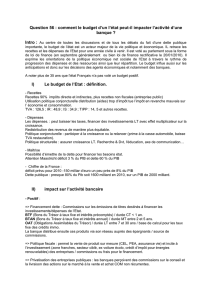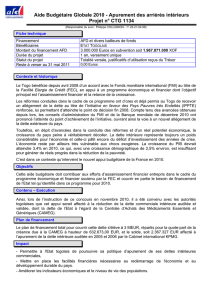Télécharger l`article - Institut de l`entreprise

4ème trimestre 2008 •59
Pourquoi réduire
la dette publique ?
FrançoIs Ecalle
Économiste, chargé de cours à l’université Paris I
L’augmentation des déficits et de l’endettement publics en France en 2007, à
contre-courant des évolutions observées dans le reste de l’Europe,témoigne de notre
incapacité à maîtriser nos finances publiques et à réduire notre endettement, mais en
avons-nous vraiment la volonté ?
Si les discours insistent souvent sur la nécessité d’un rééquilibrage des comp-
tes publics, il n’est pas certain que les hommes politiques,leurs conseillers et
leurs électeurs en soient toujours intimement persuadés, une bonne partie
des économistes français entretenant leurs doutes avec des arguments qui
ne sont pas toujours dénués de pertinence.Cet article a pour objet de discuter de ces
arguments sous la formed’un dialogue imaginaire entre un défenseur de politiques
alternatives (PA) et moi-même (FE)1.
Dette publique et croissance économique
PA –La dette publique résulte de l’accumulation des déficits au fil des ans, et ces
déficits résultent eux-mêmes de la faiblesse de la croissance économique en France
depuis la fin des Trente Glorieuses. Nos erreurs de politique économique,notam-
ment une politique monétaire excessivement restrictive dans la première moitié des
années1990, constituent la cause principale de cet endettement croissant.
La réduction des déficits ne peut qu’aggraver ce mal français en raison des effets
keynésiens négatifs de toute hausse des prélèvements obligatoires ou de toute baisse
des dépenses publiques sur l’activité.Ellen’est souhaitable que dans les phases hautes
1. Ce dialogue imaginaire s’inspire d’un dialogue réel sur ce sujet entre Jean-Paul Fitoussi et Jean-Marc Daniel,
publié en septembre 2004 par L’Express.

Dossier : Finances Publiques
60 •Sociétal n°62
des cycles économiques, lorsque la croissance est suffisamment solide pour qu’une
politique budgétaire restrictive n’entraîne pas une hausse du chômage. Il faut d’abord
soutenir la croissance ;les déficits et la dette diminueront alors automatiquement.
FE – Depuis 1990, la dette publique a augmenté de 31 points de PIB en France et
de 15 points, en moyenne,dans la zone euro (de 25 points en Allemagne en dépit du
coût de sa réunification)2.La croissance du PIB n’explique pas cette contre-perfor-
mance française :elle a été identique en moyenne annuelle (2 %) en France et dans
l’ensemble de la zone euro sur cette période (et de seulement 1,5 % en Allemagne).
Le calcul d’un déficit structurel permet de neutraliser l’impact des variations conjonc-
turelles du PIB sur le déficit public. En 2007, ce déficit structurel était égal à 2,9 %
du PIB en France,contre 0,2 % du PIB dans la zone euro (hors France) et 0,3 % en
Allemagne3.
Le déficit français ne résulte donc pas d’une croissance inférieure à celle de nos voi-
sins, sur le long terme comme sur les années les plus récentes.
Une croissance plus fortefaciliterait évidemmentl’assainissement des comptes
publics, mais nos gouvernements en font trop souvent, à tort, un préalable à la remise
en ordre des finances publiques, si bien qu’il ne paraît jamais opportun de réduire les
déficits :quand la conjoncture est mauvaise,il ne faut pas l’aggraver ;quand elle est
bonne,il ne faut pas casser une reprise toujours fragile.
Il est vrai que la théorie keynésienne a toujours une certaine validité et qu’une réduc-
tiondudéficitpeut avoirunimpact négatif,temporaire, sur la croissance. Il est
toutefois aussi vrai que d’autres approches théoriques et l’expérience de politiques
ambitieuses d’assainissement des comptes publics menées dans certains pays (Suède,
Canada…) ont montré que ces effets keynésiens doivent être relativisés. Ils sont pro-
bablement très faibles lorsque la dette publique est déjà très importante,les ménages
et chefs d’entreprise étant alors plus nombreux à anticiper une politique de rigueur
et à compenser le déficit public par une épargne privée4.
Dans la situationactuelle de l’économie française,caractérisée par une dette élevée,
un chômageprochedeson niveau structurel et une conjonctureaffaiblie par un choc
2. Engagements financiers bruts des administrations publiques calculés par l’OCDE (Perspectiveséconomiques,
juin 2008).
3. Rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, juin 2008.
4. Pour plus de précisions sur les approches keynésiennes et non keynésiennes,voir J. Creel,B. Ducoudré,C. Mathieu
et H. Sterdyniak, «Doit-on oublier la politique budgétaire?»,revue de l’OFCE,2005 ;etF. Ecalle, Maîtriser les
finances publiques ;pourquoi, comment ?,Economica, 2005.

4ème trimestre 2008 •61
Pourquoi réduire la dette publique ?
d’offre5,ilnesertàrien de soutenir l’activité,oulepouvoir d’achat, par le déficit bud-
gétaire.
Bonnes ou mauvaises dettes et dépenses
PA –Il faut en priorité élever le potentiel de croissance de l’économie française,ce
qui suppose notamment d’investir dans de nouvelles infrastructures et d’accroître
l’effort de recherche. Ces dépenses publiques n’auront toutefois d’effets favorables
que dans plusieurs années et il est donc légitime de les financer par emprunt, comme
le ferait n’importe quelle entreprise.Les investissements publics représentent 3,3 %
du PIB et, s’ils étaient exclus du calcul du déficit public pour ne retenir qu’un «solde
courant », les finances publiques françaises apparaîtraient presque toujours en excé-
dent.
Si la dette totale des administrations publiques s’élève à1500 milliards d’euros fin
20076,leurs actifs représentent 2 270 milliards d’euros (dont 1 420 milliards d’euros
d’actifs non financiers et 850 milliards d’euros d’actifs financiers). Ayant pour contre-
partie des immobilisations physiques ou financières, la dette publique française est
donc une bonne dette.
Les discours inquiétants sur l’endettement excessif de la France ont en réalité pour
seul but de légitimer des coupes sombres dans les dépenses publiques, d’abord dans
les investissements carc’est le plus facile,ensuite dans les prestations sociales, pour
casser le modèle social français, puis dans la masse salariale,pour remettre en cause
le service public.
FE –l’État n’est pas une entreprise dont les investissements sont choisis en fonction
de leur capacité à dégager des cash-flows et ses actifs physiques ne génèrent qua-
siment aucune recette.Leur évaluation est en outre très difficile,donc très fragile
(comment évaluer le château de Versailles, ou même seulement le réseau routier ?).
Enfin, ces actifs physiques sont pour la plupart invendables. Le problème posé par
la dette publique étant celui de notre capacité à la rembourser,il est préférable de ne
prendre en compte que les actifs financiers des administrations publiques, lesquels
ne représentent que 57 % de leur endettement brut.
5. Sur les prix des importations et les conditions du crédit.
6. Dette brute au sens des comptes nationaux (source Insee). La dette au sens du traité de Maastricht est égale à
1 210 milliards d’euros.

Dossier : Finances Publiques
62 •Sociétal n°62
Parailleurs, la distinctionentrebonnes et mauvaises dépenses publiques, et par consé-
quent entrebonnes et mauvaises dettes, trouverapidement ses limites. Si les écono-
mistes mettent souvent en avant l’utilité des investissements publics ou des dépenses
de recherche, il est évident que bien d’autres dépenses publiques sont tout aussi utiles.
Beaucoup d’entreelles, àcommencer par les dépenses d’éducation, ontaussi des effets
positifsàlongterme et peuvent justifier un financement par l’emprunt.
Certains investissements publics ont une grande utilité socio-économique et d’autres
ne servent à rien ;il en est de même pour les autres dépenses. On ne peut donc pas
présumer l’utilitédes dépensespubliques àpartir de leur nature, et il serait très
dangereux d’exclure certaines catégories de dépenses du calcul du déficit public sur
cette base.
Personne ne peut dire sérieusement quel est le rapport optimal des dépenses publi-
ques au PIB, maisonpeutprésumerqu’il est inférieur au tauxde52%observé
enFrance sur la base de deux constats :d’une part, de nombreuses évaluations de
dépenses publiques en France montrent qu’elles sont inefficaces ;d’autre part, le ratio
français est désormais le plus élevé de l’OCDE, à égalité avec celui de la Suède,et les
autres pays ne semblent pas souffrird’une insuffisance de dépenses publiques.
La maîtrise des dépenses publiques est nécessaire pour assainir les comptes publics,
dans la mesure où le taux des prélèvements obligatoires français est déjà parmi les
plus élevés dans un contexte de concurrence fiscale accrue,mais il est évident qu’elle
doit s’appuyer sur leur évaluation au cas par cas et non sur des présupposés idéolo-
giques.
Le risque de faillite de l’État
PA –La dette publique française est portée surtout par l’État et celui-ci garantit de
fait7celle des autres administrations publiques. Or la solvabilité de l’État français
est excellente si on en croit les agences de notation, qui lui attribuent les meilleures
notes. Ses emprunts sont d’ailleurs placés sans la moindre difficulté.
La dette publique brute de la France à fin 2007 (69 % du PIB) est inférieure à la
moyenne de la zone euro (72 %) et de l’OCDE (75 %), et nettement inférieure à
celle de quelques grands pays comme le Japon (170 %) ou l’Italie (117 %). Après
déduction des actifs financiers des administrations publiques, la dette nette est égale
7. Mais généralement pas en droit.

4ème trimestre 2008 •63
Pourquoi réduire la dette publique ?
à 34 % du PIB en France,contre 45 % dans la zone euro et 41 % dans l’OCDE
(86 % au Japon et 91 % en Italie)8.
Si les marchés devaient soudainement se préoccuper de la solvabilité des États de
l’OCDE9,la hausse des primes de risque porterait sur les obligations de beaucoup
d’autres pays avant celles du Trésor français.
Dans le passé,laFrance a connu un endettement public bien plus important, notam-
ment pendant et juste après les deux guerres mondiales, et ces dettes ont été rem-
boursées sans drame.
FE –Elles ontsurtout été annulées par l’inflationqui aruiné bien des épargnants et
pas toujours les plus riches, solutiondésormais impossible,heureusement, en raison
des statuts de la Banque centrale européenne.L’observationdupassé montreaussi que
les crises des finances publiques peuvent survenir avec une dette bien inférieureà60%
du PIB.En1982, seule la Banque centrale d’Arabie saoudite acceptait encored’assurer
les fins de mois de l’État français. Inversement, le Japonsupporte une dette publique
considérable (qui peut êtrerelativisée si on tient compte de ses actifsfinanciers) mais
il aaussi un taux d’épargne hors norme qui en facilite le placement (les taux d’inté-
rêtetles charges financières ysontfinalement plus faibles que dans la moyenne de
l’OCDE). En fait, les risques de crise des finances publiques dépendent de beaucoup
de facteurs différents, et pas seulement du rapportinstantané de la dette au PIB.
La situationfrançaise présente àcet égarddeux caractéristiques inquiétantes. D’abord,
nos capacités de redressement paraissent très faibles :leniveau déjà atteint par les pré-
lèvements obligatoires exclut tout relèvement d’ampleur significative;nos velléités de
maîtrise des dépenses publiques n’ontabouti qu’à leur stabilisationenpourcentagedu
PIB sur les dix dernières années, alors qu’elles ontété diminuées de 2points de PIB
dans la zone euro, de 4points en Allemagne et de 7points en Suède.
Ensuite,siladette publique française (brute ou nette) est encoreinférieureàla
moyenne de l’Europe ou de l’OCDE, elle augmenteplusvite.En1980, la dette
nette était négative en France (les actifs financiers étant supérieurs à la dette brute)
8. Engagements financiers bruts et nets calculés par l’OCDE (juin 2008). Ces engagements financiers bruts sont,
pour la France,supérieurs à la dette au sens du traité de Maastricht (64 % du PIB en 2007) et inférieurs à la dette
brute au sens des comptes nationaux estimée par l’Insee (79 % du PIB).
9. Plus précisément, des membres historiques de l’organisation.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%