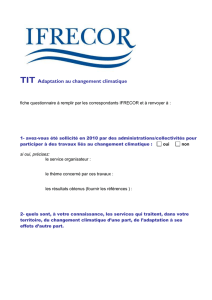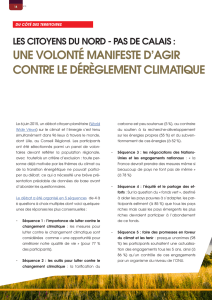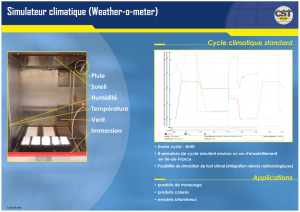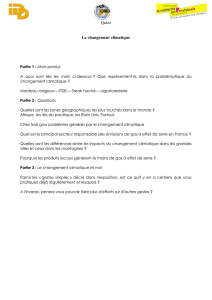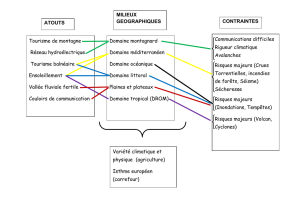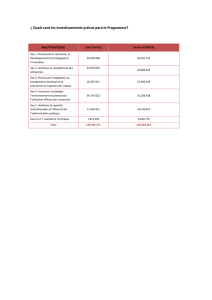Alain Renaut, Étienne Brown, Marie

Alain Renaut, Étienne Brown, Marie-Pauline Chartron, Geoffroy Lauvau
Inégalités entre globalisation et particularisation
Volume à paraître aux Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, dans la collection
Philosophie appliquée, en mai 2016
SECTION II : ETUDES APPLICATIVES
TROISIEME PARTIE
ÉTUDES CLIMATIQUES
Responsable : Geoffroy Lauvau
Extrait du Liminaire
Par Geoffroy Lauvau
Dans la problématique environnementaliste classique, chacun était appelé à se
représenter lui-même comme un sujet responsable (des pollutions naturelles passées), à des
degrés certes divers (du geste par lequel le vacancier contribuait à infester les océans de
bouteilles et autres objets en plastique à celui de l’agriculteur industriel polluant les rivières et
les lacs, voire la nappe phréatique, par le déversement d’engrais permettant de tirer le
maximum d’une terre épuisée, et en menaçant la biodiversité). Chacun pouvait aussi se
représenter comme en charge de l’amélioration des choses, par des comportements
quotidiens, professionnels ou relevant de la consommation, dépendant de décisions qu’il
dépendait de lui de prendre, au nom d’une simple réflexion éthique sur l’impact que de petits
actes pouvaient avoir sur de grandes causes. A partir des années 1970-1980 s’est ainsi édifiée
une conscience écologique, accompagnée par la tentative de transformer quelques
mouvements d’opinion axés sur ces questions en partis politiques. En sorte qu’on a pu penser
que l’écologie devenait une vaste cause d’éthique personnelle et publique, ainsi qu’un
nouveau discours politique à part entière. Ces années sont derrière nous.
L’écologie politique se meurt, et ceux qu’elle avait mobilisés pour un temps se
redistribuent sur l’échiquier politique traditionnel. La conscience civique s’est délestée de sa
composante environnementale et le consumérisme s’est déculpabilisé, voire, comme on dit,
décomplexé. Non que pourtant les questions soulevées par l’interrogation sur l’insertion de
l’être humain dans un ensemble naturel qui conditionne sa vie, à la fois dans sa dimension de
survie et dans celle de la qualité de vie individuelle ou collective, se fussent refermées. Plus
certainement, elles se sont déplacées de la représentation de la nature comme environnement à
son identification comme un monde ou comme une planète exposés à des phénomènes
beaucoup plus vastes. Ces phénomènes sont désormais impossibles à mettre en relation, en
tout cas sur le mode antérieur, avec tel ou tel geste accompli chaque jour par des individus ou
des groupes d’individus dont il dépendrait, pas plus qu’il n’est possible d’y remédier
seulement par des décisions simples, animés par les motivations d’une conscience
environnementale que la famille et l’école pouvaient aider à bâtir.
Ce virage dans l’esprit du temps s’est accompli à mesure que, selon une périodisation
qui a été reconstituée dans les chapitres concernés de la section I, le risque écologique s’est
déplacé d’un risque environnemental à un risque climatique, qui présente la particularité
d’avoir été représenté, dans l’état de désorganisation où nos consciences se sont trouvées
placées quand elles en ont pris connaissance, comme corrélé à un processus sans sujet.
Personne n’a décidé en connaissance de cause, lors de la révolution industrielle, de prendre le
risque de polluer l’atmosphère et, en la polluant effectivement, de menacer l’ensemble des
populations humaines où qu’elles se trouvent dans le monde, avec, qui plus est, des risques

encourus par certaines qui sont infiniment plus élevés que pour d’autres, lors même que les
régions du monde les plus exposées sont souvent celles qui ont le moins participé jadis ou
encore même aujourd’hui à ce que nous identifions désormais en termes de pollution de
l’atmosphère et de changement climatique d’origine anthropique. Ainsi sommes-nous
confrontés à un processus dont une grande majorité des êtres humains ignorent encore tout ou
presque tout, et dont la plupart ne peuvent se penser comme responsables, ni en tant
qu’auteurs, ni en tant qu’ils pourraient en être, quelle que fussent leur prise de conscience et
leur engagement éthique, des « remédiateurs ». Où l’on commence à apercevoir pourquoi une
approche philosophique renouvelée se trouve requise par le constat de ces déplacements –
dont le moins que l’on puisse estimer est qu’ils engagent le philosophe selon des modalités
nouvelles à partir de questions fondamentales relevant de sa réflexion, aussi bien sur la
représentation de l’homme que sur celle de son histoire et de l’histoire du monde. Insistons
sur ce que le changement de paradigme qui vient d’être évoqué modifie dans l’approche
philosophique des questions écologiques.
Lors de la montée en puissance de la problématique environnementale, illustrée
notamment par Hans Jonas (1979), à l’extrême fin d’une séquence en fait déjà débordée par la
suivante, la philosophie a trouvé certains de ses motifs les plus puissants pour faire de ce
terrain une des principales raisons contemporaines de la remise en question de l’humanisme
moderne. Sur la lancée, en particulier, d’une déconstruction de la technique comme
arraisonnant le monde (selon l’un des thèmes les plus célèbres défendus par Heidegger dès les
années 1950) se trouvaient fournis les principaux ingrédients d’une « écophilosophie »
associant l'émergence de l'humanisme et la dévastation de la nature, pour prôner la
réinscription de l’être humain dans ce vis-à-vis de quoi il avait voulu se constituer comme un
règne séparé. À interroger les dérives possibles d’un tel anti-humanisme naturaliste, on
comprendra pourquoi il a pu, notamment par les sacrifices normatifs qu’il demandait à nos
consciences de Modernes, inciter nombre de penseurs et d’intellectuels à se retenir pour un
temps d’intégrer dans leurs réflexions et engagements des considérations environnementales
trop coûteuses sous cette forme. Et ce, d’autant plus que cette désignation du sujet humain
comme voué à maîtriser et à dévaster la nature, faisait l’impasse sur la double accentuation
moderne de la liberté, identifiée soit à celle du sujet proprement dit, soit à celle de l’individu,
avec pour valeurs distinctives celles de l’autonomie et de l’indépendance. Cette distinction, à
l’égard de laquelle la forme d’anti-humanisme qui a longtemps nourri la réévaluation de la
nature a cultivé une superbe indifférence, a ainsi privé des ressources réflexives offertes par la
différence entre un « moi » singulier et un « nous » collectif qui se représenterait comme
l’agent ultime de l’arraisonnement. De ce fait, l’individualisme a alors été tenu pour une
simple variante de l’humanisme avec lequel il s’agissait de rompre au bénéfice de la
reconnaissance par l’humanité d’autres droits que les siens propres, individuels ou collectifs :
droits de la nature, contrat naturel, éthique non humaine, éthique de la terre ou de la nature
sauvage – autant d’avatars d’une même option. Du moins les philosophes qui se sont engagés
dans les années 1970 ou 1980 dans ce type de questionnements puisaient-ils dans les
motivations anti-humanistes de leur démarche de quoi motiver, non sans contradictions
d’ailleurs (dans l’appel à une conscience éthico-environnementale mobilisant des valeurs,
celles du devoir notamment, peu compatibles avec l’option de l’anti-humanisme), les
personnes et les groupes humains à réparer ce que l’humanité moderne avait infligé à la
nature. Le processus qu’il s’agissait de combattre et d’inverser n’était pas sans sujet, mais le
sujet « grand S » qui en était la clé (la technique) pouvait apparaître, à quelques incohérences
près, comme susceptible d’être déconstruit par d’autres choix de valeurs que ceux de la
modernité – à commencer par le choix d’un autre mode d’être-au-monde que celui de
l’arraisonnement.

Ces convictions n’ont plus besoin, à vrai dire, d’être débattues aujourd’hui, dans la
mesure même où la problématique du changement climatique a reformaté entièrement la
conscience écologique. Deux points sont ici à souligner.
L’approche conduite à partir du changement climatique s’est brusquement recentrée
sur l’être humain lui-même, sur la qualité possible de sa vie, voire, à terme et dans les
scénarios les plus préoccupants, sur la possibilité de sa survie. De ce point de vue, les
questions d’« éthique climatique » excluent d’emblée les différentes versions d’un même
paradigme écocentriste. La promotion de la problématique climatique s’accomplit bien plutôt
dans la direction d’un nouvel anthropocentrisme partiellement déculpabilisé : loin de se
trouver déchiffrées et appréciées à partir des effets proprement écologiques de la pollution
atmosphérique, les injustices globales liées au changement climatique suscitent des
interrogations normatives portant en priorité sur les conséquences subies par les individus et
les collectifs humains. À affronter le paradoxe selon lequel les pays les plus vulnérables au
changement se trouvent avoir été, pour plupart et jusqu’à il y a peu, les moins responsables du
type de pollution considéré, se voient ainsi remises au premier plan aussi bien la valeur de
l’individualité que celle du sujet comme cette part de l’humain en nous qui a vocation à poser
des normes partagées, ici celles autour desquelles tous les individus auraient à se reconnaître
comme les partenaires solidaires d’un même destin global de humanité. De ce point de vue, il
est également significatif du tournant pris par la conscience environnementale qu’elle appelle
en outre, dans la problématique qu’elle affronte, les opinions publiques et les décideurs à se
soucier des humanités futures, appelées à partager un avenir incertain.
Le deuxième point à souligner mobilise de façon encore plus précise le philosophe
soucieux d’écologie, à supposer qu’il ait déjà thématisé la signification philosophique du
tournant qui vient d’être désigné. La question se pose en effet alors de déterminer comment le
nouveau paradigme du changement climatique et notamment de la lutte contre ses effets
d’inégalisation, pour ceux d’entre eux qui sont clairement injustes, peut mobiliser des acteurs
humains. La conscience environnementale, dans la phrase précédente, ouvrait sur la
représentation de gestes à ne plus faire et de gestes nouveaux se substituant aux précédents :
ces représentations pouvaient mobiliser les consciences éthiques et civiques, voire dicter des
politiques stato-nationales. La conscience « climatique », si on peut l’appeler ainsi, semble
plus démunie en matière de représentations d’agenda possibles pour les acteurs humains.
D’une part, que puis-je et dois-je faire comme individu, et même comme citoyen, pour
combattre la pollution atmosphérique et les changements qui en résultent, y compris sous la
forme de catastrophes, dans le système des climats ? D’autre part, comment puis-je me
représenter ce que je peux attendre de mon gouvernement ou de mon État, que je mandate
pour agir en mon nom, face à un phénomène dont les responsables sont si dilués dans l’espace
et dans le temps qu’ils tendent à échapper à toute identification ? De ces deux dépossessions,
celle que je subis comme individu particulier et celle que les individualités stato-nationales
subissent elles-mêmes, résulte cette représentation, identifiée plus haut, du changement
climatique comme constituant pour ainsi dire un processus sans sujet : quelle ruse de la raison
pourra faire en sorte que je puisse me représenter mes actes ou me représenter ceux de mes
gouvernants comme contribuant sans le savoir à ce processus pour, espérons-le quand bien
même nous ne pouvons aisément en être convaincus, plutôt le corriger ou le stopper que pour
l’accomplir ?
A suivre, parution du volume prévue en mai 2016, PUPS
1
/
3
100%