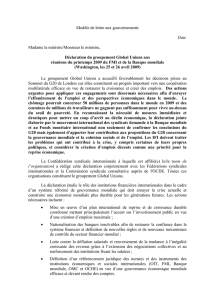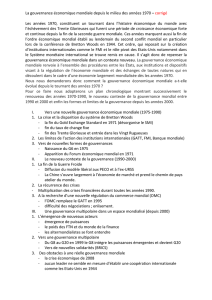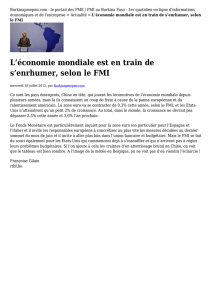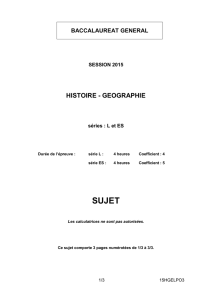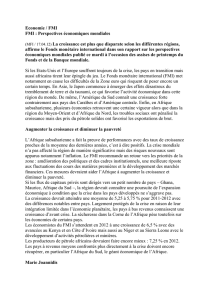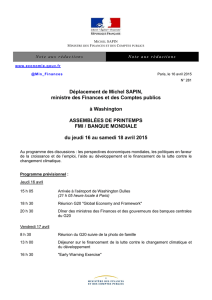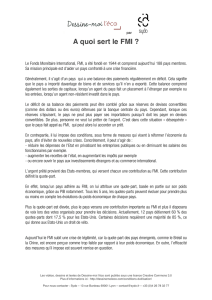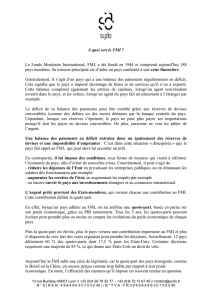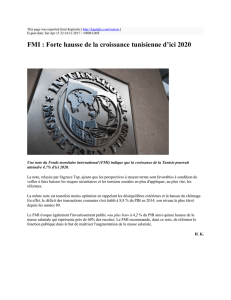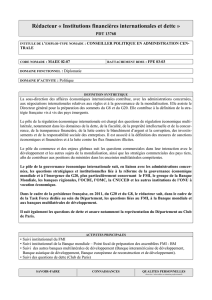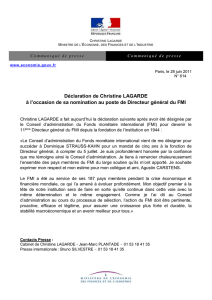Le système économique international est-il capable de se

1
Le système économique international est-il réformable ?
Notes pour une intervention à la conférence organisée par la Chambre de
commerce de Tripoli et le Centre universitaire franco-libanais
Tripoli, novembre 2010
C. Malone
Administrateur invité
ENAP Québec

2
Le système économique international est-il réformable ?
Début octobre 2010, les médias du monde entier diffusèrent l’image du
Directeur général du Fonds Monétaire international, Dominique Strauss-Kahn,
en conversation avec le gouverneur de la Banque centrale de Chine, Zhou
Xiaochuan, au début des instances conjointes du FMI et de la Banque
mondiale, avec la mention : échec des échanges à Washington pour mettre
fin à la guerre des devises. Un mois plus tôt, réunis en sommet à l’ONU à
New York, les dirigeants de la planète ne purent que constater que l’objectif
qu’ils s’étaient fixés au début du millénaire, soit d’éradiquer plusieurs des
manifestations de la pauvreté globale, ne serait pas atteint. Toutes les
réunions récentes des instances de l’Organisation mondiale du Commerce ne
font que confirmer ce que tous les observateurs savent depuis des années :
la ronde de Doha est dans un coma profond et le protectionnisme rode à
l’échelle de la planète. Seul motif d’espoir apparemment, dans les corridors
discrets à Bâle de la Banque des Règlements internationaux (BRI) les grands
banquiers des pays qui comptent dans l’univers progressent lentement sur la
voie d’une meilleure régulation du système bancaire mondial, par la voie
notamment d’un accroissement de leurs réserves obligatoires.
Ce tableau peu reluisant se présente alors que la planète est toujours en
proie à plusieurs manifestations de la crise la plus grave qu’elle ait connue
depuis celle des années trente. Les déséquilibres internes et externes en
termes de croissance et de revenus s’accroissent. Les déficits publics
explosent dans nombre de pays. On a recours aux mêmes armes de défense
économique que celles qui ouvrirent la voie au deuxième grand conflit
mondial. Les accords de Bretton Woods de 1944, que vinrent compléter les
Accords de Marrakech de 1995 (dans la mise en oeuvre desquels la BRI
s’insérera sans bruit à partir des années soixante-dix) étaient censés mettre
l’humanité à l’abri d’une faillite du système économique global. Ces accords,
naquirent essentiellement de réflexions et d’échanges entre économistes
américains et britanniques (Keynes et Harry White)) avant et pendant la
dernière guerre. Ils doivent leur existence aussi à une volonté de fer chez

3
quelques grands décideurs, comme Roosevelt, de ne plus voir se reproduire
les situations vécues au cours des années trente. On parvint, enfin, à les
conclure, parce que les Américains et, dans une bien moindre mesure, les
Britanniques avaient la capacité d’imposer leurs solutions à une communauté
internationale exsangue. La conjugaison de ces facteurs fit en sorte qu’un
ensemble cohérent de structures avec des mandats précis fut mis en place
progressivement, à partir de 1945.
Les quatre piliers du système et leurs dysfonctionnements
Ce système s’appuyait sur trois pôles : la gestion du système monétaire
international, confiée au Fonds monétaire international (FMI) ; la gestion du
relèvement de l’Europe dévastée par la guerre dans des conditions
totalement différentes de celles qui avaient été prévues à Versailles (le vaincu
payera), confiée à la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD), devenue la Banque mondiale; la gestion du système
commercial international, confiée à une Organisation internationale du
Commerce. Mort-née à La Havane en 1947, on la remplacera de manière
plus ou moins convaincante par l’Accord général des tarifs et du commerce,
le GATT, accord intergouvernemental ne pouvant prétendre au statut de
traité, qui put être mis en œuvre sans passer sous les fourches caudines du
Sénat américain.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) que nous connaissons
aujourd’hui, ne fera renaître le troisième pôle de Bretton Woods qu’un demi-
siècle plus tard. Le système, le FMI surtout, avait moins de dents que Keynes,
notamment, ne l’aurait souhaité. Sa proposition d’adopter une nouvelle devise
de réserve internationale, le Bancor, ne sera jamais acceptée par les
Américains, qui entendaient bien voir le dollar remplir ce rôle. Mais il avait le
mérite de la cohérence et d’une logique basée sur les leçons multiples
apprises pendant la grande crise.
Le problème majeur, c’est que le système n’a jamais fonctionné tel que ses
pères l’avaient conçu. Du fait de la non convertibilité quasi-absolue de toutes
les devises en 1945, y compris la Livre Sterling, le système de régulation de

4
celles-ci, prévu dans Bretton Woods, basé sur la convertibilité du dollar à 35$
l’once d’or, ne put voir le jour que pendant un période chaotique allant de
1958 (avec le retour à la convertibilité des principales devises européennes) à
1971. Le « Nixon Shock » mit alors fin au taux de convertibilité établi par
Roosevelt et toutes les monnaies se mirent à flotter les unes par rapport aux
autres, le FMI n’ayant plus pour vocation que de fonctionner comme simple
centre d’études.
La Banque mondiale n’a pas financé la reconstruction de l’Europe, les
Américains préférant finalement assumer cette tâche par le biais plurilatéral
du Plan Marshall. On peut affirmer que la BIRD n’a vraiment commencé à
fonctionner, c'est-à-dire à prêter de l’argent à des Etats pour le financement
de projets de développement, qu’à partir des années cinquante, lorsque les
tous premiers prêts seront accordés au Kenya (encore colonie) et à plusieurs
États latino-américains. Les plus grands emprunteurs de la Banque seront
d’ailleurs les Japonais et les Chinois, très loin du Rhin !
Le GATT, dénué de tout pouvoir exécutoire (ses décisions étaient prises par
consensus) connut des débuts très modestes au cours des années cinquante,
avant de fournir, aux pays de l’OCDE principalement, une enceinte productive
(la notion clef étant celle du principe de la nation la plus favorisée – la NPF)
qui permit, à travers le démantèlement des barrières douanières, à la
mondialisation contemporaine des échanges commerciaux de prendre son
envol.
La Banque des Réglements internationaux (BRI), pour sa part, avait été créée
au cours des années vingt pour gérer le mécanisme du remboursement des
dettes allemandes issues du Traité de Versailles, financé largement par des
emprunts aux Etats-Unis. En 1945, la Banque était dans une situation de
disgrâce quasi-totale, du fait de son rôle dans les échanges entre l’Allemagne
nazie et le reste du monde pendant la guerre. Mais ce cénacle des banquiers
centraux trouva rapidement des raisons d’exister comme lieu de concertation
entre grands décideurs bancaires, à l’abri des oreilles indiscrètes, au fur et à
mesure que l’économie mondiale se transforma sous l’effet de sa

5
financiarisation. L’objet principal des échanges internationaux au jour le jour
deviendrait, en effet, le dollar (et quelques autres devises) au début du XXIe
siècle.
À la recherche de vocations
Des quatre piliers du système, la BRI est certainement celui qui a su le mieux
coller aux besoins des acteurs et aux exigences de gestion des diverses
crises vécues à partir du premier choc pétrolier de 1973. On peut situer le
point de départ de ce processus, pour des fins anecdotiques, à la volonté du
Président Kennedy de réduire la fuite des fonds des grandes entreprises
américaines vers l’Europe, en imposant une taxe sur les sorties de capitaux.
La Banque pour l’Europe du Nord (banque soviétique bien connue, russe
aujourd’hui) chercha à éviter que ses avoirs en dollars à New York soient
saisis, en ouvrant des comptes en dollars à Londres, les premières
eurodevises non domiciliées aux États-Unis.
Les années soixante-dix furent extrêmement mouvementées sur le plan
financier. Outre la dénonciation de la convertibilité du dollar, on assista à deux
chocs pétroliers brutaux. Malgré l’importance de ces perturbations, les
grandes puissances économiques préférèrent ne pas confier aux organes
formels du système le règlement des problèmes, si ce n’est sous l’angle de la
gestion de la situation des pays en voie de développement. Le FMI se vit
essentiellement confier le rôle de gérer la crise des pétrodollars et ensuite ses
conséquences, par le biais notamment des fameux plans d’ajustement
structurels à volets multiples. A l’abri de majorités indisciplinées et de
discours tiers-mondistes, des mécanismes comme le G5, devenu ensuite le
G7, puis le G8, permettaient aux principaux protagonistes de trouver entre
eux des solutions imposables au reste du monde, au besoin : les Accords du
Plaza de 1985 constituent un prototype de ce genre de mesure.
La Banque mondiale, pour sa part, tout en poursuivant son activité de prêteur
à des pays solvables, s’est trouvée une nouvelle vocation à travers
l’Association internationale pour le développement (AID), financée par des
contributions volontaires des pays riches, en vue de soutenir le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%