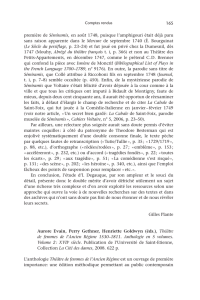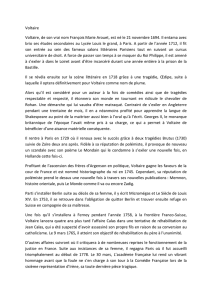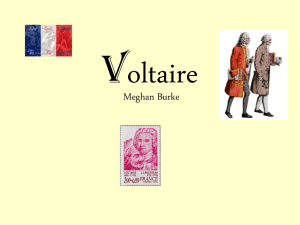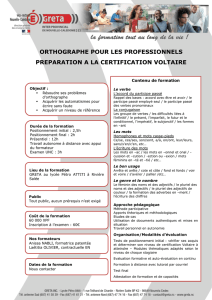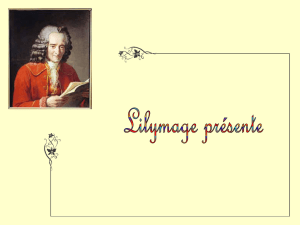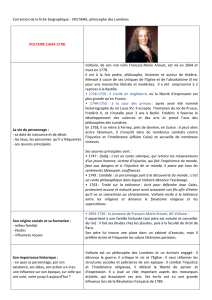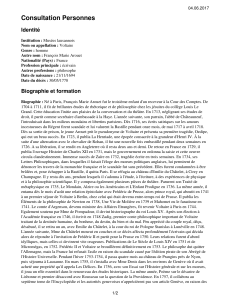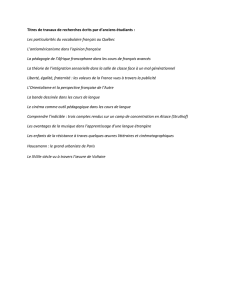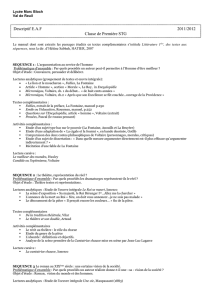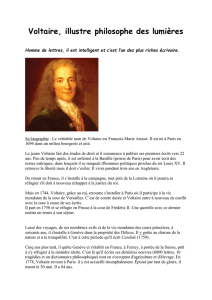023 - Messaoudi

La dimension philosophique de
Sémiramis
Abderhaman Messaoudi
Cet article est issu d’une communication prononcée dans le cadre des
Journées d’études du centre Ledoux. Ces journées, placées sous le thème «“Bête –
ou créative – comme la Paix” ? La situation des arts en 1748», ont eu lieu à
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne les 7 et 8 juillet 2006. Mon étude
ouvrait l’atelier consacrée à la Sémiramis de Voltaire.
Cette pièce de Voltaire dont la première représentation eut lieu le 29
août 1748 pouvait bien être soupçonnée d’être exemplaire de la période
considérée. Ma première idée de communication m’avait d’ailleurs amené à
envisager Sémiramis comme «un cas exemplaire de la situation de l’art
dramaturgique en France en 1748». L’intérêt d’étudier cette pièce est en
effet soutenu par des motifs multiples. De manière plus générale, il faudrait
d’abord souligner que le théâtre de Voltaire est particulièrement
représentatif des recherches et innovations théâtrales de ses contemporains.
Cela motive un regain d’intérêt de la recherche pour la figure du
dramaturge, qui était tombée dans l’oubli et se trouvait donc relativement
négligée jusqu’ici. Norbert Sclippa, auteur d’un Essai sur les tragédies de
Voltaire qui a contribué à ouvrir la voie, remarque: « Il ne faut pas oublier
que les tragédies de Voltaire sont aussi un témoignage essentiel sur la
sensibilité et le goût artistique de son temps, pour la compréhension duquel
elles nous offrent un vaste champ d’investigation, que nous ne saurions
négliger sans nous condamner à un appauvrissement de nos
connaissances»
1
.
Il cite encore Martine de Rougemont : «Voltaire est pour le XVIII
e
siècle
le grand carrefour de toutes les recherches théâtrales, le grand inspirateur de
toutes les initiatives»
2
. Norbert Sclippa met également en avant «d’autres
raisons, plus purement littéraires, pour lesquelles les tragédies de Voltaire
devraient être étudiées, puisque son théâtre représente un lien de transition
essentiel entre la tragédie classique et le drame romantique»
3
. On connaît
également le besoin de l’écrivain français de plaire au public et de coller au
plus près de ses exigences, sa dimension de critique littéraire et son
attention anxieuse à l’actualité théâtrale du moment, la place exceptionnelle
qu’a tenue son théâtre à son époque.
Sémiramis fournit dans ces conditions un cas d’investigation d’autant plus
exemplaire que Voltaire a fait précéder la pièce d’une préface où il expose sa

Abderhaman Messaoudi
AnnalSS 7, 2010
282
poétique et sa conception du théâtre et notamment ses vœux touchant à
l’amélioration de la scène. Dans cette Dissertation sur la tragédie ancienne et
moderne, Voltaire exprime son désenchantement mêlé d’admiration pour
Shakespeare, sa grande admiration pour Metastasio, il manifeste son goût
pour l’opera seria, le dramma per musica et définit sa poétique en référence au
théâtre grec. La tragédie de Sémiramis présente plusieurs autres centres
d’intérêt. On sait notamment qu’avec Sémiramis, qui se révèle être «la plus
mélodramatique des tragédies du poète»
4
, Voltaire fait accomplir au théâtre
un pas décisif vers le drame voire le mélodrame. Cette pièce a également
inspiré les livrets de douze opéras, dont notamment celui de la Semiramide
(1823) de Rossini. Elle a donné lieu à des parodies. Il serait également
possible de suivre les différents avatars de la pièce, qui se trouve être un
remaniement d’Ériphyle (1732) ou encore d’analyser les rapports qu’elle tisse
avec la pièce de Crébillon ou même avec Athalie de Racine
5
.
Je me propose d’étudier ici la dimension philosophique de Sémiramis.
D’une certaine manière, le sujet que je me propose de traiter a été déjà
abordé à l’intérieur d’études plus vastes. Je m’appuierai donc notamment sur
deux travaux, de Robert Niklaus (1963) et de Ronald Ridgway (1961). Le
théâtre de Voltaire semble fournir une bonne illustration des rapports que
peuvent nouer l’art et la philosophie. Ainsi, pour Robert Niklaus, «c’est
assurément par Voltaire qu’il convient d’entamer une étude de la
propagande philosophique»
6
. Un autre spécialiste de Voltaire a d’ailleurs
écrit que «la philosophie, chez Voltaire, est généralement théâtrale, comme
le théâtre est souvent philosophique» (Menant 1995: 53).
Cela dit, il convient d’abord de résumer l’histoire de la pièce. Celle-ci est
centrée sur la Reine de Babylone, Sémiramis. Pour régner, elle a fait périr
son mari Ninus avec la complicité d’Assur. Mais, prise de remord,
Sémiramis est tourmentée par l’esprit de Ninus. Cependant elle a fait venir à
la Cour Arzace, un jeune guerrier. Sémiramis en est amoureuse et après
avoir consulté les oracles, projette de se marier avec lui. Mais celui-ci est
épris de la princesse Azéma, ce qui en fait le rival d’Assur. A la fin de la
pièce, le spectre de Ninus apparaît à la Cour et ordonne à Arzace de venir à
son tombeau pour un sacrifice. Par mégarde, Arzace tue Sémiramis en
croyant tuer Assur. Le grand prêtre Oroès révèle alors à tous la véritable
identité d’Arzace : c’est Ninias, le fils de Ninus et de Sémiramis et qu’Assur
pensait avoir fait périr. Assur est arrêté et, avec la permission de Sémiramis
expirante, Ninias hérite du trône et obtient la main d’Azéma qui était
d’ailleurs promise au prince héritier.
La question de la dimension philosophique de Sémiramis n’est pas sans
difficulté. La première difficulté tient à la polysémie du mot philosophie lui-

La dimension philosophique de Sémiramis
AnnalSS 7, 2010
283
même. La définition de la philosophie est en effet extensive. Ce fait est
particulièrement sensible si l’on considère l’époque des Lumières:
Quand on traite de la «philosophie» du XVIII
e
siècle, il faut abattre les
cloisons que le positivisme du siècle suivant dressa entre métaphysique et
science. La «philosophie», et d’abord celle des Lettres philosophiques, est un
mélange de métaphysique, de science, d’attaques contre la religion et
d’audaces politiques. Et quand nous disons un mélange, nous restons
tributaires d’un mode de pensée qui était étranger aux «philosophes» du
XVII
e
siècle, l’unité de la « philosophie » leur apparaissant aussi essentielle
qu’à nous les distinctions entre les trois domaines métaphysiques,
scientifique et polémique (Pomeau 1956: 185-186).
La philosophie inclue d’ailleurs non seulement une dimension critique et
politique, mais aussi une dimension morale. La figure du philosophe peut se
rapprocher de celle du moraliste et du satiriste au point parfois de se
confondre avec elles. Cependant, il ne faudrait pas croire que nous avons
affaire à une conception de la philosophie totalement étrangère à notre
monde moderne, puisque le philosophe a toujours été en quelque sorte celui
qui se mêle des affaires de la cité.
Le deuxième ordre de difficulté renverrait à la mise en œuvre
problématique de la philosophie au théâtre. Les contraintes sont en effet
nombreuses et, notamment chez Voltaire, l’alliance entre la tragédie de
facture, ou du moins d’inspiration classique, et d’une philosophie moderne
peut apparaître comme particulièrement artificielle
7
. Cette tension est celle
qu’on retrouve chez le personnage lui-même. En effet, Voltaire est classique
par son goût, son admiration esthétique des grands modèles du siècle
précédent, son mépris de l’art géométrique. Il est moderne par ses idées, sa
conception de la tâche d’un écrivain.
Il peut donc exister des contradictions entre le dramaturge et le
philosophe et Voltaire peut donner l’impression d’hésiter, car il est
conscient de cette tension contradictoire entre les exigences de l’art et celle
de la philosophie. De nombreuses déclarations de Voltaire vont dans le sens
d’une conception de l’art comme instrument de la morale ou comme
véhicule de la philosophie
8
. Cette conception se retrouve bien sûr dans la
Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne. Ce texte sert de préface à
Sémiramis et voici ce que Voltaire y déclare : «La véritable tragédie est l’école
de la vertu ; et la seule différence qui soit entre le théâtre épuré et les livres
de morale, c’est que l’instruction se trouve dans la tragédie toute en action,
c’est qu’elle y est intéressante, et qu’elle se montre relevée des charmes d’un
art qui ne fut inventé autrefois que pour instruire la Terre et pour bénir le
ciel, et qui, par cette raison fut appelé le langage des dieux»
9
.

Abderhaman Messaoudi
AnnalSS 7, 2010
284
Voltaire est cependant conscient de tout ce qui peut parfois séparer l’art
de la philosophie et qu’on ne saurait les confondre. Le 20 décembre 1738, il
déclare ainsi dans une lettre à Jean Baptiste Nicolas Formont: «Je me flatte
du moins que le compas des mathématiques ne sera jamais la mesure des
mes vers; et si vous avez versé quelques larmes à Zaïre ou à Alzire, vous
n’avez point trouvé parmi les défauts de ces pièces là l’esprit d’analyse, qui
n’est bon que dans un traité de philosophie, et la sécheresse, qui n’est bonne
nulle part »
10
.
Cela dit, la philosophie des Lumières, peut à première vue apparaître
absente de la Sémiramis de Voltaire. Celui-ci est censé être l’ennemi du
moralisme et de la tradition. Or, avec cette pièce, il prône une morale
apparemment conventionnelle et semble défendre l’orthodoxie. A lire sa
préface, il n’aurait écrit la pièce que pour illustrer la maxime d’« un dieu
vengeur » punissant les crimes secrets :
On voit, dès la première scène, que tout doit se faire par le ministère céleste ;
tout roule d’acte en acte sur cette idée. C’est un dieu vengeur qui inspire à
Sémiramis des remords, qu’elle n’eût point eus dans ses prospérités, si les
cris de Ninus même ne fussent venus l’épouvanter au milieu de sa gloire.
C’est un dieu qui se sert de ces remords mêmes qu’il lui donne pour préparer
son châtiment ; et c’est de là même que résulte l’instruction qu’on peut tirer
de la pièce. Les anciens avaient souvent, dans leurs ouvrages, le but d’établir
quelque grande maxime ; ainsi Sophocle finit son Œdipe en disant qu’il ne
faut jamais appeler un homme heureux avant sa mort : ici toute la morale de
la pièce est renfermée dans ces vers:
…Il est donc des forfaits
Que le courroux des dieux ne pardonne jamais!
Maxime bien autrement importante que celle de Sophocle. Mais quelle
instruction, dira-t-on, le commun des mortels peut-il tirer d’un crime si rare
et d’une punition plus rare encore? J’avoue que la catastrophe de Sémiramis
n’arrivera pas souvent ; mais ce qui arrive tous les jours se trouve dans les
derniers vers de la pièce :
…Apprenez tous du moins
Que les crimes secrets ont les dieux pour témoins
11
.
Il faudrait évidemment faire la part de l’exagération et de l’opportunisme
et tenir compte du souci chez Voltaire de désarmer la censure dans cette
dissertation dédiée au cardinal Quirini. Cependant force est de constater que
même dans sa correspondance privée, Voltaire appelle sa pièce un «livre de
morale»
12
. Un critique de l’époque note que Sémiramis «a une couleur
religieuse et une teinte de superstition diamétralement opposée à cet esprit
philosophique qui distingue les ouvrages de Voltaire»
13
. Force aussi est de
constater que dans la pièce elle-même, c’est effectivement une morale

La dimension philosophique de Sémiramis
AnnalSS 7, 2010
285
fondée sur la crainte d’un Dieu vengeur qui est défendue. Comme le déclare
le prêtre Oroès:
Mais on ne peut tromper l’œil vigilant des dieux:
Des plus obscurs complots il perce les abîmes
(M, t. IV: 513, I, 3)
Les mots-clefs qui sont prononcés par la reine coupable sont «remords»,
«crainte», «justice», «vengeance»:
Croyez-moi, les remords, à vos yeux méprisables,
Sont la seule vertu qui reste à des coupables
(M, t. IV: 532, II, 7)
Cette crainte n’est pas honteuse au diadème ;
Elle convient aux rois
(M, t. IV: 532, II, 7)
La crainte suit le crime, et c’est son châtiment.
(M, t. IV: 557, V, 1)
on peut, sans s’avilir,
S’abaisser sous les dieux, les craindre, et les servir.
(M, t. IV: 532)
La vérité terrible est du ciel descendue,
Et du sein des tombeaux la vengeance est venue.
(M, t. IV: 550, IV, 2)
Éternelle justice,
Qui lisez dans mon âme avec des yeux vengeurs,
(M, t. IV: 537, III, 2)
Oroès déclare encore que :
Du ciel, quand il le faut, la justice suprême
Suspend l’ordre éternel établi par lui-même
(M, t. IV: 536, III, 2, Oroès)
Voltaire, philosophe des Lumières, est censé être anti-clérical. Or avec le
personnage d’Oroès, Voltaire fournit un modèle de «bon prêtre». Il a
d’ailleurs écrit à son ami Thiériot : «Je mets sur la scène un grand prêtre qui
est un honnête homme» (10 août 1746, D 3 444). Interprète de la volonté
divine, ce grand prêtre tient effectivement un rôle important et montre au
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%