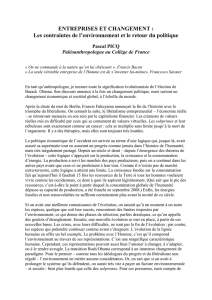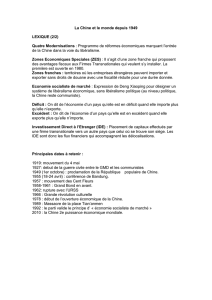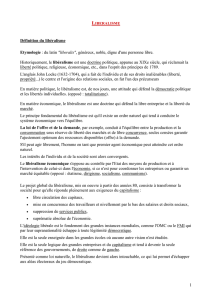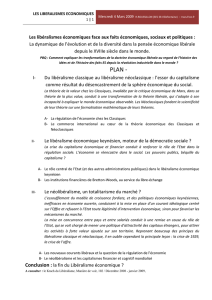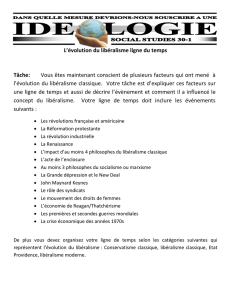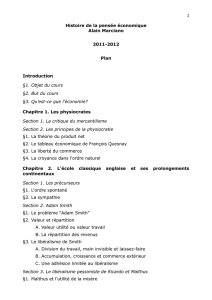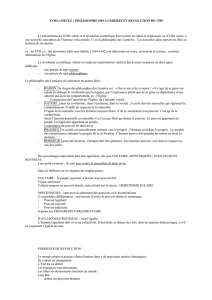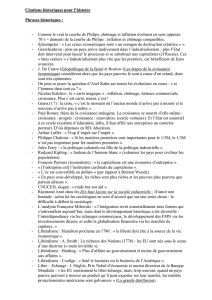Vers une neutralité épaisse ? Libéralisme politique et

1
Vers une neutralité épaisse ?
Libéralisme politique et libéralisme compréhensif
Alain Policar
Chez Rawls, on le sait, les doctrines compréhensives sont caractérisées par la
prétention à la vérité universelle et/ou une conception de la nature essentielle de
l’homme. Le libéralisme politique rawlsien, s’appliquant exclusivement aux
questions politiques et sociales, se veut profondément différent. Alors que les
doctrines compréhensives, autrement dit globales, sont l’œuvre de la raison
théorique et non de la raison pratique et, dès lors, cultivent « naturellement » une
prétention au vrai, la problématisation rawlsienne consacre la supériorité du
raisonnable. Dans les sociétés contemporaines caractérisées par le pluralisme
éthique, le fait du pluralisme raisonnable est « le résultat inévitable des facultés de la
raison humaine à l’œuvre dans le cadre d’institutions à la fois libres et durables »1.
Le libéralisme politique met ainsi l’accent sur « la capacité de chacun à raisonner de
façon autonome plutôt que sur la valeur de l’autonomie »2, tandis que le libéralisme
compréhensif estime qu’il est bon d’être autonome et, ainsi, peut assigner pour
tâche aux institutions politiques l’obligation de protéger et de favoriser l’autonomie
de chacun3. Il s’agit fondamentalement pour le premier d’éviter d’avoir recours à
une conception profonde de la nature humaine, ainsi que le font Kant et Mill, pour
justifier le libéralisme4.
1 Rawls, Libéralisme politique, trad. fr., Paris, PUF, 1995, p. 75.
2 Munoz-Dardé, « Le partage des raisons », Revue de philosophie économique, no 7,
premier semestre 2003, p. 98.
3 Celle-ci n’est donc pas présumée. L’Etat est fondé à intervenir, non seulement
pour la protéger, mais également pour la développer. Ce paternalisme est, à notre
sens, parfaitement compatible avec le libéralisme. On consultera, avec profit,
Magni-Berton, « Care, pzternalisme et vertu dans une perspective libérale », Raisons
politiques, 44, nov. 2011, pp. 139-162.
4 Sur ce point important, voir Larmore, Modernité et morale, trad. fr., Paris, PUF,
1993, p. 161-191.

2
Ce refus de fonder une théorie politique sur une conception essentielle de
l’homme est extrêmement (excessivement ?) prudent. Ne conduit-il pas à sacrifier
l’universalisme moral, ce dernier constituant à l’évidence une doctrine
compréhensive ? Or la négation d’un lien consubstantiel entre libéralisme et
universalisme soulève d’importantes difficultés. Est-on contraint d’en payer le prix ?
L’exigence d’une universalité consistante, c’est-à-dire pleine (par opposition à
l’universalité vide, telle que la défend Alain Renaut), implique-t-elle de renoncer au
pluralisme ?
Il existe donc une rupture conséquente entre le libéralisme politique de Rawls et
le libéralisme classique. Elle tient à la neutralité des fondements (et non seulement
des procédures) dans le premier nommé. Est-il réellement inenvisageable de fonder
les institutions publiques sur une conception plus substantielle, une conception du
bien capable d’inclure des valeurs libérales essentielles ? Est-il réellement
chimérique de concevoir un État dont le rôle serait de garantir les conditions visant
à augmenter les possibilités d’accéder à une vie meilleure ? Peut-on exclure a priori
une conception téléologique des fondements des politiques publiques ? L’argument
essentiel de Rawls pour établir la priorité du juste sur le bien tient à l’idée que les
controverses sur celui-ci sont plus prégnantes que les débats sur celui-là. Mais est-
ce certain ? L’idée de construire une théorie politique exclusivement sur une base
déontologique ne s’impose pas comme la seule voie possible. Peut-être est-il au fond
plus réaliste (et plus modeste) de se fonder sur l’expérience humaine et, tout
particulièrement, sur les biens qui, à nos yeux, rendent notre vie meilleure ? Le
libéralisme politique, en se détachant de toute conception « métaphysique », nous
semble impuissant face à la critique communautarienne. Privé de toute profondeur
morale, se refusant, de peur d’affaiblir sa prétention à la neutralité, à affirmer sa
préférence pour des valeurs fondées sur l’autonomie, il s’expose au risque de la

3
contingence, voire de l’insignifiance5. L’évolution de Rawls de 1971 à 1993 me
paraît renoncer à une part importante de ce qui fait le prix du libéralisme
philosophique.
Le point nodal est certainement la « méthode d’évitement », stratégie visant à
éviter d’avoir à affronter la question de la vérité. L’« abstinence épistémique » de
Rawls, qui implique, pour les citoyens, la recommandation de n’avoir recours qu’à
des « vérités simples », s’accorde avec la vision d’une société composée d’individus
incapables de réviser leurs conceptions du bien. Comme le remarque Speranta
Dumitru, « ce n’est pas respecter la liberté de quelqu’un que de lui offrir
uniquement des raisons compatibles avec sa conception du bien »6, « la recherche
de bonnes raisons, nécessaires et suffisantes, et non pas de raisons que les autres
peuvent accepter, semble plus respectueuse des autres »7. Bref, le sacrifice des
normes épistémiques est loin d’apporter le résultat escompté.
Limites du neutralisme strict
On peut, en outre, difficilement nier que les conceptions strictement neutralistes
constituent un infléchissement majeur par rapport au libéralisme du XIXe siècle et
du début du XXe. Le neutralisme occupe en effet, dans les approches de Rawls,
Larmore et Dworkin (du moins, le Dworkin de 1978), la position première que
détenaient des valeurs telles que la souveraineté individuelle et l’autonomie. Dans
un article de 20038, Arneson, après avoir longtemps appartenu au courant
strictement neutraliste, n’hésite pas à proposer une ferme critique de cette
primauté.
5 Voir Hampton, « Should Political Philosophy be Done without Metaphysics ? »,
Ethics, 99 (4), 1989, pp. 791-814.
6 Dumitru, « La raison publique : une conception politique et non épistémologique »,
Archives de philosophie du droit, 49, 2005, p. 168.
7 Ibid., p. 169.
8 Arneson, « Liberal Neutrality on the Good : An Autopsy », in Perfectionism and
Neutrality, S. Wall and G. Klosko (eds.), Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2003,
pp. 191-208.

4
Une approche comparable, bien que distincte, est développée par Thomas Pogge.
Ce dernier présente un ensemble de distinctions visant à déterminer la signification
du flourishing, terme que l’on peut traduire par épanouissement et qui tend à
préciser ce qu’il convient d’entendre lorsque l’on évoque la réalisation d’une vie
bonne. Il est incontestable que donner du crédit à ce type d’analyses implique de
considérer le bonheur et l’épanouissement comme l’un des buts de l’action
humaine. Et, plus encore, de concevoir ces buts comme dérivés de la nature
humaine. Or il est difficile de nier que, pour Rawls et de nombreux libéraux
contemporains, la référence à une nature de l’homme est sans pertinence.
L’une des importantes questions posées par ces tentatives est celle de savoir s’il
est possible de défendre une neutralité de l’État qui ne tiendrait aucunement
compte d’un éventuel consensus sur des valeurs substantielles. Il est incontestable
qu’une société n’est libérale que si ses membres sont libres de pratiquer des modes
de vie différents. Le libéralisme est certes contraint de reconnaître la subjectivité
des valeurs et de noter la persistance du conflit moral. Cette réalité n’implique
cependant pas de renoncer à la défense de nos convictions. Il est donc non
seulement acceptable mais nécessaire de donner une épaisseur à la neutralité. Il
s’agit, dans cette optique, de préserver les valeurs libérales fondamentales, la
souveraineté individuelle, le pluralisme, la tolérance, pour éviter le reproche,
généralement, et à bon escient, adressé au perfectionnisme, de vouloir imposer un
mode de vie spécifique.
Il nous faut donc montrer qu’il existe une forte complémentarité entre le juste et
le bien qui fragilise l’opposition canonique entre déontologie et téléologie. Cette
complémentarité n’est d’ailleurs pas niée par Rawls lui-même : « On pourrait penser
qu’une conception libérale de la justice ne peut pas faire appel à une idée du bien,
sauf peut-être à celles qui sont purement instrumentales ou qui résultent de
préférences ou de choix individuels. Il s’agit d’une interprétation erronée car le juste

5
et le bien sont complémentaires ; aucune conception de la justice ne peut s’inspirer
uniquement de l’un ou de l’autre »9. Le philosophe américain ne se réfère-t-il pas, à
cinq idées du bien, que l’on trouve, dit-il, dans la théorie de la justice comme
équité : « 1/ L’idée du bien comme rationalité, 2/ l’idée de biens premiers, 3/l’idée
de conceptions compréhensives et acceptables du bien (associées à des doctrines
compréhensives), 4/ l’idée de vertus politiques, 5/ l’idée du bien représenté par une
société (politique) bien ordonnée »10. Cette énumération se retrouve, à peu près dans
les mêmes termes, dans un article de 198811. Doit-on en conclure qu’une théorie
déontologique, telle que la théorie kantienne, ne peut éviter le recours à une idée du
bien ? Il faudrait, pour l’éviter, être en mesure d’établir des principes éthico-
politiques sans se préoccuper des fins et des motivations des hommes. Est-ce
réellement envisageable ? Il semble dès lors possible, et souhaitable, de poser la
compatibilité entre poursuivre des fins et respecter des principes de justice. On ne
peut donc être insensible à la volonté de certains auteurs de fonder les politiques
publiques, dans le respect des valeurs libérales fondamentales, sur une conception
du bien humain12.
Le libéralisme peut-il constituer un langage normatif neutre ?
9 Rawls, op. cit., 1995, p. 215.
10 Ibid., p. 218.
11 Rawls, « The Priority of the Right and Ideas of the Good », Philosophy & Public
Affairs, 17 (4), 1988, pp. 251-276. Cet important article reprend, en le révisant et
l’élargissant, le propos d’une conférence donnée à Paris le 21 mars 1987.
12 Tel Arneson qui fournit une liste de biens de nature à favoriser une vie bonne :
« Pleasurable experience and especially enjoyment of the excellent
Satisfaction of reasonable life aims
Relationships of friendship and love
Intellectual and cultural achievement
Meaningful work
Athletic excellence
Living one’s life according to autonomously embraced values and norms
Systematic understanding of the causal structure of world », Arneson, 2003, art.
cit., pp. 207-208.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%