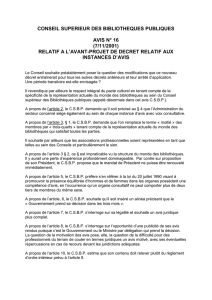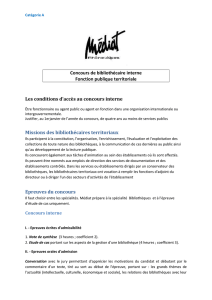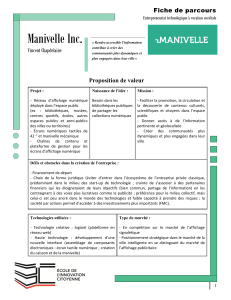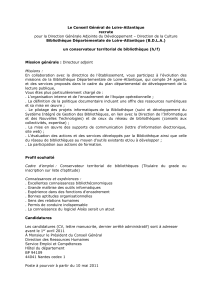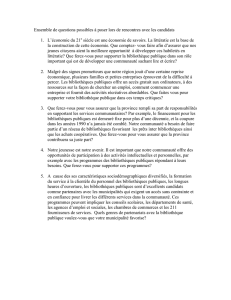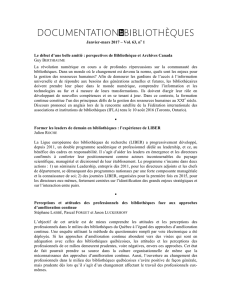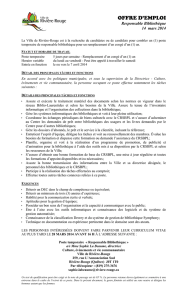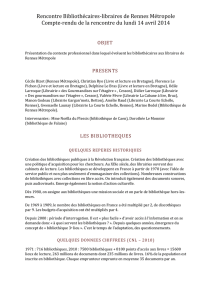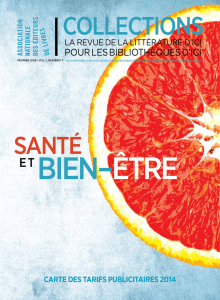Les bibliothèques françaises sous l`Occupation - DUNE

Les bibliothèques
françaises sous
l’Occupation
Lemarié Aliénor
2013-2014
Master 1 Histoire du document
Parcours bibliothèque
Sous la direction de Mme Valérie Neveu
Soutenu publiquement le :
18 juin 2014

L’auteur du présent document vous
autorise à le partager, reproduire,
distribuer et communiquer selon
les conditions suivantes :
Vous devez le citer en l’attribuant de la manière indiquée par l’auteur (mais pas
d’une manière qui suggérerait qu’il approuve votre utilisation de l’œuvre).
Vous n’avez pas le droit d’utiliser ce document à des fins commerciales.
Vous n’avez pas le droit de le modifier, de le transformer ou de l’adapter.
Consulter la licence creative commons complète en français :
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.0/fr/

REMERCIEMENTS
J’adresse mes remerciements aux personnes qui m’ont aidée à la réalisation de ce mémoire.
En premier lieu, je remercie ma directrice de mémoire, Mme Neveu maitre de conférence à
l’université d’Angers, qui m’a guidée dans mon travail et m’a aidé à trouver des solutions pour
avancer.
Je remercie également la bibliothèque municipale d’Angers qui m’a donné accès à ses archives
et m’a fourni de précieuses informations pour l’élaboration de cette étude.
Enfin, je remercie les archives départementales du Maine-et-Loire et municipales d’Angers qui
ont su répondre à mes questions et m’orienter dans mes recherches.

mots-clés :
Guerre mondiale (1939-1945), destructions et pillages, restitutions, histoire du livre, histoire des
bibliothèques, bibliothécaires, censure, livres et lectures, Angers (Maine-et-Loire).
keywords :
World War (1939-1940), destruction and plundering, restitutions, history of book, history of libraries,
librarians, censorship, books and reading, Angers (Maine-et-Loire).
RÉSUMÉ
La politique culturelle des Allemands sous l’Occupation atteint l’ensemble des bibliothèques. Les
bibliothèques privées et institutionnelles sont pillées et les livres transportés en Allemagne. Les
Allemands contrôlent et surveillent les lectures des Français dans les bibliothèques publiques par
la censure. Les bibliothécaires tentent de protéger leurs collections de la guerre, en évacuant les
ouvrages les plus précieux vers des lieux sûrs et loins des combats. Tout comme les livres, ils sont
catégorisés par l’occupant, selon leurs origines étrangères, juives, ou leur appartenance à la franc-
maçonnerie. C’est une histoire encore méconnue que celles des bibliothèques sous l’Occupation,
et ce mémoire a pour but de participer à son élaboration, en écrivant une page d’histoire locale sur
les bibliothèques publiques d’Angers.
ABSTRACT
The German’s cultural policy in France during the Occupation strikes all the libraries. The private
libraries and institutions are plundered and the books are sent to Germany. By using censorship
the German are able to keep a close watch over the reading in public libraries. The librarians try
to protect their collections from the war by evacuating the most valuable books to safe places, far
away from the battlefield. Like their books, they are categorized by the Nazis, according to their
foreign or Jews origins, or their allegiance to the Freemasonry. The history of the French libraries
during the Occupation is still unknown. The goal of this essay is to make known this unique page
of history and to bring some new insights through a local study of the public libraries of Angers.

Lemarié Aliénor | Les bibliothèques françaises sous l’Occupation 1
Sommaire
SOMMAIRE ........................................................................................................................... 1
SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................................... 2
INTRODUCTION .................................................................................................................... 3
PARTIE 1 : HISTORIOGRAPHIE............................................................................................. 5
1.
Une histoire négligée ............................................................................................... 5
2.
Après la guerre ........................................................................................................ 6
3.
De 1995 à nos jours ................................................................................................. 8
4.
Et les bibliothèques ? ............................................................................................. 10
PARTIE 2 : LES BIBLIOTHEQUES FRANÇAISES SOUS L’OCCUPATION ................................. 13
1.
Des bibliothèques au plein cœur du conflit ............................................................ 13
2.
Pillages .................................................................................................................. 21
3.
Censure et lecture ................................................................................................. 33
4.
Les bibliothécaires sous l’occupation ..................................................................... 47
CONCLUSION ...................................................................................................................... 54
PARTIE 3 : LES BIBLIOTHEQUES D’ANGERS ....................................................................... 56
1.
Angers, siège de l’administration allemande ......................................................... 56
2.
Défense passive ..................................................................................................... 62
3.
Organisation de la censure et de la lecture ............................................................ 71
CONCLUSION ...................................................................................................................... 80
ANNEXES ............................................................................................................................ 82
BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES............................................................................................. 91
1.
Livres ..................................................................................................................... 91
2.
Articles .................................................................................................................. 93
3.
Sitographie ............................................................................................................ 94
4.
Archives ................................................................................................................. 94
TABLE DES ILLUSTRATIONS ............................................................................................... 99
TABLE DES TABLEAUX ...................................................................................................... 100
TABLE DES ANNEXES ........................................................................................................ 101
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
1
/
107
100%