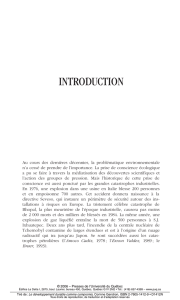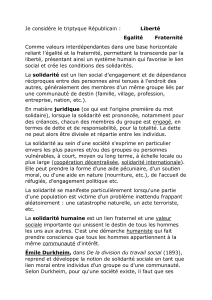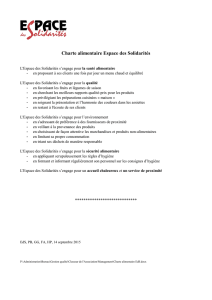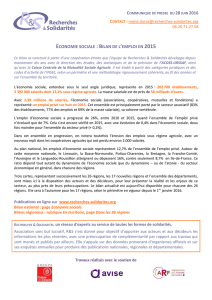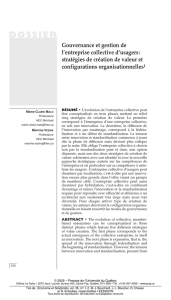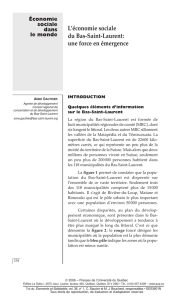Les critères de mesure de la richesse et de l`utilité sociales

1
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M. J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Présentation
L’affaiblissement de la cohésion sociale, la dissolution
des liens sociaux apparaissent, en ce début de siècle,
comme des préoccupations lancinantes partagées
par de nombreux acteurs sociaux et par les États
nationaux. Toutefois, parallèlement à ces liens qui
se défont, d’autres se refont et, dans leur sillage,
se manifestent de nouveaux besoins, de nouvelles
aspirations et demandes sociales. Ni le marché, ni
l’État ne peuvent assurer, seuls, la satisfaction de
l’ensemble de ces demandes. L’insuffisance des
finances publiques, les inefficiences du mode centra-
lisé de production et de livraison de services, la dimi-
nution globale de la capacité instrumentale des États
obligent à revoir la portée et l’ampleur de l’interven-
tion publique. Les failles du marché, les inégalités
sociales qui en résultent ainsi que l’absence d’entre-
preneurs capitalistes dans de nombreux créneaux de
la demande sociale empêchent de laisser « tout au
marché ». De nombreuses initiatives menées par les
entreprises collectives (coopératives, organisations
à but non lucratif, mutuelles, fonds de travailleurs)
sont apparues depuis deux décennies. Ces initiatives
mettent en œuvre des activités économiques visant à
répondre à de nouvelles aspirations et à de multiples
besoins sociaux.
Aussi, nous posons-nous les questions
suivantes. Quelle est donc la contribution qu’ap-
portent ces entreprises collectives à la création de
la richesse ? Quels sont les critères ou indicateurs
de mesure de cet apport ? Selon Méda (1999), nous
Carol SauCier
Professeur
Département
des sciences humaines
Université du Québec à Rimouski
Carol_saucier@uqar.qc.ca
Les critères de mesure
de la richesse et de l’utilité
sociales produites par
les entreprises collectives

2 Économie et Solidarités, volume 36, numéro 1, 2005
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
pouvons distinguer deux dimensions de la richesse : les dimensions écono-
mique et sociale. Méda explique qu’une partie de cette richesse réside dans
la préservation de l’environnement naturel, dans l’amélioration de la santé
et l’éducation, dans l’amélioration du caractère démocratique et solidaire de
nos sociétés. Voilà ce qu’elle appelle le patrimoine social ou la richesse sociale,
ensemble de biens collectifs qui nous sont essentiels pour bien vivre en société.
La préoccupation première des entreprises collectives n’est pas seulement
de contribuer à l’accroissement du produit intérieur brut (PIB), mais aussi
de répondre aux besoins non comblés ou mal satisfaits des individus et des
collectivités. Par conséquent, elles visent à la fois la rentabilité économique et
la rentabilité sociale de leurs activités. L’entreprise collective peut être jaugée
à l’aune de la rentabilité économique ou à celui de la réalisation de surplus,
mais ne doit-elle pas l’être également à l’aune de la rentabilité sociale, de
l’utilité sociale ou encore de la richesse sociale que ses activités procurent ?
En d’autres mots, n’avons-nous pas besoin d’indicateurs de richesse plus
larges et différenciés que le seul PIB, qui lui concerne avant tout les produits
et services échangeables sur le marché ? À cet égard, le débat n’est pas récent
puisque Jean-Baptiste Say, dans un ouvrage d’économie politique publié
en 1803, écrivait qu’il n’y a véritablement production de richesse que là où il
y a création ou augmentation d’utilité. Say entendait par utilité : « cette faculté
qu’ont certaines choses de pouvoir satisfaire aux divers besoins des hommes »
(Méda, 1999, p. 45). En ce sens, l’utilité sociale de biens ou services produits,
marchands ou non marchands, serait cette faculté qu’ils ont de répondre à des
besoins exprimés par les humains. Et qui plus est, ces biens et services seraient
alors producteurs de richesse.
L’intérêt des entreprises collectives, de l’utilité sociale des biens qu’elles
produisent ou des services qu’elles dispensent est capital. Comme l’indiquent
Perret et Roustang (1993), il y a des limites à la croissance économique dans
ses formes actuelles. Cette croissance tend à dissoudre le lien social (Castel,
1995), à jouer contre la cohésion sociale et nuit à la création d’un espace public
ou civique. Or, n’est-ce pas précisément dans le dépassement des limites de ce
type de croissance et dans leur contribution possible à l’émergence de nouveaux
modèles de développement que les entreprises collectives prennent tout leur
sens ? Ainsi, praticiens et chercheurs sont-ils engagés depuis quelques années
dans diverses voies afin de mieux cerner les nouvelles dimensions de la richesse
produite par les entreprises collectives. Notons l’approche de la rentabilité
sociale des organisations d’économie sociale ; l’approche de l’utilité sociale
des associations ; celle de la redéfinition ou de l’élargissement du concept de
productivité ; celle de la responsabilité sociale et éthique des entreprises ; celle,
enfin, du développement durable. Nous nous intéressons dans ce numéro
principalement aux trois premières.
Pour Gadrey (1996), la remise en question de la notion de productivité est
une question de paradigme ; il faut sortir du paradigme de la production de la

© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Économie et Solidarités, volume 36, numéro 1, 2005 3
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
richesse fondé sur la croissance ou les gains de productivité. Gadrey poursuit
en écrivant que l’analyse de la performance, lorsqu’il s’agit de la prestation de
services, nous oblige à reconsidérer le concept conventionnel de productivité.
Les méthodes de mesure de la performance mises au point dans l’industrie
fordiste sont incapables de saisir les transformations des organisations post-
fordistes et de leurs produits. Bien que tous les produits (biens ou services)
soient des constructions sociales, les services immatériels sont caractérisés par
la diversité des problèmes à traiter ainsi que par une dimension relationnelle
forte complexifiant les méthodes de mesure. L’élargissement de la réflexion
concernant la productivité nous conduit à prendre en compte une multitude
d’éléments, tant économiques que sociaux, pour qualifier la performance des
organisations post-fordistes. Nombre d’entreprises collectives appartiennent
à ce nouvel univers organisationnel. Pour nous conforter dans cette voie, la
théorie des « économies de la grandeur » (Boltanski et Thévenot, 1991) nous
montre que les produits et résultats des activités post-fordistes sont susceptibles
d’être définis, qualifiés et évalués à partir de critères de justification multiples :
critères industriels, marchands, civiques, domestiques, de créativité ou d’inspi-
ration, voire d’appartenance territoriale et de développement local.
Bref, le présent numéro, et les articles du dossier qu’il contient, traite
particulièrement des éléments suivants :
– de la définition des concepts de richesse sociale et de rentabilité
sociale ;
– des liens entre les dimensions économique et sociale de la richesse ;
– de la question de l’utilité sociale des biens ou services produits par les
entreprises collectives ;
– de la question de la mesure des impacts économiques et sociaux de ce
type d’entreprise : sur quelles dimensions et indicateurs peut-on faire
reposer cette mesure ?
Le dossier thématique du présent numéro est constitué de cinq articles
suivis de quatre articles hors thème. Nous présentons en premier lieu les articles
thématiques. Jean Gadrey signe le premier texte portant sur l’utilité sociale des
associations. L’auteur relève que cette notion d’utilité sociale est de plus en plus
utilisée en France depuis plus d’une décennie, et ce, afin de caractériser l’éco-
nomie sociale et solidaire et lui attribuer une identité distincte. Il souligne que
l’utilité sociale, comme l’intérêt général, est une convention sociopolitique, en
l’occurrence une convention encore émergente et non stabilisée. En s’appuyant
sur une série de travaux récents, Gadrey propose une grille des dimensions et
critères d’utilité sociale en distinguant notamment l’utilité interne et externe
des associations. Enfin, il donne des indications sur les méthodes d’évaluation
envisageables de ces dimensions d’utilité sociale.

4 Économie et Solidarités, volume 36, numéro 1, 2005
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Le deuxième article, rédigé par Raymond Beaudry et Carol Saucier,
s’appuie sur les résultats d’une recherche exploratoire énoncés dans un rapport
portant sur la rentabilité sociale des entreprises collectives dans la région du
Bas-Saint-Laurent au Québec. Les auteurs cherchent à connaître la définition
que les acteurs eux-mêmes donnent de cette rentabilité et la mettent en lien avec
les concepts de richesse sociale et d’empowerment. Des entretiens réalisés, tant
individuels que collectif, se dégagent divers paramètres de la richesse sociale
produite par ces entreprises. Plus largement, la réflexion des auteurs débouche
sur la constatation que chaque entreprise d’économie sociale est tenue dans ses
pratiques de prendre en considération trois composantes : le projet individuel
porté par chacun des membres de l’entreprise ; le projet collectif constituant
précisément l’identité de l’entreprise ; enfin, le projet de société qui serait un
idéal que l’on partage avec autrui.
Un troisième texte, de Lucie Dumais et Christian Jetté, part de l’inter-
rogation suivante : Comment mesurer la cohésion sociale, les liens sociaux,
l’empowerment des personnes et des collectivités ? À partir de deux expériences
d’évaluation partenariale réalisées avec des organisations du tiers secteur, les
auteurs nous offrent un bilan provisoire de leurs efforts de formalisation d’indi-
cateurs d’impact social. Ces recherches ont été menées dans des quartiers de la
ville de Montréal et dans un ensemble de régions du Québec. Les auteurs nous
présentent la richesse de leurs données sur les impacts économiques et sociaux
des organisations du tiers secteur, en prenant soin de relever les différences entre
ces divers types d’impact, de même que leur pertinence respective. Enfin, ils
dressent un bilan des acquis de ces recherches ainsi que des difficultés qu’ils
ont eu à surmonter.
Dans le quatrième article, Lynda Binhas nous entraîne sur une autre piste.
Comment sortir de l’enfermement dans lequel se retrouvent certaines tentatives
d’élaboration d’indicateurs d’impact social spécifiques à l’économie sociale ? En
d’autres mots, comment éviter le glissement consistant en l’aboutissement trop
souvent économique de recherches d’indicateurs à vocation sociale ? L’auteure
met de l’avant un certain nombre de principes et en propose l’application à l’un
des secteurs d’activité rattachés à l’économie sociale, soit celui des ressourceries
(au Québec) et de la protection de l’environnement. Madame Binhas amorce
par cet article une réflexion devant la conduire à l’établissement d’indicateurs
relatifs à la rentabilité sociale et applicables aux ressourceries.
Le cinquième et dernier article du dossier thématique est axé sur une
réflexion théorique et conceptuelle sur la mesure de la richesse économique. Son
auteur, Jacques Prades, affirme que les indicateurs de performance sont l’objet
en France de réserves répétées. Ce texte vise à éclaircir les concepts de produc-
tivité et de produit intérieur brut. L’idée centrale est que le PIB est moins une
mauvaise mesure de la richesse matérielle qu’une bonne mesure d’une manière
particulière de la fabriquer. L’auteur ne tente pas de réviser ce concept, mais

© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
Économie et Solidarités, volume 36, numéro 1, 2005 5
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Économie et Solidarités, vol. 36, no 1, C. Saucier et M.J. Bouchard, responsables • EES3601N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
suggère plutôt d’étudier davantage les conditions nécessaires d’émergence de
pratiques relevant de l’innovation sociale, voire de l’économie sociale et soli-
daire. En effet, à partir de quels critères mesurer ces pratiques puisque, selon
Prades, leur mobile premier n’est pas économique, mais bien politique.
Quelques mots maintenant sur la présentation des articles hors thème.
Celui rédigé par Ann-Mari Sätre Åhlander a pour origine le constat que les
acteurs de développement local, ainsi que les nouvelles coopératives, se sont
multipliés en Suède depuis les années 1990. En s’appuyant sur un ensemble
de théories économiques, l’auteure tente d’expliquer ce phénomène. Comme
la synergie État-marché ne fonctionne plus adéquatement, n’y a-t-il pas place
pour de nouveaux partenariats, de nouveaux acteurs sociaux ? Quelle est alors
la contribution des entreprises d’économie sociale dans ce nouveau contexte,
plus précisément, dans le cadre de nouvelles initiatives de développement
local. L’auteure constate que la demande pour la mobilisation d’entrepreneurs
sociaux est forte afin de redynamiser les collectivités rurales aux prises avec
des problèmes de développement.
L’article de Marie-Noëlle Ducharme et Yves Vaillancourt décrit l’expé-
rience du Fonds québécois d’habitation communautaire (FQHC). Cet organisme
sans but lucratif, créé par le gouvernement du Québec en 1997, est voué à la
promotion et au développement de l’habitation communautaire ; son action a
surtout porté jusqu’ici sur la mise en œuvre des programmes AccèsLogis et
Logement abordable. L’examen de la composition du conseil d’administration
de même que celui des activités du FQHC révèlent des indices de l’évolution
vers une gouvernance associative. La première partie du texte présente des
éléments de la problématique du logement social liés à la crise du modèle
étatique et à son renouvellement. La deuxième s’attache à décrire le contexte
de création du Fonds, sa structure et ses principales activités. Enfin, la troisième
partie fait ressortir les différents enjeux liés à la gouvernance associative et
établit le potentiel et les limites de l’expérience menée par le FQHC.
L’article de Marie-Christine Bureau a pour objectif d’aborder le statut
de l’entrepreneuriat associatif artistique et culturel comme une ques-
tion d’économie politique. La première partie souligne l’actualité de cette
question par rapport aux débats français sur la réforme du régime des
intermittents du spectacle et sur la fiscalité des associations culturelles. La
deuxième replace la question du statut de l’activité artistique par rapport
à diverses transformations dans les domaines de l’art, notamment celle de la
démocratisation culturelle. La troisième et dernière partie explore des réflexions
prospectives sur le devenir des associations artistiques et culturelles, en parti-
culier à travers l’organisation d’un tiers secteur d’économie sociale et solidaire.
Quelle sera la place de ces entrepreneurs mettant en œuvre des innovations,
sans être animés pour autant par une motivation lucrative ?
 6
6
1
/
6
100%