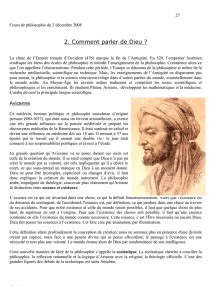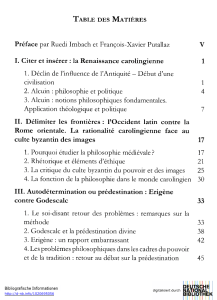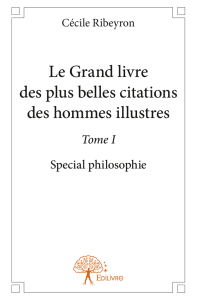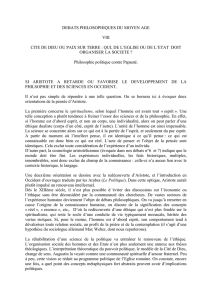debats philosophiques du moyen age

Débat n°1
- 1 -
DEBATS PHILOSOPHIQUES DU MOYEN AGE
I
L’HOMME EST-IL PREDESTINE ?
Erigène (mort en 877) contre Godescalc (mort en 869).
____________
DE L’HERITAGE CAROLINGIEN.
A quoi sert la philosophie au IXème et Xème siècle ? Tout d’abord, il faut oublier nos
représentations modernes des philosophes et de la philosophie. Au début du IXème siècle, un
livre est comparable à un objet précieux, de la valeur d’un domaine agricole. Il était rare et
fastueusement orné. C’est Alcuin d’York (mort en 804) qui aida Charlemagne à développer le
rayonnement culturel de son empire. Dans ses ouvrages, il déploie toutes ses facultés
intellectuelles pour donner à l’empire une assise théorique, une justification légitimatrice.
Cela passe par le souci de se démarquer du voisin byzantin, héritier de Rome, à l’importance
culturelle dominante (même devant la brillante civilisation arabe, qui n’avait pu récupérer tout
l’héritage de l’Antiquité pour obtenir une véritable suprématie intellectuelle et spirituelle).Ce
sont surtout les Libri Carolini qui marqueront cet affrontement. Ces ouvrages dénoncent le
culte des images de Dieu (les icônes) par les byzantins, et pointe les erreurs logiques et les
incohérences de cette idolâtrie. C’est à dire, en somme, qu’ils utilisent une démarche
philosophique. Le royaume des francs pouvait désormais se permettre de juger
universellement en matière de théologie et de philosophie.
Ainsi, la philosophie n’est pas réduite au silence méditatif d’une cellule de couvent, elle
est au cœur même du pouvoir. Elle ne se contente pas de clarifier des traités théologiques,
mais permet de parler et de penser correctement, avec cohérence. Elle marque la frontière
entre superstition et raison.
Deux générations plus tard, vers 850, l’empire est en prise à des difficultés sociales et
politiques (conflits avec les Normands, les Vikings, les Arabes et les Hongrois). Cependant,
l’héritage carolingien du système scolaire reste en place : dans les couvents, on trouve
maintenant des manuscrits lisibles, des textes théologiques correctement présentés et unifiés,
des textes latins et romains. Aristote (mort en 322 av. J.C.)n’est pas encore traduit. Seuls
quelques textes de saint Augustin (mort en 430) sont à disposition -et seulement dans les
meilleures bibliothèques- et peu de gens, si ce n’est quelques moines érudits de Lyon, sont au
courant que certains textes considérés comme des œuvres d’Augustin sont en fait des
commentaires qui corrigent Augustin. Mais globalement, la culture est largement plus diffusée
dans les monastères occidentaux. Il est donc tout naturel que de nombreuses querelles
doctrinales commencent à se faire jour. On ne se contente plus de polémiques contre Byzance
: les problèmes peuvent être internes à l’occident.
Evidemment, ces débats ne concernent qu’un cercle restreint : ils se limitent presque toujours
à la cour du Roi des Francs. Bien qu’ils aient lieu à l’extérieur, on ne peut vraiment parler de
débats « publics ».

Débat n°1
- 2 -
Un de ces débats opposa Godescalc à Jean Scot Erigène dans de vives querelles verbales.
DE GODESCALC ET DE LA PREDESTINATION DIVINE.
Le moine saxon Godescalc fut trouvé dans un couvent. Adulte, il réclama à son abbé, Raban
Maur, de disposer librement de lui-même, mais celui-ci refusa catégoriquement. Plus tard, en
829, il fut autorisé par le synode de Mayence (Mainz) à quitter le couvent (le synode est
l’assemblée ecclésiastique qui se réunit pour traiter des affaires du diocèse ou de la paroisse).
Dans ces recherches personnelles, il découvrit la théorie de la prédestination qu’Augustin
avait soutenue à la fin de sa vie. La volonté de Dieu a décidé depuis toujours si tel homme ira
au royaume de Dieu ou à celui de Satan. L’homme ne peut rien faire pour infléchir sa
destinée, certains sont voués au mal et au péché. Le Christ ne serait donc pas mort pour tous
les hommes, mais seulement pour quelques élus. Voilà qui ruine les efforts des successeurs
d’Alcuin : à quoi servent alors les missionnaires et le prosélytisme, propres à l’empire de
Charlemagne ? C’est toute l’organisation de l’église qui est menacée.
Un synode réuni à Mayence en 848, présidé par son ancien abbé Raban Maur devenu
archevêque, condamna Godescalc à être fouetté devant l’assemblée des évêques, et à être
emprisonné au couvent d’Orbais, où il passa le reste de ces jours. Mais, dans cet empire
occidental où la vie intellectuelle était devenue plus active, la querelle s’envenima. Autour de
Lyon de fins connaisseurs d’Augustin, sans pour autant approuver Godescalc, critiquèrent son
emprisonnement. L’évêque Hincmar de Reims, à qui Godescalc avait été livré, demanda à
Jean Scot Erigène un rapport sur toute cette affaire. Or ce moine érudit irlandais provenait
d’une troisième tradition intellectuelle.
Faisons le point à ce propos. Vers 850, on se trouve en présence 1) de l’école d’Alcuin, en
Allemagne et dans le centre et le Nord de la France (zone anglo-saxonne). 2) A Lyon et à
Troyes, la tendance dominante est plus proche d’Augustin. 3) La zone d’influence irlandaise,
celle d’Erigène.
DU RAPPORT D’ERIGENE ET DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE.
La thèse d’Erigène est simple : Dieu est unique, atemporel, infiniment bon. Il ne saurait
prédestiner les hommes au mal. Le mal, d’ailleurs, n’existe pas vraiment, il n’est qu’un
manque d’être, l’incomplétude d’un être qui n’est pas parfait. L’enfer doit être compris au
sens figuré, il signifie le remords du pécheur, il n’existe qu’en imagination. Erigène s’appuie,
tout comme Godescalc,, sur Augustin, mais dans des textes plus anciens, où l’influence de
Platon est plus forte. Son rapport fit scandale, et son livre fut condamné. Erigène adopte,
comme Godescalc, une démarche rationnelle. Son interprétation d’Augustin lui fait refuser
l’idée d’un homme prédestiné. Dieu ne peut logiquement pas créer un homme sans liberté,
l’homme doit être pensé comme volonté libre, qui a la possibilité de se diriger vers le bien.
Protégé par le Roi, Erigène ne fut pas inquiété. Beaucoup plus tard, cependant (1210), son
œuvre sera condamnée. Détenir ou lire son livre De la division de la réalité sera punit de
mort.

Débat n°2
- 1 -
DEBATS PHILOSOPHIQUES DU MOYEN AGE
II
L’HOSTIE EST-ELLE VRAIMENT LE CORPS DU CHRIST ?
Béranger de Tours (mort en 1088) contre Lanfranc (mort en1089)
DE L’IMPORTANCE D’UNE TELLE QUESTION
Celle-ci peut paraître terriblement ennuyeuse à l’homme du XXème siècle. Elle le sera peut-
être moins si l’on se figure que, à travers elle, c’est le devenir des puissances mondiales qui
est en jeu. Les discussions sur l’Eucharistie (sacrement qui entretient le sacrifice du christ et
sa présence, sous les espèces du pain et du vin) pouvaient en effet faire vaciller des trônes.
Ce débat a lieu au XIème siècle, pendant la montée en puissance de l’Empire allemand, fondé
à partir de l’ancien Empire carolingien. C’est vers l’an 1000, sous Otton III, que se perpétue
toute une série d’écoles cathédrales, dont celle de Chartres, d’où sont issus Béranger de Tours
et Lanfranc, les protagonistes d’un débat qui tint en haleine la France, l’Angleterre,
l’Allemagne et l’Italie pendant près d’un demi-siècle. La querelle, qui allait impliquer
hommes politiques, papes, moines et laïcs, montre bien que dans cette civilisation toute
imprégnée de religion, la philosophie n’avait qu’une existence précaire.
Les forces en présence sont bien différentes de celles du IXème siècle. La science et les arts ne
se pratiquent plus seulement dans les cours impériales, mais s’appuient sur de puissants
monastères et des cités florissantes. L’église romaine se renforce et s’oppose à L’empire :
c’est l’époque de la querelle pour le privilège de l’investiture des évêques. Le développement
des villes, de la monnaie, de l’agriculture et la centralisation changent les rapports de la raison
à la société. Il faut dorénavant fonder clairement ce qu’on avance. Si l’église pouvait
condamner grammairiens et dialecticiens, elle ne pouvait plus se passer de dialectique, de
logique.
DES ARGUMENTS DE BERANGER
« Ceci est mon corps », telle est la fameuse phrase qui pose problème. Le corps du Christ est-il
physiquement présent dans le pain, au moment où le prêtre prononce cette phrase ? Jusqu’où
appliquer les règles de la logique pour expliquer cette contradiction ? Béranger prétendait
qu’il fallait maintenir sans compromis les règles de la grammaire et de la dialectique.
1) Pour Béranger, « ceci » se rapporte évidemment au mot « pain » ; si le Christ était aussi le
sujet de la préposition, la phrase perdrait sa cohérence logique.
2) La doctrine de l’Eucharistie est la suivante. Lors de la messe, le pain ne change pas
d’apparence. Les aspects extérieurs, les « accidents » en termes dialectiques, ne changent pas.
Mais dès que l’évêque prononce la phrase, c’est la « substance » du pain qui changent et
devient corps du Christ, alors que l’on croit voir du pain. Mais pour Béranger, un accident

Débat n°2
- 2 -
n’est défini que par rapport à la substance à laquelle il est rattaché. Il y a donc une
contradiction dans cette doctrine.
3) Néanmoins, le Christ est présent lors de l’eucharistie, mais sa présence n’est que spirituelle,
et non matérielle. L’Eucharistie est un signe, non une chose ; il faut interpréter les textes au
sens figuré, il faut résoudre le problème à l’aide de la raison seule. On retrouve le même souci
que chez Alcuin et Erigène.
DES REFUTATIONS DE LANFRANC ET D’AUTRES ADVERSAIRES DE BERANGER
DE TOURS.
Une grande partie de L’Église répondit que la puissance divine n’avait pas à se soumettre au
principe de non-contradiction. Ce à quoi Béranger répliqua que ce n’était pas rendre hommage
à Dieu que de mépriser l’esprit humain et de renoncer aux lois de la pensée. L’homme est fait
à l’image de Dieu : le respect des lois de la pensée (grammaire, logique) a un sens religieux.
Mais Lanfranc, dont les attaques s’expliquent en partie par son rejet de la dialectique et la
concurrence de l’école de Tours, en appelle alors à la toute puissance divine, que le prêtre fait
intervenir en brisant l’hostie ; le corps du Christ est présent par sa nature physique. Le clergé
avait à cœur d’expliquer cette transfiguration (ou « transsubstantiation »). C’est pourquoi le
concile de Latran (un concile est une assemblée évêques et de théologiens réglant des
questions sur le dogme et la liturgie. Les conciles œcuméniques concernent le monde entier,
les conciles provinciaux, seulement la province concernée.), réunit en 1059, obligea Béranger,
sous la menace de la violence, à accepter sous serment la vérité selon laquelle le corps du
Christ est partagé par les mains du prêtre et « mâché par les dents des fidèles ».
DES CONSEQUENCES D’UN TEL JUGEMENT.
Cette décision donna l’impression que la doctrine de l’Eucharistie se mettait à dos la
philosophie tout entière. Elle favorisa l’introduction du célibat obligatoire des prêtres :
comment des mains qui ont le pouvoir de partager le corps du christ pourraient-elles toucher
une femme ? Plus généralement, les conséquences théoriques furent catastrophiques. Si on
croit voir du pain et qu’il s’agit du christ, si la puissance divine peut séparer l’apparence et
l’être, comment l’être humain peut-il distinguer le vrai du faux ? Comment, en voyant trois
promeneurs, savoir si ce sont des humains ou des anges ? Comment étudier les sciences, si
nous déformons à ce point les informations du monde extérieur ? L’affaire Béranger ouvre le
long conflit de l’église avec la grammaire et la dialectique qui traversa tout le Moyen âge,
sans jamais être résolu. A l’époque où les citadins commençaient à se grouper en associations
laïques pour mettre en place des structures légales, qu’ils savaient organiser un commerce
extérieur florissant, fallait-il leur présenter la religion comme une vérité, ou comme une
participation magique, juridiquement liée à la puissance arbitraire de Dieu ? La papauté,
consciente d’avoir à affirmer sa domination religieuse sur les ecclésiastes régionaux, répondit
par la deuxième solution. Elle scellait ainsi pour plusieurs siècles ce que Béranger avait
dénoncé : refuser une réforme morale et spirituelle, en faisant passer la doctrine de
l’Eucharistie pour un mystère divin, alors qu’il n’est qu’un artifice créé par les hommes.

Débat n°3
- 1 -
LES DEBATS PHILOSOPHIQUES AU MOYEN-AGE
III
L’ATHEE EST-IL INSENSE OU REALISTE ?
Anselme de Cantorbéry (mort en 1109) contre Gaunilon (contemporain d’Anselme)
COMMENT ANSELME APPORTE UNE PREUVE RATIONNELLE DE L’EXISTENCE
DE DIEU.
Avide de connaissance et de savoir, le jeune Anselme quitta son Aoste natale (en actuelle
Italie) à la recherche d’un maître. Ce fut Lanfranc, auquel il succédera en tant qu’évêque de
Cantorbéry, en Angleterre. Au contraire de Lanfranc, Anselme voulu fonder son savoir sur
autre chose que des arguments d’autorité (la Bible, les Pères de l’église). Il voulait établir des
relations rationnelles nécessaires, des « connexions » ; et ce afin de démontrer que la foi est
rationnelle (ratio fideï).
Les contacts avec Byzance, les Arabes, et surtout les Juifs, installés au cœur des villes
chrétiennes, obligeaient les chrétiens à utiliser des arguments autres que les références aux
livres. Il fallait aussi se protéger de l’hérétique ou de l’incroyant qui sommeille en chaque
chrétien. Ainsi, la preuve de l’existence de Dieu d’Anselme est construite de telle manière
qu’il est possible de convaincre un incroyant : la foi n’est pas un présupposé du raisonnement.
Toutefois Dieu n’est pas, comme dans la notion populaire de Dieu, un empereur céleste, un
maître arbitraire. Dieu est la raison dernière de l’unité du monde. Anselme l’explique en
prenant appui sur le langage humain. Plusieurs pommes sont regroupées sous le mot
« pomme », mais elles ont une unité réelle. Le multiple (les différentes pommes réelles) n’est
en fait qu’un (l’ensemble conceptuellement regroupé sous le mot « pomme »). On remonte
peu à peu : « pomme » et « poire » sont regroupées par le mot « fruit ». Et ainsi de suite, l’on
remonte les choses jusqu’à l’un suprême, Dieu, au-delà duquel on ne peut plus rien penser.
Comment, dés lors, convaincre un incroyant ? La Bible dit : seul l’insensé dit dans son cœur :
il n’y a pas de Dieu. Mais Anselme ne considère pas pour autant l’athée comme un malade
mental ; il cherche constamment à le persuader, à lui faire comprendre logiquement son
erreur.
Définissons Dieu comme « l’être au-delà duquel on ne peut rien penser de plus parfait ».
L’athée dira alors qu’il n’existe pas d’être au-delà duquel on ne puisse rien penser de plus
parfait; Mais comparons alors ce dernier, en pensée, avec un être de ce type qui existerait
vraiment. Il serait alors plus parfait, puisqu’il existerait, que l’être qui n’existerait pas. Cette
perfection supérieure est donc possible. Elle existe nécessairement : c’est Dieu. S'il accepte la
définition de départ, l’athée, le mécréant est obligé de reconnaître que l’athéisme est
contradictoire. Cet argument est un coup de génie dans toute la culture scolaire de grammaire
et de logique du XIème siècle : on ne lui a retrouvé à ce jour aucun modèle antérieur.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%