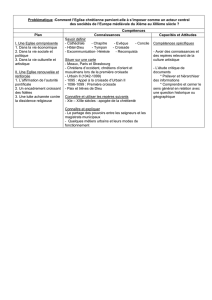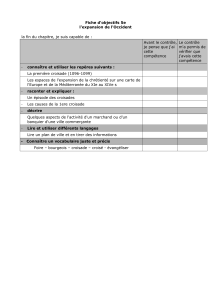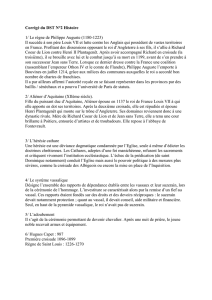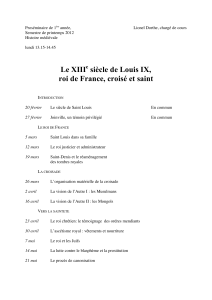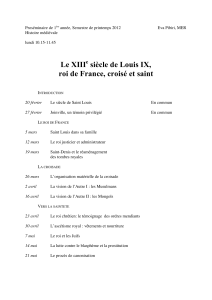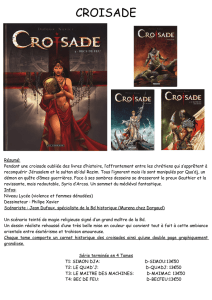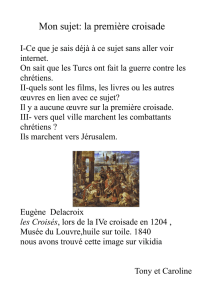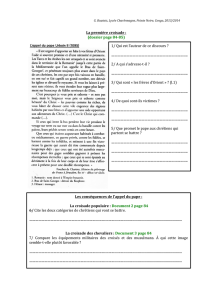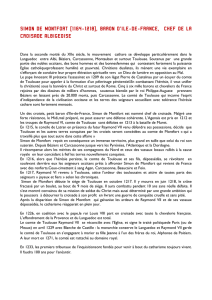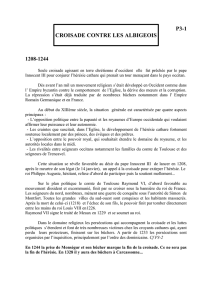La Croisade albigeoise - Histoire et Cultures en Languedoc

1
La Croisade albigeoise
Entre légalité et légitimité
18 juin 1209 – Devant le triple portail de l’abbaye bénédictine de Saint-Gilles, où pour la
première fois dans la Chrétienté la pierre raconte, en une immense frise sculptée, toute la
Passion du Christ, un homme gravit nu-pieds les marches du parvis. Il est en braies, et sans
chemise. Trois légats pontificaux, trois archevêques et dix-neuf évêques en vêtements
d’apparat l’attendent, les bras chargés de livres saints, de ciboires et de reliquaires. L’un des
légats lève alors un faisceau de verges, et l’abat mollement sur le dos de l’homme, qu’il
conduit ensuite, par la porte centrale, à l’intérieur de l’église. Quelques instants plus tard,
Raymond, sixième du nom, âgé de 54 ans, depuis 15 ans comte de Toulouse, duc de
Narbonne et marquis de Provence, jure solennellement obéissance et fidélité à la Sainte Eglise
catholique romaine. Il s’engage, notamment, à chasser de ses terres les hérétiques…
Jeudi saint 12 avril 1229 – Devant le triple portail éclatant de blancheur de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, dont le décor sculpté vient tout juste d’être achevé, un homme de 32
ans, nu-pieds, en chemise et en braies, se tient agenouillé devant un enfant-roi, Louis IX, sa
mère la régente Blanche de Castille, le cardinal-légat Romain Frangipani, et une innombrable
assemblée de prélats, abbés, moines, grands seigneurs, chevaliers et notables. Cet homme,
c’est Raymond VII, qu’on avait longtemps appelé Raymond le Jeune ou Raymondet, jusqu’à
ce qu’il succède à son père en 1222. Comme ce dernier vingt ans plus tôt, il s’engage
solennellement envers l’Eglise, mais aussi, cette fois, envers le roi. Alors il entre dans la
cathédrale et, devant le maître-autel, reçoit l’absolution des mains du cardinal-légat. Car il
vient de signer la paix, en promettant, notamment, de combattre les hérétiques de son comté…
*
Les deux humiliantes cérémonies de pénitence auxquelles ont dû se plier à vingt années
d’écart deux comtes successifs de Toulouse, – le père puis le fils – encadrent rigoureusement
la guerre connue sous le nom de « croisade albigeoise » – en fait, croisade contre les

2
albigeois, ce terme désignant alors, on le sait, les hérétiques qu’on appelle aujourd’hui
couramment les cathares.
Pourquoi « croisade » ? Parce qu’il ne s’agit pas d’une guerre ordinaire, mais d’une guerre
sainte. Parce qu’il ne s’agit pas de la ruée sauvage et incontrôlée de chevaliers du Nord qui
auraient pris prétexte de l’hérésie cathare pour se ruer sur le futur Languedoc et s’y tailler des
domaines au soleil méridional. C’est une croisade, parce qu’il s’agit d’une institution, fondée,
définie et codifiée par la Sainte Eglise catholique romaine : cette institution impose des
devoirs, mais en retour donne des droits et distribue des récompenses.
Le devoir, c’est de s’engager à combattre, donc à risquer sa vie, au service du Christ, au
moins pour quarante jours – non compris, évidemment, le temps du voyage.
Le droit, c’est de voir ses biens et sa famille placés sous la protection du Saint-Siège durant
toute la durée de l’engagement ; ce qui signifie l’excommunication de quiconque porterait
atteinte ou ferait tort aux biens ou à la famille du croisé.
La récompense, c’est l’indulgence, c’est-à-dire la rémission totale ou partielle des péchés,
ce qui permet à l’âme du croisé de faire dans l’au-delà, le moment venu, l’économie d’un
temps de Purgatoire, voire de toute la durée de celui-ci. Mais on va vite voir que la croisade
albigeoise n’était pas riche seulement de récompenses spirituelles.
*
Comment la mise en œuvre d’une telle institution fut-elle possible, non pas, cette fois,
pour la délivrance de la Terre sainte ni pour la Reconquista de l’Espagne sur les Maures qui
l’occupaient depuis cinq cents ans, mais sur le sol même de l’Europe chrétienne, contre des
gens qui se réclamaient eux-mêmes du Christ ?
En fait, il y avait beau temps, au XIIIe siècle, que le pacifique message des Evangiles avait
été très sérieusement amendé. Dès le Ve siècle, saint Augustin avait jugé trop débilitant le
« Tu ne tueras point » des Ecritures, si on le prenait au pied de la lettre. Il estima qu’il pouvait
y avoir un juste usage de la violence, notamment pour convertir les païens. Cette notion de
guerre juste fut naturellement étendue aux Infidèles quand l’Islam conquérant fit irruption sur
la scène de l’Histoire et, dès lors qu’il fallut combattre les Musulmans pour préserver la
sécurité du pèlerinage de Jérusalem, on passa de la « guerre juste » à la « guerre sainte » : tout
chrétien qui mourrait au combat contre les Infidèles était assuré de son salut. Saint Bernard,
au XIIe siècle, théorisa définitivement le légitime emploi de la violence : un chevalier du
Christ n’a pas à craindre de mourir au cours d’une guerre sainte, car il va droit au Paradis ; il

3
n’a pas plus à craindre de tuer, « car s’il tue, c’est pour le Seigneur », écrit saint Bernard dans
la Règle qu’il délivra en 1128 aux Templiers.
Il suffisait d’étendre aux hérétiques l’opprobre jeté sur les Infidèles pour rendre possible
une croisade en terre chrétienne. « Prendre la croix » contre les cathares était une garantie de
salut. « Ils sont pires que les Infidèles », avait d’ailleurs écrit d’eux le pape Innocent III…
*
Promesse de salut liée à l’engagement dans une guerre sainte au service de la « vraie foi »
– celle définie par l’Eglise romaine ; haine farouche de ceux qui se dressaient contre celle-ci,
et qu’une habile campagne de prédication, pour ne pas dire de propagande, avait suscitée et
entretenue auprès des foules ; tels furent certainement les deux plus puissants ressorts qui
poussèrent tant de gens, des plus humbles barons aux plus grands vassaux du roi de France, à
« prendre la croix », c’est-à-dire à s’engager dans la militia Christi, la Chevalerie du Christ,
pour s’en aller pourfendre l’hérétique. Ne glosons donc pas inconsidérément sur les ambitions
temporelles. Elles ont eu leur part, c’est certain, dans plus d’un vœu de croisade. Mais ce ne
fut qu’une très petite minorité de croisés qui se fixa en Languedoc à la faveur de la guerre, s’y
tailla des domaines et tenta d’y faire souche. La plupart d’entre eux ne s’engageaient que pour
quarante jours – la « quarantaine » suffisant à leur procurer les « indulgences de croisade ».
Curieusement ce fut la guerre sainte telle que le pape Innocent III en développa les
fondements institutionnels, qui porta en elle le germe de la conquête française.
Dès son avènement, en 1198, il comprit que s’il voulait lutter efficacement contre l’hérésie,
il lui fallait durcir le droit répressif.
Quel arsenal juridique trouva-t-il en effet à sa disposition ?
On peut dire, en schématisant un peu, que l’Eglise distingue alors très nettement
l’hérétique avéré, celui ou celle qui, ayant reçu le sacrement de l’imposition des mains, est
membre de ce qu’on appelle évidemment « la secte », et le protecteur, fauteur ou complice
d’hérésie : celui qui tolère des hérétiques sur ses domaines et entretient des relations avec
eux. Le premier doit être capturé et, s’il n’abjure pas, remis au bras séculier qui appliquera
une peine corporelle – le plus souvent le bûcher. A défaut de pouvoir être capturé, l’hérétique
doit au moins être chassé. Dans les deux cas, la sanction s’accompagne de la confiscation de
ses biens. Quant au simple protecteur ou complice d’hérésie, il ne tombe que sous le coup de
peines spirituelles : excommunication, anathème, interdit.
Un grand pas avait été franchi en 1179 avec le canon 27 du troisième concile œcuménique

4
du Latran. Le concile s’en était tenu à la traditionnelle distinction entre les hérétiques avérés
et les simples protecteurs, recéleurs et complices d’hérésie. Contre ces derniers, il avait
renouvelé les peines spirituelles. Mais contre les hérétiques avérés, il avait durci le ton : il
avait rappelé que l’emploi de la violence était légitime pour les chasser et confisquer leurs
biens. Mais il avait ajouté que quiconque prendrait les armes à cette fin bénéficierait d’une
remise de deux ans de pénitence, assortie de la mise sous la protection du Saint-Siège « à
l’instar des pèlerins du Saint-Sépulcre ». On tient là, à l’état embryonnaire, une définition de
ce que sera la croisade albigeoise.
*
La grande idée d’Innocent III, ce fut d’étendre des hérétiques avérés à leurs simples
complices le principe de la confiscation des biens. Son application, naturellement, ne pourrait
se faire que par la force. Trois mois après son évènement, il chargea l’archevêque d’Auch de
« mobiliser les princes et les peuples » du comté de Toulouse et des principautés voisines,
pour qu’ils prennent les armes contre les hérétiques et les fauteurs d’hérésie, afin de
confisquer les biens des uns et des autres.
Hélas, les seules forces armées qui auraient pu remplir cette tâche – chevalerie de la grande
et petite noblesse rurale, et milices urbaines – étaient elles-mêmes immergées dans une
société trop largement acquise à l’hérésie. Ni les hobereaux de la campagne ni les consulats
urbains n’allaient quand même se confisquer à eux-mêmes leurs propres biens !… Personne,
évidemment, ne bougea.
Alors, faute de trouver sur place, malgré ses appels réitérés, les armes qui eussent été
nécessaires, Innocent III se vit contraint d’aller chercher ailleurs l’armée dont il avait besoin.
Il s’adressa au roi de France. Pendant des années, il n’eut aucune réponse. Finalement, en
1204, il signifia à Philippe Auguste qu’il « exposait en proie » les domaines du comte de
Toulouse, c’est-à-dire qu’il les offrait au premier occupant catholique qui voudrait s’en
emparer, à charge pour lui, naturellement, d’y sévir contre les hérétiques. Demandant même
au roi de prendre la tête de l’expédition, il lui fit cette extraordinaire suggestion :
« Confisquez les biens des comtes, des barons et des citoyens qui ne voudraient pas éliminer
l’hérésie de leurs terres. Ne tardez pas à rattacher le pays tout entier au domaine royal… »
Et pourtant le roi refusa…
*

5
Quand on connaît la suite des événements, ce refus laisse perplexe. On sait en effet que la
croisade albigeoise n’aura aucun effet sur le plan religieux : en 1229, c’est-à-dire au bout de
20 ans de guerre, le catharisme se retrouvera aussi fort, sinon plus, qu’en 1209 ; au point que
l’Eglise, renvoyant la chevalerie française dans ses foyers, devra inventer un nouveau système
de répression de l’hérésie, et ce sera l’Inquisition – laquelle mettra certes un siècle à venir à
bout du catharisme, mais elle y parviendra. En revanche, la croisade aura, au plan
géopolitique, et non plus religieux, des conséquences majeures : en annexant au domaine
royal capétien les vicomtés de Béziers, Carcassonne et Albi ainsi que la moitié des Etats du
comte de Toulouse, et en préparant à moyen terme l’annexion du reste, le traité qui sera signé
à Paris en 1229 arrachera définitivement le Languedoc aux ambitions de la Maison de
Barcelone. Dans le même temps, il ouvrira au royaume de France une large fenêtre sur la
Méditerranée
Cette croisade dont la Couronne capétienne allait tirer tous les bénéfices que l’on sait, le
roi de France, dès le départ, ne la voulait donc pas ! De silences indifférents en réponses
dilatoires, Philippe Auguste réduisit le Saint-Siège à l’impuissance, le contraignant à envoyer
en Languedoc, à défaut des soldats qu’il ne trouvait nulle part, des moines prédicateurs, en
majorité des cisterciens, afin d’essayer de convaincre les habitants, des plus humbles foules
jusqu’aux plus puissants seigneurs, de ne pas abandonner le pays à l’hérésie.
*
Ce que les historiens ont donc appelé la « croisade spirituelle », – mais qui n’avait été, en
fait, qu’un pis-aller – finit quand même par faire place à la croisade des armes, lorsque, en
janvier 1208, fut assassiné, non loin de Saint-Gilles-du-Gard, le légat pontifical Pierre de
Castelnau. Innocent III lança aussitôt à toute la Chrétienté un cri d’alarme indigné, dénonçant
le comte de Toulouse comme l’instigateur du crime et renouvelant l’« exposition en proie » :
« En avant, chevaliers du Christ !... Qu’il soit permis à tout catholique, non seulement de
combattre le comte en personne, mais encore d’occuper et de conserver ses biens. Chassez-le,
lui et ses complices, dépouillez-les de leurs terres… ».
Philippe Auguste tenta bien, une dernière fois, d’empêcher la croisade. Brandissant le droit
féodal, il répondit au pape que son intervention dans le sud du royaume était parfaitement
illégale : « Vous n’avez pas le droit d’agir ainsi, lui répondit-il vertement. Car le comte de
Toulouse est mon vassal, et c’est moi, le roi, qui ai seul le pouvoir de destitution et
d’investiture… ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%