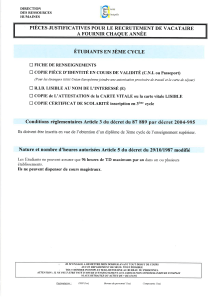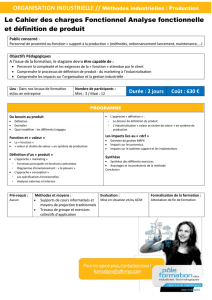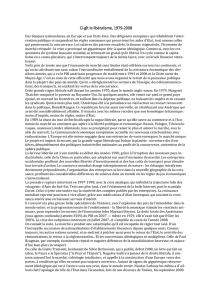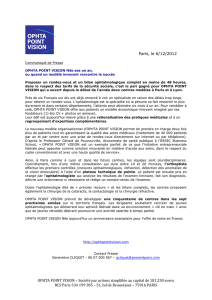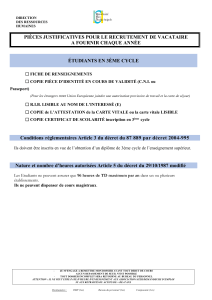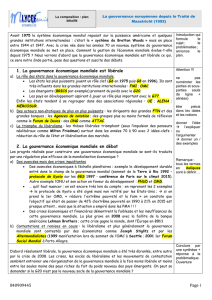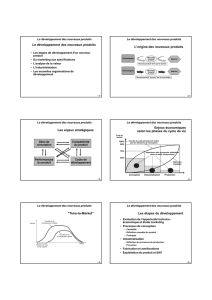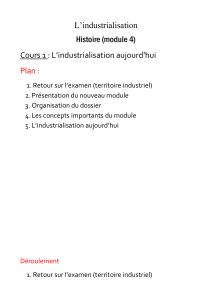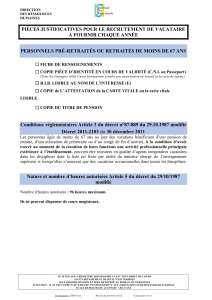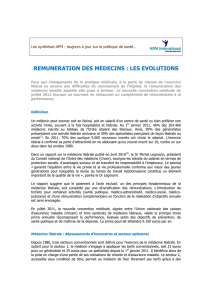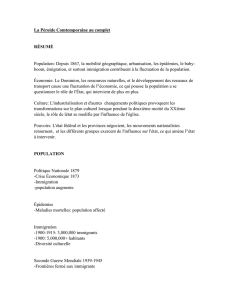De la crise de la médecine libérale à son industrialisation

RR2015 « De la crise de la médecine libérale à son industrialisation » [Nicolas DA SILVA] PAGE 1 sur 15
De la crise de la médecine libérale à son
industrialisation
Nicolas DA SILVA1
1 EconomiX, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, [email protected]
ABSTRACT.
Si historiquement la puissance publique a privilégié l’instrument tarifaire pour réguler l’activité de la médecine
libérale, désormais elle cherche à contrôler les pratiques par des normes chiffrées – c’est dire à industrialiser la
production des soins. L’objectif de cette communication est de fournir une analyse de cette évolution en soulignant
le fait qu’il ne s’agit pas d’une « rationalisation » mais du produit de rapports de force historiquement situés.
Keywords
: industrialisation, certification, médecine libérale, médecine fondée sur les preuves, soin, santé.

RR2015 « De la crise de la médecine libérale à son industrialisation » [Nicolas DA SILVA] PAGE 2 sur 15
A.
INTRODUCTION
Avec l’entrée dans le régime d’accumulation postfordiste, l’Etat social s’est transformé
peu à peu en Etat néolibéral qui « fait son marché » (Batifoulier et al., 2007) : il organise la
concurrence entre producteurs dans le champ de la santé comme ailleurs. En médecine de ville,
ce New Public Management prend la forme traditionnelle d’une régulation par les prix qui pèse
principalement sur les usagers et la demande de soins, laissant aux médecins libéraux leur liberté
tarifaire (Pierru, 2007). Le renoncement au contrôle des honoraires rend le prix de l’acte plus cher
et, pour certains patients, la maladie n’est plus seulement une épreuve physique et mentale mais
aussi une épreuve financière (Batifoulier, 2014).
Neamoins, il semble que cette politique de prix soit peu à peu supplée par la régulation
des pratiques médicales (Da Silva et Gadreau, à paraître). L’Etat cherche aujourd’hui contrôler les
pratiques thérapeutiques et prescriptives par l’intermédiaire de dispositifs de gestion tels que des
démarches qualité, des agences de santé, des normes de bonnes pratiques et même des
mécanismes de paiement à la performance médicale (Bloy et Rigal, 2012, Setbon, 2000). Afin de
maîtriser les dépenses de santé et d’améliorer la qualité des pratiques, la puissance publique
prétend désormais industrialiser la production des soins. Traditionnellement fondée sur la
singularité de la relation patient-médecin, l’activité médicale doit se rapprocher au plus près du
respect inconditionnel de normes impersonnelles.
Nous cherchons ici à analyser l’évolution historique de la régulation de la médecine
libérale de façon comprendre cette logique d’industrialisation de la qualité des soins.
Dans une première partie (B.), nous analyserons la crise qui touche la médecine libérale
depuis la fin des années 1970 et rend plausible l’évolution de la politique publique (des prix aux
pratiques). Cette crise est multiforme dans la mesure où elle prend sa source non seulement dans
la crise économique mais aussi dans la crise du régime de la preuve propre au champ médical
(rôle de la Médecine fondée sur les preuves) et dans la crise de confiance vis-à-vis de la figure du
médecin (Benamouzig et Besançon, 2005, Keel, 2011).
Dans la seconde partie (C.), nous mettrons en évidence les différentes étapes visant à
instituer la nouvelle représentation de la qualité des soins. L’industrialisation suppose
successivement la définition du produit, la certification du produit, le recueil des informations sur
la production et l’incitation à la modification des comportements. En mettant en évidence tout le
processus d’institutionnalisation de la régulation par les pratiques nous souhaitons ainsi
démontrer que cette politique publique n’est pas « naturelle » mais qu’elle est le résultat des
rapports de force consubstantiels à l’évolution du capitalisme. Il n’y a pas de transformation des
structures sans action transformatrice c’est-à-dire sans action politique (Théret, 1990).
B.
LES CRISES DE LA MEDECINE LIBERALE
L’industrialisation de la médecine libérale n’est pas le produit d’une histoire linéaire qui
voudrait que les progrès de la science médicale soient immédiatement et intégralement transposés
dans la politique publique. L’évolution de la régulation de la médecine libérale a nécessité
certaines conditions de possibilité que sont une crise du régime de la preuve (B.1.), une crise de
confiance (B.2.) et une crise économique (B.3.). Dès lors, on peut contester la prétention de la
présente régulation (par les pratiques) à être une rationalisation.
B.1. UNE CRISE DU REGIME DE LA PREUVE
La première crise de la médecine libérale concerne la modification du régime de la preuve au
sein même du champ médical. En ce sens, ce n’est pas tant une crise de la médecine libérale mais
une crise de la médecine dans son ensemble. La question qui se pose porte sur l’identification des
preuves légitimes pour la pratique médicale de qualité.

RR2015 « De la crise de la médecine libérale à son industrialisation » [Nicolas DA SILVA] PAGE 3 sur 15
Traditionnellement, le champ médical était faiblement codifié et formalisé bien que le
registre de légitimation soit celui de la « science ». L’apprentissage se faisait en situation, par
l’expérience. Cette organisation a longtemps conféré aux médecins les plus prestigieux un
pouvoir sur les autres membres de la profession, sur les patients et sur le pouvoir politique. La
médecine n’en était pas pour autant du charlatanisme : elle était essentiellement une science de
laboratoire réductionniste ayant fait la preuve de son efficacité au moins depuis la fin du 20ème
siècle – insuline (diabète), antitoxine (diphtérie), antipyrétiques (fièvre), hormones purifiées,
sérums et vaccins, pénicilline (syphilis), streptomycine (tuberculose), etc. Cependant, la
connaissance n’est pas totale et la forme particulière de création de la connaissance crée des
formes particulières de la dispute : le débat sur la qualité des soins est empreint d’arguments
d’autorité peu discutés même si très discutables. La variabilité des pratiques est alors une
conséquence nécessaire de cette conception de la recherche médicale. Il y a autant de pratiques
légitimes que de médecins suffisamment charismatiques pour imposer leurs décisions.
C’est dans le contexte d’après-guerre et à partir du traitement de la tuberculose, que va naître
au Royaume-Uni une nouvelle méthodologie révolutionnant la production de la preuve médicale :
l’essai clinique randomisé. A cette époque les recherches sur la tuberculose font l’objet d’une
méthodologie innovante avec la réalisation d’essais multicentriques. Ce sont des essais réalisés
dans un nombre important de centres de soins différents afin de brasser statistiquement un grand
nombre de patients et de médecins. L’idée est de nettoyer l’effet observé du traitement d’une
possible contingence locale. Le critère d’essai multicentrique est ainsi le premier des deux critères
permettant de définir l’essai clinique randomisé, le second étant la randomisation. La
randomisation est une procédure statistique prévoyant la répartition au hasard des malades
sélectionnés pour participer à l’essai entre un groupe expérimental et un groupe témoin.
C’est plus précisément au Royaume-Uni, dans un contexte de pénurie de médicaments et du
fait de médecins peu convaincus de l’effet de la streptomycine, qu’a été défini le gold standard de
l’essai clinique randomisé. L’expérimentation clinique de 1947/1948 du Medical Reaserch Council
comportait les deux critères de l’essai clinique randomisé : essais multicentriques et
randomisation. L’efficacité du traitement a été largement démontrée avec une mortalité de 7 %
pour les patients traités contre 27% pour les patients non traités.
Suite aux premiers essais cliniques randomisés, la médecine va lentement systématiser l’usage
des statistiques dans ses recherches – cette méthodologie devenant l’épicentre de la Médecine
fondée sur les preuves (Evidence based medicine). La Médecine fondée sur les preuves repose sur le
principe d’une hiérarchisation des niveaux preuves, l’essai clinique randomisé étant le niveau de
preuve le plus fort devant les traditionnelles expériences de laboratoire. L’idée est de contester
et/ou de compléter les connaissances venues de la pratique individuelle par des données externes
fondées statistiquement avec l’objectif de réduire la variabilité des pratiques en choisissant les
traitements les plus efficaces. Chemin faisant, la valeur de l’essai clinique randomisé a supplanté
les autres éléments de preuve dans l’élaboration des règles de l’« art médical ». Cet « art » est
désormais standardisé par le recours à des données chiffrées permettant de définir les « bonnes
pratiques ».
Le point intéressant concernant cette crise du régime de la preuve dans le champ médical est
sa position historique : l’Evidence based medicine n’est pas une pratique récente, elle remonte au
moins à la première moitié du 20ème siècle. Par elle-même, cette évolution du champ médical n’a
pas été suffisante pour modifier substantiellement la politique publique s’adressant à la médecine
libérale française. Il faudra attendre d’autres crises pour rendre possible l’évolution la régulation
par les pratiques.
B.2. UNE CRISE DE CONFIANCE
Jusqu’à la fin du 20ème siècle, la problématique majeure concernant la régulation de la
médecine libérale porte sur la fixation des prix (Hatzfeld, 1963, Pierru, 2007). La question de la
qualité des soins n’apparaît pas dans ce contexte. Le fait que cette question ne soit pas posée ne

RR2015 « De la crise de la médecine libérale à son industrialisation » [Nicolas DA SILVA] PAGE 4 sur 15
signifie pas qu’elle n’est ni importante ni résolue. Le problème de qualité des soins trouve une
solution implicite dans la dimension symbolique extrêmement forte attachée au statu de médecin.
Les investissements normatifs sont si nombreux que le patient accorde facilement au médecin la
confiance suffisante pour assurer la coordination du système de santé : codes de déontologie,
éthique médicale, monopole de la pratique, études longues, etc. (Batifoulier, 1992). Ce cadre
institutionnel a favorisé, du moins pendant un certain temps, le développement du paternalisme
médical. La meilleure définition du paternalisme médical est sans doute donnée par Louis Portes
(1950), ancien président du Conseil national de l’Ordre des médecins, lorsqu’il cherche à définir
l’acte médical et le consentement du patient :
« Face au patient, inerte et passif, le médecin n’a en aucune manière le sentiment
d’avoir à faire à un être libre, à un égal, à un pair, qu’il puisse instruire véritablement.
Tout patient est et doit être pour lui comme un enfant à apprivoiser, non certes
tromper – un enfant à conseiller, non abuser – un enfant à sauver, ou simplement à
guérir. […] Je dirai donc que l’acte médical normal n’étant essentiellement qu’une
confiance qui rejoint librement une conscience, le consentement ‘éclairé’ du malade
[…] n’est en fait qu’une notion mythique que nous avons vainement cherché à
dégagé des faits. Le patient, à aucun moment, ne ‘connaissant’ au sens strict du
terme, vraiment sa misère, ne peut vraiment ‘consentir’ à ce qui lui est affirmé, ni à ce
qui lui est proposé – si du moins nous donnons au mot consentement sa signification
habituelle d’acquiescement averti, raisonné, lucide et libre. » (Portes, 1950, pp. 163-
170)
Le paternalisme médical est donc la doctrine et la pratique selon laquelle le patient est une
confiance qui rejoint librement la conscience du médecin. Or, si la confiance fait partie des
« institutions invisibles » du système de santé (Batifoulier et Gadreau, 2007), elle n’est pas une
donnée inamovible de ce système. Ainsi, les « scandales » de santé publique qui ont rythmé les
années 1980 ont contribué à altérer la confiance placée en la figure du médecin – libéral ou non.
On peut rappeler brièvement le cas de l’« affaire » du sang contaminé qui a non seulement révélé
les défaillances de l’administration sanitaire mais aussi celle des médecins. Dès lors, la question
invisible qui se pose lors de chaque relation patient/médecin redevient visible : faut-il se fier au
médecin et à son expertise ?
A partir de ce type de critique, les années 1980 voient émerger de nouvelles formes de la
relation patient/médecin. De nombreux travaux en sociologie ont pu montrer l’existence d’une
forte hétérogénéité des patients face au savoir médical et plusieurs typologies de patients sont
possibles : actifs/passif, peu informés/ très informés, absence de contrôle des classes
populaires/négociation et choix des classes moyennes consuméristes, délégation de la décision au
médecin/participation à la décision (Herzlich et Pierret, 1991, Llewellyn-Thomas et al. 1991). En
fonction des caractéristiques sociales du patient, certains ont tendance à s’en remettre
aveuglément au médecin alors que d’autres développent une démarche active de recherche
d’information (Morin et Moatti, 1996). Avec la pandémie du Sida s’affirme le profil d’un patient à
la fois informé, actif et qui négocie avec le médecin. En outre, la publicité faite autour des
découvertes médicales impose un « tiers publique » dans la relation de soin qui achève de
renverser le paternalisme médical traditionnel (Barbot et Dodier, 2000).
Au total, il y a une crise de confiance dans la mesure où l’on assiste dans les années 80/90 à
l’émancipation du patient. Dans une optique de « démocratie sanitaire » (Domin, 2006), les
attentes envers le médecin changent : il n’est plus attendu que le médecin ait une compétence
morale attachée à sa personne : évaluer le bien et le mal. La dimension morale de l’activité existe
toujours mais elle doit avant tout être fondée sur des compétences techniques de façon à
favoriser un choix éclairé (Jaunait, 2005). Avec la crise du régime de la preuve et la crise de
confiance, nous avons les deux premiers leviers de l’industrialisation de la médecine libérale. Le
troisième levier qui nous reste à étudier est plus classique : il s’agit de la crise économique.

RR2015 « De la crise de la médecine libérale à son industrialisation » [Nicolas DA SILVA] PAGE 5 sur 15
B.3. UNE CRISE ECONOMIQUE
La crise économique, qui débute dans les premières années de la décennie 1970, est à
l’origine d’un retournement d’orientation de politique publique majeur. Autrefois louée pour ses
effets stabilisateurs, la dépense publique est dès lors considérée comme la principale cause de la
crise. Elle n’est plus un remède mais le mal à soigner. Ce changement profond de référentiel
(Muller, 2000) doit être replacé dans le cadre plus général de transformation de régime
d’accumulation du capitalisme.
Avec les crises des années 1970, s’opère l’entrée progressive dans le postfordisme (Boyer,
2004). Les gains de productivité dans l’industrie s’amenuisent ce qui provoque une tension sur le
compris fordiste entre capital et travail. Or, le poids de la Seconde Guerre mondiale s’est estompé
et le rapport de force n’est plus ce qu’il était. Malgré les grandes luttes ouvrières et étudiantes de
la fin des années 1960, le conflit de répartition de la valeur est tranché en faveur du capital
(Husson, 2010). L’individualisation de la relation salariale – notamment par l’intermédiaire de
dispositifs de rémunération à la performance – désolidarise la classe ouvrière (au sens large). La
fin de siècle se caractérise alors par la modération salariale, le retrait progressif de l’État social et
la hausse des inégalités de tous types (économique, sociale, état de santé, etc.).
C’est à l’aune de ces transformations du capitalisme que Raymond Barre est nommé Premier
ministre en aout 1976 par le Président Valéry Giscard d’Estain. Il a pour objectif prioritaire de
juguler un phénomène nouveau : la croissance simultanée du chômage et de l’inflation. Alors que
longtemps le paradigme keynésien voyait dans ces deux maux une alternative, la crise consécutive
aux chocs pétroliers brouille la compréhension des dynamiques économiques.
La solution apportée par l’exécutif à ce problème réside dans la maîtrise des dépenses
publiques destinée à favoriser le secteur marchand. Les maigres gains de productivité doivent
désormais servir à soutenir l’exportation ceci favorisant en retour la croissance. C’est la politique
de « désinflation compétitive » – qui, notons-le, marque le début de l’acception généralisée de la
part de la classe politique dominante de la « contrainte extérieure », c’est-à-dire, des conséquences
logiques du libre-échange. La politique de désinflation compétitive marque ainsi une rupture par
rapport aux politiques publiques précédentes qui voyaient dans la relance et le soutien à la
consommation le meilleur moyen d’encourager la croissance.
Dans le champ de la santé, l’ordre du jour est le même : contenir l’augmentation des
dépenses dans une situation où il n’est pas question d’augmenter des recettes – qui stagnent en
raison de la crise économique. Renaît alors de ses cendres le débat autour du déficit de la Sécurité
sociale, qui avait été clos par l’Assemblée Nationale en 1949. En ce sens, le problème du déficit
de la sécurité social n’est pas un problème neuf, ce qui est nouveau c’est l’attention qu’on lui
accorde. L’augmentation des cotisations n’est plus à l’ordre du jour et, encore aujourd’hui, cette
présentation mystificatrice du problème reste dominante (Duval, 2007). Le rapport de force et les
idées ayant changé, la question du déficit de la Sécurité sociale tend à devenir un problème
« naturalisé », relevant de l’ordre des choses physiques et non d’une construction sociale et, de la
même façon, la maîtrise des dépenses apparaît être une solution naturelle à ce problème naturel.
Il faut désormais maîtriser les dépenses socialisées et la figure symbolique du médecin n’est
pas épargnée. La santé est un budget comme les autres qui doit faire l’objet de rationalisation. Si
dans un premier temps la puissance publique peine à exercer son pouvoir sur la médecine
libérale, l’affermissement de la contrainte budgétaire rend de plus en plus nécessaire le contrôle
de cette sous-champ de la santé. Les premières politiques de contrôle des coûts n’affectent donc
pas la médecine libérale : réforme de l’hôpital, augmentation du ticket modérateur,
développement de l’assurance santé privé, politique du générique. Au contraire, l’ouverture du
secteur 2 (à dépassement d’honoraire) en 1980 raffermit le pouvoir de la médecine libérale. Les
années suivantes sont le témoin du changement de stratégie de la puissance publique : puisqu’il
est difficile de réguler les prix (opposition des médecins et problème de financement de
l’assurance santé), à partir de 1993 avec les Références médicales opposables commence la
stratégie de régulation par les pratiques (Da Silva et Gadreau, 2015). Il s’agit dans l’esprit du
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%