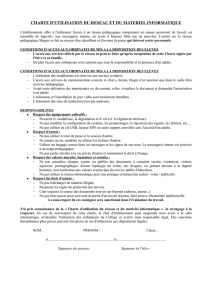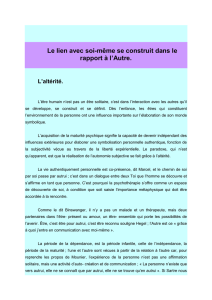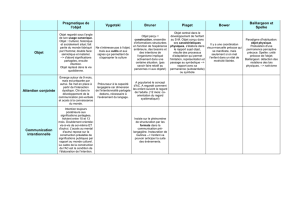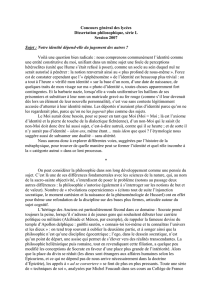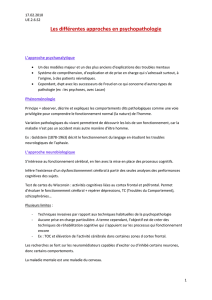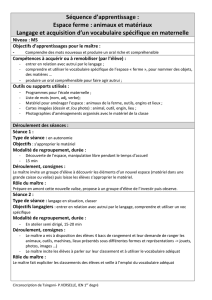Nécessité de l`existence d`autrui pour être soi

NECESSITE DE L’EXISTENCE D’AUTRUI
POUR ETRE SOI
L’ETRE DE CONSCIENCE ET DE LIBERTE N’EXISTE PAS
SI CE N’EST RELATIONNEL A L’AUTRE ET AU TIERS
I. LES HORIZONS DE L’ETRE
Le mot ou le terme qui en nos pensées revient le plus
souvent est sans conteste celui-ci : « être ». Tantôt verbe, tantôt
substantif ; tantôt avec une majuscule, tantôt sans ; tantôt au
singulier, tantôt au pluriel ; tantôt en forme composée, tantôt en
forme simple ; tantôt qualifié et tantôt non... Terme connu et plus
encore méconnu, dont les sens divers s’agglutinent, s’amalga-
ment, se confondent, échangent et se prêtent leurs propriétés et
parfois aussi s’ignorent. Terme qui se voudrait libérateur mais
que l’homme adore en idole totalitaire à moins qu’il ne proclame
sa déchéance pour s’asservir à d’autres hégémonies concep-
tuelles. Terme inévitable, indispensable, lien universel et sujet de
division, portant en lui toutes nos imprécisions, toutes nos
négligences, toutes nos opinions, toutes nos querelles et toutes
nos espérances ! De ce terme d’avenir plus encore que de passé,
est-il possible de dire aujourd’hui enfin la vérité ?
Le discours philosophique débute, se poursuit et se termine
avec le terme « être ». Il en donne d’abord un relevé de surface
en indiquant les différents emplois qui trouvent en lui un profil
sonore et un visage graphique. Il délivre ensuite un compte rendu
de la réflexion qui apporte la justification et l’intelligibilité de
ces emplois qui lui préexistaient et avec lesquels elle est
maintenant contemporaine. Il avoue enfin que ce qui fut
successivement analysé depuis le début et n’a été compris que
dans une vision finale ne peut garder son intelligibilité que si le
sens ultime redevient projet : celui de déployer intelligiblement
notre être en une structure relationnelle d’êtres.
L’homme ne peut donner sens à l’être que s’il se saisit lui-
même comme être. Mais l’intelligibilité du nécessaire de l’être

NECESSITE DE L’EXISTENCE D’AUTRUI POUR ETRE SOI
2
peut-elle être trouvée dans la seule affirmation du « je suis » ?
Nous répondons par la négative, non parce que nous n’aurions
pas d’intuition immédiate de notre être, mais parce que cette
délimitation du nécessaire initial est incomplète. Et si nous
disons qu’elle est incomplète, ce n’est pas parce que nous sau-
rions d’expérience qu’il y a autrui et le monde, mais en raison de
la nature même de l’activité du sujet saisie réflexivement et
parce qu’il ne nous est pas possible d’exclure réflexivement
toute relationnalité à « autre-chose-que-le-sujet ».
La question suivante serait donc : l’intentionnalité de la
conscience envers le monde des choses est-elle susceptible de
rendre compte de toutes les caractéristiques de la relationnalité
du sujet ? Nous répondrons encore par la négative. En effet, la
manière dont nous affirmons les « réalités autres » ne s’explique
pas par l’existence des seules « choses du monde », car l’inten-
tionnalité de notre conscience ne leur est pas adéquatement et
uniquement proportionnée. Cette disproportion a sans doute
inconsciemment poussé Platon — et tous ceux qui se retrouvent
en lui — à affirmer l’idée selon un statut d’intelligible séparé, en
la « personnifiant » en quelque sorte, lui prêtant les caractères de
l’Altérité en tant que telle. Les personnifications mythiques ou
allégoriques de certains concepts sont aussi, en tant que
démarche anthropomorphique, significatives de cette dispropor-
tion. Il conviendra de l’analyser réflexivement en sa nature
réelle, pour accéder à une reconnaissance valable de l’Altérité-
en-l’être.
Si la relationnalité à l’altérité en humanité est constitutive du
« je suis », selon sa perfection et non par manque, et qu’en
raison de la finitude de son être et de cette relationnalité, il est
requis d’affirmer une Transcendance infinie d’être et de rela-
tionnalité d’être, il conviendra ensuite de s’interroger sur la
forme accomplie d’une telle relationnalité, sur sa structure de
plénitude. Celle-ci se révélera de nature ternaire. Elle sera aussi
par le fait même le principe synthétique ultime d’intelligibilité
du Réel, tant en sa perfection en Dieu, qu’en son devenir de
perfectionnement selon un double plan : celui de l’Histoire des
hommes et celui des relations que Dieu engage avec eux pour les
accomplir au-delà de l’Histoire, conformément à son pouvoir
divin de faire être, auquel Il les a rendus participants, les
constituant ainsi en êtres libres, tirant de leur être même les lois
de leurs actions.

NECESSITE DE L’EXISTENCE D’AUTRUI POUR ETRE SOI
3
II. LA QUETE DU FONDAMENTAL
A. LA RECHERCHE DU FONDAMENTAL.
C’est profondément engagés déjà dans le cours de nos médi-
tations, que nous remarquons, d’un regard rétrospectif souvent
chargé de surprise, combien une tradition de pensée et un héri-
tage culturel adoptés — avec plus ou moins de lucidité — au
commencement de notre recherche philosophique, se sont mon-
trés décisifs pour le cheminement de notre réflexion et son
élaboration systématique. L’histoire de la philosophie nous
conduit à la même constatation, soit que nous analysions l’œuvre
de philosophes, soit que nous comparions entre eux les divers
courants d’idées, ou encore que nous dégagions les principes ani-
mateurs déterminants de toute une tradition, notamment celle
dans laquelle nous nous sommes trouvés, à savoir la tradition
occidentale, et à l’égard de laquelle nous ne pouvons éviter de
prendre position.
C’est dans ce que nous reconnaissons et admettons comme
fondamental que nous nous situons par rapport à tout système
existant et que nous entreprenons nécessairement de construire
plus ou moins valablement le nôtre. Ce que nous reconnaissons
comme fondamental et que nous plaçons au point de départ de
notre système, en tant que principes, conditionne ensuite logi-
quement — et même psychologiquement — le reste de l’édifice et
la manière dont nous le bâtirons. Ce point de départ méthodo-
logique — et non historique, bien qu’historiquement discerné au
travers du conflit des idées et venant à son tour l’alimenter — s’il
mesure pour ainsi dire la vérité et la validité des thèses que ce
système renferme, est par réciprocité, du fait de son insertion
dans ce dernier, soumis aux exigences de toute pensée
philosophique.
D’abord il ne supposera aucune affirmation qui, dans son
ordre, lui serait logiquement antérieure et qui garantirait sa
valeur. Sinon il cesserait d’être un point de départ au profit
même de cette affirmation première.
Il faut que tout ce qui est affirmé soit justifié, c’est-à-dire
manifesté dans son évidence. Nous aurons à nous garder d’y
laisser s’infiltrer de façon subreptice — souvent sous le couvert

NECESSITE DE L’EXISTENCE D’AUTRUI POUR ETRE SOI
4
d’une affirmation d’évidence, aussi paradoxal que cela puisse
paraître — des présupposés qui échapperaient à l’examen critique.
Ainsi donc, à l’origine d’une systématisation philosophique,
sans rien présupposer, nous sommes tenus de justifier non seule-
ment tout ce que nous affirmons, mais aussi que nous affirmons
tout ce que nous devons affirmer. Nous sommes tenus de mani-
fester dans son évidence, non seulement que telle ou telle affir-
mation, élément de notre point de départ lui-même, est solide et
valable, mais que ce point de départ considéré dans son
ensemble et au niveau de sa radicalité première, est complet et
exhaustif, que nous n’omettons rien. De toutes les exclusions par
lesquelles nous restreignons notre inventaire initial, de toutes les
abstractions par lesquelles nous le stratifions, nous devons
montrer le bien-fondé.
Enfin si tout point de départ peut être considéré comme un
système en germe et tout système comme l’épanouissement de
son point de départ, il s’ensuivra que la justification à en donner,
interne par nature à l’un et à l’autre, suivra aussi la courbe d’un
développement organique. La justification de notre point de
départ non seulement gagne en valeur du fait d’une meilleure
connaissance de ce qui est impliqué en ce dernier et qui constitue
son objet, mais elle se renforce et gagne en clarté au fur et à
mesure que le système s’explicite et que se révèle sa cohésion
interne et son adéquation au réel.
Quelle sera donc l’expérience, dont nous nous serons pro-
gressivement approchés, qui répondra à ces trois exigences
d’évidence, de complétude et d’unité et qui en outre sera
accessible « en principe » à tout le monde ?
Au terme d’une série de réductions phénoménologiques de
plus en plus généralisées, nous aboutissons à cette description de
la situation humaine : « je suis un être au monde avec autrui ».
De la richesse si diversifiée de l’expérience humaine nous ne
gardons qu’une trilogie d’éléments fondamentaux en relation les
uns avec les autres : l’être que nous sommes chacun pour nous,
la réalité du monde matériel et la présence d’autrui comme
autant de personnes semblables à chacun de nous.
Cette description — d’une vérité indéniable sans aucun
doute — ne satisfait toutefois pas au premier abord à l’exigence
philosophique d’intelligibilité. Constater phénoménologique-

NECESSITE DE L’EXISTENCE D’AUTRUI POUR ETRE SOI
5
ment ne suffit pas. D’abord une telle description pourrait se
comprendre selon une forme de pensée exclusivement objective.
Le « monde » serait l’ensemble des choses que je perçois, duquel
je retire la chose que je me perçois être et les autres choses
semblables à moi, que j’appelle « autrui ». Pour exprimer
complètement cette totalité que je connais objectivement, il faut
donc que je lui restitue la présence perceptible d’autrui et la
mienne. Dans l’ordre d’une pensée objective, une telle
description du Réel représenterait la connaissance la plus
embryonnaire ou la plus pauvre qui soit. L’homme de culture
objective, le scientifique, n’accorderait pas deux secondes
d’attention si l’on voulait lui faire croire que c’est une vérité
fondamentale ; quant au philosophe il exclut immédiatement une
telle signification comme étrangère à sa recherche, car il a tout
lieu de la considérer comme méthodologiquement contradictoire.
Autrui perçu objectivement n’est pas autrui en tant que sujet
mais seulement une chose. Quant au « Je » qui affirme ou est
affirmé être dans le monde, est-ce véritablement un « Je-sujet »
qui se connaît comme « Je » en relation à autrui et avec lui au
monde ou est-ce seulement un « Je » dont je parle en quelque
sorte en troisième personne en disant qu’il occupe une place
parmi les choses et qu’il est avec autrui chose parmi les choses ?
Si je parle de moi comme d’un « Je » qui est chose parmi les
choses alors ce « Je » dont je parle n’est pas le « Je » qui parle,
tandis que je prétends en parler. Il y a contradiction
méthodologique exercée. Si au contraire je parle vraiment du
« Je » qui se connaît et se connaît en relation à autrui et avec
autrui au monde, alors les termes « autrui » et « monde » n’ont
plus le sens qu’ils peuvent avoir pour une pensée objective. Si
malgré tout on soutenait cette description en donnant aux termes
« je suis » un sens réflexif et en gardant un sens objectif aux
termes « autrui » et « monde », alors il y aurait confusion et
contamination des méthodes et des langages. Ce qui est
habituellement le cas. Comment sortir de cette Babel originelle ?
Les voies pour s’approcher de « l’Unique Sentier » qui
conduit à la sagesse philosophique sont nombreuses. A titre
d’exemples, nous pouvons en citer trois : celle du symbolisme
objectif platonicien, celle de l’intériorisation cartésienne, celle de
l’analyse transcendantale kantienne. Chaque philosophe digne de
ce nom a pris son propre chemin, pour arriver finalement à
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
1
/
103
100%
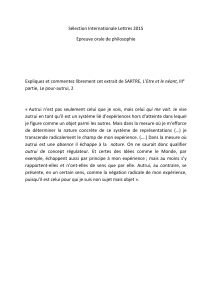
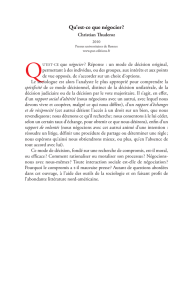
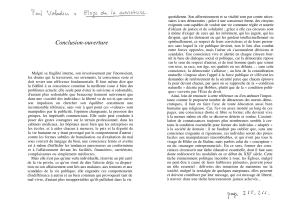
![Inscription de la séquence dans les programmes[1] de l](http://s1.studylibfr.com/store/data/007119161_1-080fc5b72510279fdade3b1afa55e3c0-300x300.png)