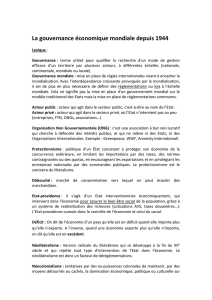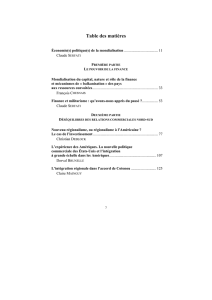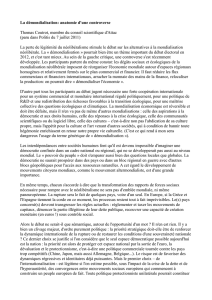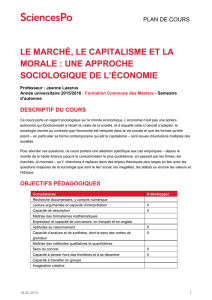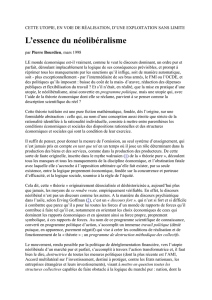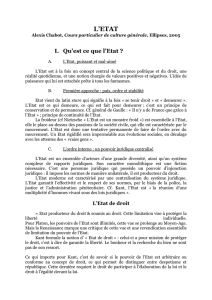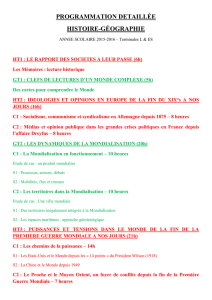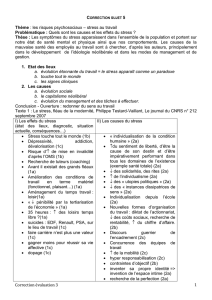Plan provisoire d`un livre encore sans titre Jaime Marques

Plan provisoire d’un livre encore sans titre
Jaime Marques Pereira
Introduction
Le vent tourne. Le creux de la vague du néolibéralisme triomphant semble désormais
derrière nous. L’heure est-elle venue où il est permis d’imaginer une alternative à la
trajectoire de la civilisation occidentale qui consacrerait le règne des marchés sur des sociétés
s’accommodant de la division irréversible entre ceux qui en tirent parti et ceux qui en sont
exclus. Le doute sur les vertus du néolibéralisme n’est plus, en tous les cas, le monopole de
des gauchistes ou de tous ceux qui, pour en faire la critique, se retrouvaient taxés de
passéistes. Le doute prend forme dans un mouvement social certes diffus mais qui fait
émerger une contestation politique, qu’il s’agisse de la grève de décembre 94 en France, du
mouvement des sans terre et des sans toit au Brésil, ou encore du néo-zapatisme mexicain. Le
doute s’exprime également au sein des élites dirigeantes. Il devient manifeste qu’elles ne
croient plus au “ tout marché ”. Le débat sur la nécessité de réguler la finance internationale
s’est imposé après les crises asiatiques. La crainte de l’ingouvernabilité des sociétés
fracturées par la concentration accélérée de la richesse qu’induisent les politiques néolibérales
affecte non seulement la classe politique mais également les investisseurs internationaux. Elle
s’exprime dans les nouveaux discours des organismes internationaux sur la nécessité des
politiques sociales. Le retour de l’Etat est également préconisé comme une exigence
proprement économique car le marché ne prend pas en charge la formation de la main
d’œuvre et la productions des infrastructures qui conditionnent les gains de compétitivité.
Faut-il croire pour autant à la possibilité d’un tournant décisif qui remettrait à l’ordre du jour,
à l’heure de la mondialisation du capital, la perspective d’une gestion plus prometteuse de
l’économie sur le plan social ?
Au-delà des indices d’un changement des mentalités, ce livre cherche à montrer que
l’avenir du néolibéralisme est bien loin d’être, d’ores et déjà, scellé par le développement,
quant à lui irréversible, de la mondialisation. Le modèle néolibéral de gestion des sociétés
n’est encore pour l’instant qu’une utopie, ou mieux dit, une idéologie occultant que les
politiques économiques productrices de chômage, d’exclusion, voire de dissolution sociale,
ne sont pas les seules possibles, sous peine de se retrouver condamné à une régression sociale

2
plus grave encore par manque de compétitivité. Ces choix ont été avant tout une séquence de
décisions politiques qui ont débouché sur l’hégémonie des marchés financiers sur les Etats-
nation, en même temps qu’elles restauraient celle des Etats-Unis dans le jeu des relations
internationales.
S’il est souvent dit que la mondialisation du capital donnant le pouvoir aux forces de
marché est un processus politique autant qu’économique, le poids de l’idéologie libérale sur
l’opinion publique, mais aussi sur le débat scientifique, conduit à faire oublier que les Etats,
même soumis à la finance globale, sont tenus d’administrer des populations et d’organiser les
marchés pour assurer la survie des premières et le fonctionnement des seconds. C’est bien en
cela que le “ tout marché ” est une utopie complètement irréalisable. Ce qui ne veut pas dire
pour autant que l’histoire contemporaine ne puisse produire des sociétés d’apartheid et un
monde où le clivage entre nations pauvres et nations riches continue de s’approfondir de
façon encore plus accélérée que par le passé. Mais, rien n’est encore joué et l’on peut
imaginer une autre économie sur la base d’une autre politique dés lors qu’une utopie
nouvelle, réactualisant celle du siècle des Lumières émergerait dans un débat qui ne serait
plus, comme il l’est depuis l’effondrement du communisme, enfermé dans une vision fataliste
de la domination irréversible des forces du marchés sur le politique du fait de la
mondialisation. Il faut repenser l’utopie des Lumières, celle de la citoyenneté qui n’est
devenue effective que par le dédoublement des droits individuels en droits sociaux, car il faut
désormais redéfinir l’organisation des sociétés en fonction des changements de leurs assises
territoriales, économiques et politiques. La souveraineté du peuple ne peut plus être
seulement nationale. Le rapport entre le public et le privé se redéploie à l’échelle sous et
supranationale mais l’Etat-nation n’en demeure pas moins l’acteur central de la définition de
ce qui est du domaine de l ‘économie publique et de l’économie privée.
Ebaucher les fondements de cette utopie, c’est faire l’épure d’un autre modèle de
société qui puisse donner des repères, un horizon du possible, aux manifestations refus. Le
mot d’utopie ne s’oppose pas, en ce sens, à celui de réalité. On peut le rapprocher de ces
anticipations autoréalisatrices qu’opèrent constamment les acteurs des marchés financiers (la
croyance en la possible montée du cours d’une action la fait acheter, ce qui précisément
conduit à la valoriser). Bien sûr, une bifurcation historique qui éloignerait l’avenir des
sociétés du modèle néolibéral n’est pas plus jouée d’avance que ne l’est la réalisation de ce
dernier. Mais l’histoire des faits est en partie précédée de celle des idées qui en conçoivent la
possibilité à partir des dynamiques passées et présentes. De ce point de vue, le moment actuel

3
- marqué par l’épuisement du long cycle historique que fut le développement de l’Etat-nation
encadrant celui du capitalisme - est analogue à celui des Lumières qui en ont inventé les
contours démocratiques lorsqu’il était absolutiste. Au même titre qu’elles ont pu entrevoir
dans les transformations sociales de l’époque la possibilité de réactualiser les principes de
gouvernement de la cité antique, ils s’agit aujourd’hui de mettre en avant celles qui sont
susceptibles d’être le moteur d’une bifurcation de l’histoire qui en réinvente les modalités
dans le contexte nouveau de la mondialisation. Ces transformations sont repérables dans les
impasses économiques et politiques auxquelles mène le néolibéralisme, tel qu’il a été mis en
œuvre jusqu’à présent.
Ces impasses se visualisent dans l’enchaînement d’effets pervers d’une
financiarisation excessive de l’économie qui impose une réduction continue du coût du travail
pour compenser l’augmentation du coût du capital, se traduisant par l’augmentation du
chômage et la baisse des salaires, ce qui a pour effet de grever le potentiel d’expansion de la
consommation, et en conséquence, celui de l’investissement productif, dont l’attrait est par
ailleurs déjà fortement amenuisé par la haute rentabilité de la finance. Ce cercle vicieux qui
enferme l’économie dans une croissance dite “ molle ”, condamne en outre les Etats à un
ajustement fiscal sans fin qui les expose à un déficit de légitimité dont il n’est pas sûr qu’ils le
neutraliseront éternellement en s’accusant eux-mêmes d’inefficacité du fait de leur obésité.
Le néolibéralisme a certes été jusqu’à présent une idéologie efficace en fournissant aux Etats
le discours justifiant leur incapacité à résoudre la crise sociale qu’ils ont céée. Mais, la
morosité de la croissance dessine le spectre de l’ingouvernabilité politique, et la convergence
entre l’une et l’autre profile la menace de crises financières dès lors que les hausses de taux
d’intérêts destinées à rassurer les rentiers de la dette publique ne font que les rendre encore
plus sceptiques de la capacité des Etats à couper dans les dépenses dans une conjoncture de
dégradation du climat social.
De ces contradictions peut émerger la perspective d’une alternative, pour autant que
les débats politiques en pointent la possibilité. C’est là une question de normes de gestion de
l’économie et de la société dont il faut faire naître la discussion tant sur un plan théorique
qu’au sein de l’opinion publique. Défendre une autre économie et une autre politique, c’est en
fait se placer sur un plan normatif plus réaliste que celui des libéraux. Ceux-ci fondent leurs
préceptes sur une théorie économique reposant sur des bases illusoires – à savoir que
l’économique marchand serait un système de fixation des prix et des quantités qui rendent les
choix économiques autonomes de la volonté politique et des rapports de pouvoir. Il est de

4
plus en plus douteux que l’économie de marché continue pour longtemps d’apparaître comme
le support d’une société équitable et que les Etats puissent éternellement faire croire qu’ils
dérégulent alors qu’ils organisent le pouvoir des forces du marché.
La question centrale que posent l’idée et la mise en œuvre d’une alternative au
néolibéralisme est de savoir par quelles régulations de l’économie il est possible de concevoir
une restauration du cercle vertueux qu’avait autrefois noué l’Etat-providence entre la
croissance de l’emploi, des profits, des salaires et des prestations sociales. La question est
pertinente une fois qu’on établit que sa crise n’est pas inéluctable dans un contexte de
mondialisation du capital mais qu’elle résulte de la façon dont celle-ci a été politiquement
conduite. Le problème-clé est celui de restaurer une capacité politique d’une forme de
régulation de l’économie qui cesse de reposer sur la régression sociale, comme c’est le cas à
l’heure actuelle. Une telle perspective n’est pas évidente mais elle n’est pas exclue car le
projet néolibéral, pour plus qu’il soit devenu hégémonique, n’annule pas l’histoire sociale. De
nouveaux acteurs se constituent, de nouveaux imaginaires politiques se font jour. La donne de
légitimité gouvernementale est en train d’évoluer.
Ce qui peut paraître sans doute l’invention institutionnelle la plus ardue, tant il s’agit
là d’une rupture dans l’histoire, c’est la nécessité de redéfinir l’assise territoriale de la
souveraineté pour conformer un espace public correspondant à la nouvelle géographie du
capital. Mais là aussi, le débat commence à prendre forme, au moins en ce qui concerne
l’Europe. Le pari des banquiers de voir la monnaie unique administrée par une instance de
pouvoir économique, libre de toute contrainte de légitimité, est bien loin d’être gagné. Pour
qu’il le soit, il faudrait que la norme de politique économique et sociale qu’ont imposée aux
Etats les marchés financiers voit sa légitimité aux yeux des populations consolidée, celles-ci
finissant par accepter l’idée qu’une flexibilité des salaires et des conditions d'emploi
semblable à celle que connaissent les concurrents de l'Europe sur le marché mondial soit
vraiment la condition d’une stabilité de la nouvelle monnaie garantissant les gains de
compétitivité dont dépendrait une croissance capable de résorber le chômage. Penser
l’alternative à un tel scénario, dont ce livre s’attache à démontrer la supériorité économique et
à cerner les conditions politiques de mise en œuvre, c’est faire le pari opposé, à savoir que
l’évolution des conditions de légitimation des Etats, mises à mal par les effets pervers de la
financiarisation, finiront par renouveler les termes du débat politique au point de voir
s’affirmer l’idée qu’une croissance plus forte et plus riche en emplois dépend, bien au

5
contraire, de l’institution d’un pouvoir européen doté d’une réelle légitimité et récupérant la
souveraineté monétaire perdue des Etats-nation.
Une telle idée ne s’imposera pas sans un renversement radical des jugements sur les
dégâts sociaux qu’on attribue à tort directement à la mondialisation, déresponsabilisant ainsi
au passage les élites politiques. Dessiner un modèle alternatif de société qui soit une nouvelle
utopie crédible et donc potentiellement porteuse de nouveaux débats politiques susceptibles
de donner une perspective et une cohérence à ce front du refus du néolibéralisme qui se fait
jour de façon diffuse, implique de faire la lumière sur la séquence de choix politique qui ont
mené à l’effacement du politique, au sens de discussion d’opinions publiques sur
l’administration de la société et de l’économie. Aussi, partira-t-on d’un survol historique des
25 dernières années pour montrer comment les élites dirigeantes ont vidé de tout contenu le
principe de souveraineté. Sur base de cet état des lieux braquant les projecteurs sur la gestion
politique de la mondialisation, il faut alors préjuger de l’avenir, soit comme une tentative de
contrer, d’administrer vaille que vaille les effets pervers des pouvoirs excessifs de la finance
en institutionnalisant la régression sociale par une forme de gestion autoritaire des
populations, certes renouvelée, dont l’idéologie sécuritaire est aujourd’hui le signe avant-
coureur, soit comme un développement de nouvelles formes de mobilisation redéfinissant le
politique et permettant de construire une autre économie.
Ière partie : L’empire de la pensée unique et les impasses des politiques néolibérales
Durant le dernier quart de siècle, la civilisation occidentale semble basculer d’une
société s’attachant à la réduction des inégalités à une société qui les accepte comme un mal
nécessaire. Cette résignation s’associe à la croyance en la victoire irréversible des forces du
marché sur celles de l’Etat qu’auraient amené la mondialisation et le développement des
nouvelles technologies. La réalisation d’un monde réglé par la main invisible impliquerait de
ce fait la fin des idéologies, que d’aucuns extrapolent en fin de l’histoire. L’idée qu’il
n’existerait plus désormais d’alternative au projet néolibéral repose en fait sur le présupposé
erroné que la mondialisation est une dynamique économique à laquelle ni les Etats, ni les
entreprises, et encore moins les acteurs sociaux, seraient en mesure de s’opposer. Une telle
conception du monde délimite la discussion des choix politiques à un débat technique du
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%