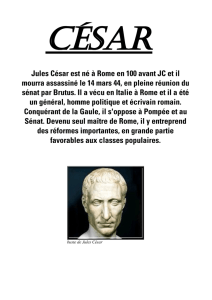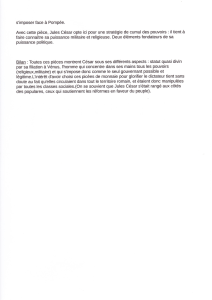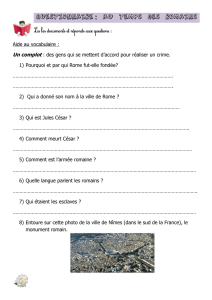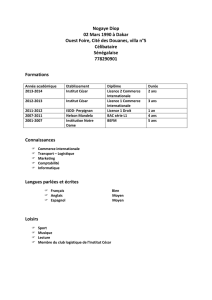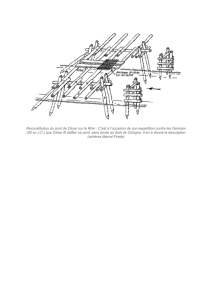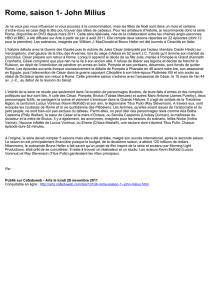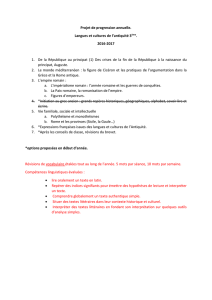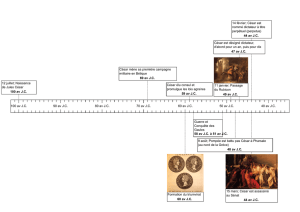T3 - L`Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

HISTOIRE DES ROMAINS
Par Victor DURUY
Membre de l’Institut, ancien ministre de l’Instruction publique
TOME TROISIÈME

SEPTIÈME PÉRIODE — LES TRIUMVIRATS ET LA RÉVOLUTION
(79-30).
CHAPITRE XLVIII — POMPÉE, LÉPIDE ET SERTORIUS (79-70).
I. — RÉSUMÉ DE LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE.
La vie des peuples se partage en périodes qu’on peut appeler organiques ou de
vie pleine et tranquille, et en périodes inorganiques ou de transformation
violente. Les nations sont dans la première époque quand elles ont trouvé la
forme de gouvernement qui convient le mieux à leurs intérêts présents, et elles
sont dans la seconde lorsque les forces sociales entrent en lutte les unes contre
les autres. Le temps des rois avait été, à Rome, autant que nous le connaissons,
celui de la formation harmonieuse de la société et de la grandeur de l’État. Il fut
suivi d’un siècle et demi de rivalités intestines et de faiblesse extérieure. Après
Licinius Stolon, au contraire, la paix se rétablit entre les deux ordres par l’égalité,
et la fortune de Rome reprend son cours. Mais aux guerres héroïques d’Italie et
d’Afrique, dont on a vu l’enchaînement inévitable, à celles de Grèce et d’Orient,
plus politiques que nécessaires, succéda, par l’effet des causes que nous avons
longuement étudiées1, une nouvelle période de déchirements intérieurs.
Ou premier des Gracques à Sella, durant cinquante années, ces hommes,
naguère si grands en face de Pyrrhus, d’Annibal et des Macédoniens, redevinrent
les fils de la louve ; ils s’égorgèrent entre eux pour savoir à qui resterait le
monde. Afin de suivre, au milieu de tant de massacres et de ruines, le double
mouvement de destruction et de renouvellement qui s’opère, à cette époque, au
sein de la société romaine et qui, sous des formes et des noms différents, se
continuera pendant une autre moitié de siècle récapitulons les tragédies que
nous avons vues, afin de mieux comprendre celles que nous allons voir.
Deux siècles de guerres, de conquêtes et de pillage avaient eu pour conséquence
de concentrer tous les pouvoirs aux mains d’une étroite oligarchie et d’user cette
portion moyenne du peuple romain qui jadis remplissait les légions et les tribus
rustiques. Deux classes ennemies, les pauvres et les riches, se trouvèrent en
présence. Pour les empêcher de se jeter l’une sur l’autre, les Gracques
essayèrent de reformer par la loi agraire une population virile de petits
propriétaires ruraux, et de constituer dans l’État, par l’attribution du pouvoir
judiciaire aux chevaliers, un troisième ordre qui tînt la balance entre les deux
autres.
Les Gracques tombent sous les coups des grands, et, avec eux, la cause
populaire, qui était celle de la république et de la liberté, semble perdue. Mais,
comme elle offre aux ambitieux un moyen de produire au Forum des agitations
favorables aux menées ténébreuses, des patriciens, des consulaires, passent au
peuple sous prétexte de défendre ses intérêts, et l’État se partage entre deux
factions, les conservateurs obstinés et les révolutionnaires à outrance. Au fond,
les uns et les autres n’ont plus souci que de pouvoir et d’or ; les idées
généreuses qui avaient animé les Gracques sont mortes avec eux.
1 Aux chapitres XXXV et XXXVI.

Marius, qui reconstitue le parti populaire, ne sait pas le conduire, et son associé,
Saturninus, le compromet par ses violences. Ce tribun est tué, Marius s’exile, et
l’oligarchie triomphe encore.
Scipion Émilien et le second Drusus cherchent une autre solution au problème de
la constitution romaine : ils voudraient faire place aux Italiens dans la cité, afin
de donner à l’empire une large base qui pût le porter longtemps. L’un est
assassiné par les chefs du petit peuple de Rome, qu’il méprise ; l’autre par les
chevaliers, qu’il voulait dépouiller de la judicature ; et les Italiens, perdant
l’espoir qu’une loi leur fasse justice, recourent aux armes. Une guerre terrible
éclate ; le nom seul en dit l’horreur : la guerre Sociale, ou des alliés.
Les Italiens, vaincus, semblent sortir victorieux de cette lutte fratricide : ils
obtiennent le droit de cité, mais la noblesse, pour rendre ce droit illusoire,
enferme les nouveaux citoyens dans des tribus qui ne voteront jamais, et en
même temps elle s’aliène les chevaliers par le retrait des jugements.
Marius, revenu d’exil, et Sulpicius profitent de cette double faute pour associer à
leur cause les nouveaux citoyens et l’ordre équestre. L’un est égorgé ; l’autre,
qui, dans sa fuite, manque dix fois de l’être, revient avec une armée d’esclaves
et d’Italiens, se baigne dans le sang de la noblesse et meurt au moment où le
vengeur des grands arrive.
Ainsi chaque parti a du sang sur les mains, mais c’est la noblesse qui en a le plus
répandu. Dans ces cinquante années, l’oligarchie compte cinq victoires marquées
par le meurtre des principaux adversaires du sénat et couronnées par une
dictature inexorable1.
Sylla croit en finir avec la faction populaire, les Italiens et les chevaliers, par un
immense égorgement, et avec toutes les nouveautés par une législation qui
ramène la république de trois siècles dans le passé, au temps où les patriciens
étaient tout et le peuple rien. Les essais de réforme en avant ont échoué, la
réforme en arrière réussira-t-elle ? On le saura en suivant les dramatiques
péripéties de la révolution qui conduira Rome à une nouvelle époque organique,
où ses destinées seront fixées pour quatre siècles.
II. — POMPÉE.
Les dix années que dura la constitution cornélienne furent une des plus
désastreuses époques que la république ait traversées, celle où chacun fut le
moins assuré d’un lendemain.
La haine du peuple et des Italiens, les ressentiments de l’ordre équestre et
quatre guerres dangereuses : telle était la succession de Sylla. Qui allait recueillir
ce difficile héritage ? Un sénat où les proscriptions des deux partis n’avaient pas
laissé une seule tête qui dépassât le niveau commun de la médiocrité : Metellus
Pius, général malheureux ; Catulus, en qui se trouvait de quoi faire plusieurs
grands hommes2, mais qui ne sut pas être, ce qui eut mieux valu pour la
république, un grand citoyen ; Hortensius, qui ne vivait que pour le barreau et
ses murènes ; Crassus, moins occupé d’affaires publiques que de dénaturer sa
1 Meurtre de Tiberius, 133 ; de Caius, 121 ; de Saturninus, 100 ; de Drusus, 91 ; de Sulpicius et
des amis de Marius, 88 ; proscriptions de Sylla, 82.
2 Le mot est de Cicéron ; mais il avait l’éloge aussi facile que l’invective : Catulus refusa à Caton la
condamnation d’un greffier coupable et voulut acheter à César la candidature au grand pontificat.
Cf. Plut., dans Cato minor et dans Cæsar.

fortune mal acquise et d’acheter Rome pièce à pièce ; Philippus, qui avait si bien
manœuvré depuis vingt ans au milieu des écueils et qui, arrivé au faite des
honneurs, s’y reposait ; enfin le plus capable peut-être de tous ces médiocres
personnages, Lucullus, élégant épicurien, Romain d’Athènes, resté jusqu’alors en
sous-ordre dans les affaires, et sans goût pour le premier rôle. Échappés à de si
longues tourmentes, ces sénateurs ne demandaient qu’à jouir en paix de la vie,
de leur beau soleil, de leurs villas dévastées et qu’ils restauraient. Mais autour
d’eux se pressait une génération plus jeune, plus ardente lus forte pour le bien
comme pour le mal ; Cicéron avait alors vingt-huit ans, César vingt-quatre,
Caton dix-sept ; Brutus était plus jeune ; Catilina et Verrès avaient déjà rempli
des charges.
Par son âge, Pompée appartenait à cette génération1 ; mais décoré des noms de
Grand, d’Imperator, de Triomphateur, il marchait à part. Et nous sommes si loin
de l’égalité, si près de la monarchie, que, sans avoir été régulièrement appelé à
aucune fonction, sans être sénateur, sans même pouvoir compter sur un parti
politique, Pompée était tout-puissant dans la cité. Ce personnage froid, irrésolu
et aussi incapable que Marius d’une conception politique, a été cependant trop
maltraité par nos historiens modernes, qui aiment à juger les hommes par les
petits côtés, à les peindre par l’anecdote, même apocryphe, à la façon de
Plutarque. Un homme ne conserve, durant quarante années, la grande situation
que Pompée se fit dès les premiers jours qu’il la condition d’être par quelque côté
supérieur à ses concitoyens. Il est vrai que, jusqu’à sa dernière bataille, il mérita
mieux que Sylla le surnom de favori de la Fortune. Elle fit beaucoup pour lui : ne
fit-il rien pour elle ? S’il rencontra des circonstances propices, il sut aussi en faire
naître et tirer d’elles, par audace ou sagesse, les avantages qu’un autre aurait
laissé perdre. Ces nuits passées dans les veilles, ces études persévérantes pour
préparer et enchaîner d’avance la victoire, ne sont pas d’un homme qui
s’abandonne paresseusement à la faveur des dieux2.
Sans être Caton, il avait sa frugalité et sa haine des molles coutumes venues de
l’Orient3, avec moins d’affectation et une dignité contenue qui annonçait l’homme
fait pour le commandement. Un jour qu’il était malade et dégoûté de toute
nourriture, son médecin lui recommanda de manger une grive ; on en chercha
partout, et il ne s’en trouva nulle part à vendre. Quelqu’un assura qu’on en aurait
chez Lucullus, qui en nourrissait toute l’année : Eh quoi ! dit Pompée, si Lucullus
n’était pas un gourmand, Pompée ne saurait vivre ? Et il refusa. Il était éloquent,
car à vingt ans, dans un procès difficile, il sauva la mémoire de son père et
1 Né le 99 septembre 106, Pompée avait l’âge de Cicéron. On place ordinairement la naissance de
César en l’année 100. Dans ce cas, nommé, en janvier 86, flamine de Jupiter, il n’aurait eu alors
que treize ans et quelques mois : ce qui est bien peu pour un pontificat. Son édilité est de l’année
65, et, d’après la lex annalis, on ne pouvait y arriver qu’à trente-sept ans. César aurait eu cet
âge, s’il était né en 102. En plaçant sa naissance à cette date, il se serait trouvé dans les conditions
requises pour la préture, qu’il eut en 62, à quarante ans, et pour le consulat, qu’il géra en 59, à
quarante-deux ans révolus. Or, de 82 à 49, la loi de Sylla sur les magistratures fut rigoureusement
observée, excepté pour Pompée en 70 et en 52 ; on verra plus loin les motifs de cette double
exception. Lorsque César rentra dans Rome, en avril 49, il se donna lui-même sur les monnaies
cinquante-deux ans révolus. Cf. Cohen, Monn. consul., pl. XX, gens Julia ; les pièces numérotées
14, 15 et 16 portent le chiffre 52.
2 Diodore, XXXVIII, 9.
3 Id., ibid. Cf. Plutarque, Pompée, 2. Lucullus avait rapporté de Cérasonte le cerisier ; Pompée
rapporta d’Orient l’usage des moulins à vent et des moulins à eau, qui remplacèrent les moulins à
bras, seuls connus en Italie, et il fit traduire en latin par un de ses affranchis les ouvrages des
Grecs sur la médecine.

conquit son juge, qui, au tribunal même, le prit pour gendre. Il était brave1 : sa
vie presque entière se passa dans les camps ; hardi et entreprenant : au milieu
de l’Italie couverte des légions de Carbon, il se déclara pour Sylla et lui donna
une armée qui peut-être le sauva. Cette armée, Pompée sut la garder à lui, tout
en la faisant servir aux intérêts du parti ; il la conduisit où le dictateur voulut, en
Cisalpine, en Sicile, en Afrique ; partout vainqueur et imposant par ses succès à
Sylla même, qui crut reconnaître, dans ce jeune homme toujours heureux, cette
puissance fatale qu’il aimait à voir respecter en lui.
Le terrible dictateur fut comme subjugué ; pour empêcher que ce bonheur ne
devînt rival du sien, il fit entrer Pompée dans sa famille, en lui donnant sa petite-
fille Æmilia. Cependant il eut un moment de défiance ; quand Pompée eut vaincu
Domitius et Hiarbas, il lui ordonna de licencier ses troupes. Les soldats se
révoltaient à la pensée de perdre le plaisir et les profits d’une entrée triomphale
dans Rome ; Pompée les apaisa et revint seul. Cette confiance le sauva ; Sylla
sortit avec tout le peuple à sa rencontre et le salua du nom de Grand. Mais il
voulait le triomphe, un triomphé magnifique, car il avait ramené d’Afrique des
éléphants pour les atteler à son char ; et il n’était pas même sénateur ! Sylla
refusa. Qu’il prenne donc garde, osa dire le jeune victorieux, que le soleil levant
a plus d’adorateurs que le soleil couchant. Autour de lui, tout le monde tremblait
; le dictateur, surpris, pour la première fois céda : Qu’il triomphe, s’écria-t-il à
deux reprises, qu’il triomphe ! (81) Le peuple applaudissait à cette audace, et
déjà regardait avec complaisance ce général qui ne tremblait pas en face de celui
devant qui tout le monde tremblait.
Pompée n’avait encore géré aucune charge. Aux faisceaux consulaires il préférait
la position qu’il s’était faite sans élection du peuple ni du sénat. Seul aussi de
tous les chefs syllaniens, il n’avait pas trempé dans les proscriptions, du moins
dans le pillage des biens des victimes. A Asculum, durant la guerre Sociale, il
n’avait pris que quelques livres. C’était encore une singularité heureuse, et
comme un reproche pour les vainqueurs, une espérance pour les vaincus. Aimé
des soldats, respecté du peuple, il avait un crédit dont il refusa de se servir pour
lui-même, parce qu’il n’aurait pas voulu d’un consulat obscurément passé, et
qu’il comprenait que les temps n’étaient pas venus de se signaler, dans cette
magistrature, par quelque acte mémorable. Agé de vingt-huit ans, il n’aurait pu
d’ailleurs la demander qu’en violant la loi ; mais il tint à prouver son influence en
appuyant une candidature hostile au sénat. Malgré les grands, il fit élire Lépide,
qui ne cachait pas sa haine contre les nouvelles institutions (78)2. Jeune homme,
lui dit Sylla, en le voyant traverser tout fier la place des comices, tu es bien
glorieux de ta victoire. En vérité, c’est un bel exploit d’avoir fait arriver au
consulat un mauvais citoyen ! Mais veille avec soin, tu t’es donné un adversaire
plus fort que toi. Ces mots faillirent être une prophétie. Quand on apprit la mort
du dictateur, Lépide voulut empêcher qu’on rendît à sa mémoire des honneurs
publics, et déjà il parlait d’abolir ses lois. C’était aller trop vite pour pompée.
Malgré la froideur que Sylla lui avait montrée dans les derniers temps3, Pompée
se respectait trop lui-même pour trahir sitôt la cause qu’il avait tant servie ; il
1 A l’assaut du camp de Domitius, il voulut combattre sans casque. (Plutarque, Pompée, 11.)
2 Voyez dans les fragments de Salluste, un discours violent que cet historien prête à Lépide et qui
se termine par un véritable appel aux armes ; s’il n’est pas de Lépide, on peut le regarder comme
répondant à ses sentiments.
3 Il ne le nomma point dans son testament.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
 339
339
 340
340
 341
341
 342
342
 343
343
 344
344
 345
345
 346
346
 347
347
 348
348
 349
349
 350
350
 351
351
 352
352
 353
353
 354
354
 355
355
 356
356
 357
357
 358
358
 359
359
 360
360
 361
361
 362
362
 363
363
 364
364
 365
365
 366
366
 367
367
1
/
367
100%