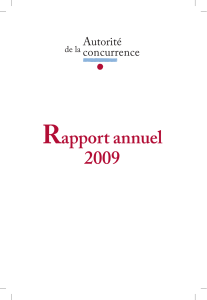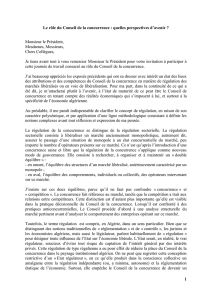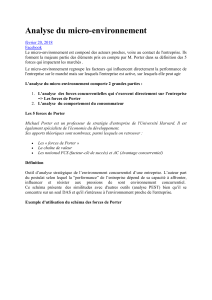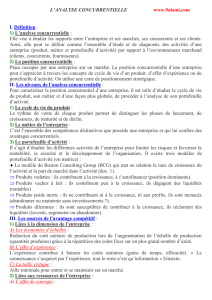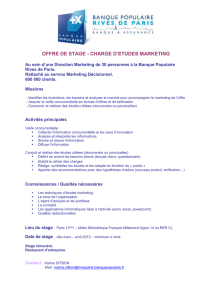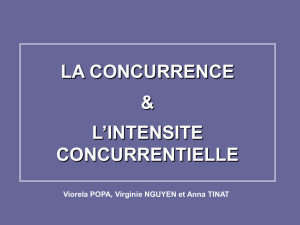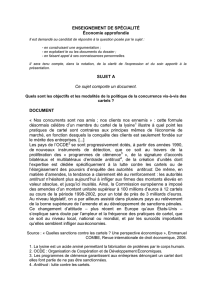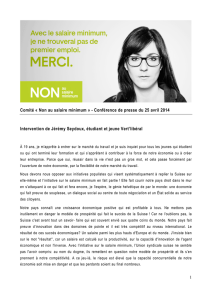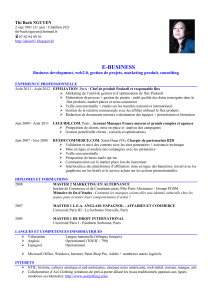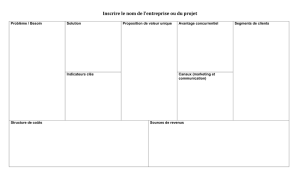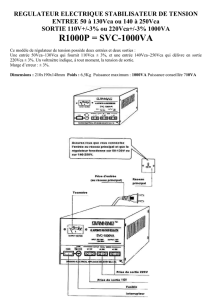La culture de la concurrence : La démonstration par la preuve

711
À QUOI SERT LA CONCURRENCE ?
La culture
de la concurrence :
La démonstration
par la preuve
bruNo lasserre
Président
Autorité de la concurrence
La concurrence est une notion ancrée dans le champ des libertés politiques. Le constat
de la corrélation entre, d’une part, le développement de la libre concurrence dans le
champ économique et, d’autre part, les avancées des libertés publiques et de la démo-
cratie, « organisation de la concurrence pacique pour l’exercice du pouvoir » (R. Aron,
Introduction à la philosophie politique. Démocratie et révolution, Éditions de Fallois,
1997) a plus d’une fois été fait.
Ainsi, en France, la politique de concurrence a été inaugurée par l’avènement de la
liberté du commerce et de l’industrie. C’est à l’époque de la Révolution, en 1791, que
la loi a supprimé les « jurandes et maîtrises » et les « corporations », associations de
personnes exerçant le même métier, qui en réglementaient l’exercice à l’échelle de
chaque ville, et ainsi permis à chacun de s’établir dans la profession de son choix. Plus
près de nous dans le temps, l’Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, s’est
attachée corrélativement à recouvrer un régime démocratique et à démanteler les anciens

712 À QUOI SERT LA CONCURRENCE ?
La culture de la concurrence : La démonstration par la preuve
trusts. En Corée du Sud, le processus de démocratisation intervenu au cours des
années 1980, rompant avec un régime autoritaire, a dans le même temps démantelé
les conglomérats, les chaebols. Alors en effet que la concentration du pouvoir écono-
mique est susceptible d’être maintenue par un pouvoir autoritaire, dans une confusion
entre oligarchies économique et politique, l’accès partagé aux ressources productives
et la liberté d’initiative économique accompagnent le plus souvent l’émergence d’une
offre politique diversiée et la distribution du pouvoir.
La concurrence, comme les institutions démocratiques, procède de l’idée de pluralité,
mais aussi de loyauté dans la confrontation. Quand la démocratie a pour principe « le
respect des règles » et « offre aux citoyens le maximum de protection contre les abus
de pouvoir » (ibid.), de même la concurrence doit se déployer dans le respect de l’ordre
public économique, an de permettre aux acteurs économiques d’être préservés de
tout abus de la part des compétiteurs en situation dominante.
La régulation concurrentielle : Corriger et convaincre
Dans ce contexte, la question pertinente paraît consister autant à rechercher « à quoi
sert la concurrence » qu’à démontrer à quoi sert la régulation concurrentielle.
En France, c’est le même texte – l’ordonnance du 1er décembre 1986 – qui a instauré
la liberté des prix et établi une autorité indépendante chargée de la régulation concur-
rentielle, dans un mouvement par lequel l’État, lors du passage à une économie de
marché, a remis entre les mains des opérateurs économiques le pouvoir de déterminer
leur stratégie et leur politique commerciale, en même temps qu’il s’est défait de celui
de contrôler leur comportement, compétence dévolue à une autorité indépendante. Cet
arbitre impartial, et ainsi légitimé à l’égard des acteurs économiques, a la charge de
rappeler les règles et de les faire respecter, par l’arme de la sanction – instrument ultime
de la crédibilité du régulateur – et par le soft power qu’est la pédagogie de la concur-
rence.
L’Autorité de la concurrence est en effet souvent désignée comme le « gendarme » de
la concurrence, mais il serait plus juste d’évoquer son rôle d’« avocate » de la concur-
rence – qui fait écho, sans la traduire parfaitement, à la notion anglo-saxonne d’advo-
cacy. La régulation concurrentielle ne se résume pas, en effet, à l’exercice du pouvoir
de sanction des pratiques anticoncurrentielles ou du contrôle des concentrations, quelque
fortement qu’ils contribuent à la visibilité du régulateur. La fonction consultative,
exercée à l’endroit des entreprises ou des pouvoirs publics, joue un rôle complémen-
taire et essentiel en amont, car elle contribue à limiter les restrictions de concurrence
liées aux réglementations et elle éclaire les entreprises sur les risques concurrentiels,
en leur permettant de jouer la carte de la conformité. La fonction consultative a du
reste été, historiquement, le premier pilier de la régulation concurrentielle : exercée
en France dès 1953 par la Commission technique des ententes, conrmée en 1977 lors
de la création de la Commission de la concurrence, puis ayant donné son nom au
« Conseil » de la concurrence en 1986, elle a été renforcée par la loi de modernisation

713
À QUOI SERT LA CONCURRENCE ?
Bruno Lasserre
de l’économie du 4 août 2008, qui a conféré à l’Autorité le pouvoir d’autosaisine en
matière consultative.
Avocat, le régulateur concurrentiel est aussi arbitre, au sens sportif du terme : sans être
dénué du pouvoir de sanctionner, il veille d’abord au respect de la règle en intervenant
dans l’intérêt du collectif de jeu, du bon déroulement de la partie, sans entraver la
vigueur des joueurs, mais en coupant court aux actions non conformes, et en mainte-
nant le fair-play sur le terrain.
Ce faisant, dans l’exercice de cette mission de maintien ou de restauration de l’anima-
tion concurrentielle des marchés – sur le mode répressif comme sur le mode préventif –
à destination des opérateurs économiques et des décideurs publics, il incombe au
régulateur indépendant d’expliquer inlassablement quels sont les bénéces de la
concurrence. En d’autres termes, c’est le rôle du régulateur de démontrer, non pas
seulement par argument d’autorité mais par la preuve, « à quoi sert la concurrence ».
Diffuser la culture de la concurrence :
Contexte, obstacles et succès
Cette mission de diffusion d’une culture de la concurrence ne va pas de soi, car à
l’endroit de la concurrence, le cœur des Français ne se gagne pas aisément !
Si de fait, chez nos voisins allemands, la régulation de la concurrence s’est, il y a plus
de cinquante ans, et pour des motifs d’ordre historique, imposée d’évidence et prati-
quement tout d’un bloc, sans que sa légitimité vienne à être contestée, en France, la
culture de la concurrence a procédé d’une construction graduelle et patiente, au long
de laquelle le Conseil puis l’Autorité de la concurrence n’ont eu de cesse de porter le
message des bénéces de la concurrence.
La France de l’après-Seconde Guerre mondiale s’est reconstruite sur l’idéal de la
protection assurée par l’État-providence. Le consensus politique qui s’est alors formé
a établi une plateforme de droits sociaux qui ont durablement façonné le référentiel
politique français, si bien que l’interventionnisme économique qui a accompagné cette
phase a pu nir par être perçu comme faisant partie intégrante de cet environnement
protecteur.
La réforme radicale introduite par l’ordonnance du 1
er
décembre 1986 a pu advenir
parce qu’elle s’est inscrite dans un contexte macroéconomique facilitant ce basculement
vers une économie de marché. Mais si une rupture franche a ainsi été marquée sur le
plan des institutions, l’environnement dans lequel le régulateur de la concurrence a eu
à déployer l’exercice de ses compétences est resté marqué par un doute sur les vertus
de la concurrence. Cette inquiétude a notamment pu prospérer sur le sentiment diffus
de l’atteinte à un certain « modèle français » causée par l’ouverture à la concurrence,
dans un jeu de rôle où les gouvernements français ont été parfois enclins à la désigner
comme une fatalité imposée par Bruxelles plutôt qu’à l’assumer et la promouvoir
comme une chance pour accroître le bien-être du consommateur.

714 À QUOI SERT LA CONCURRENCE ?
La culture de la concurrence : La démonstration par la preuve
Ce dernier n’est certes pas insensible aux avantages de la concurrence, ou du moins
consent à un mariage de raison. Un sondage conduit en 2011 à la demande de l’Auto-
rité observe ainsi que la concurrence évoque une notion positive pour 81 % des
personnes interrogées, non seulement quant à ses effets sur le choix des biens et services,
leur prix, leur qualité, mais également en tant qu’elle est un gage de compétitivité. Il
existe donc un indéniable progrès de la culture de la concurrence en France au cours
de la période récente. Cet attachement s’est par exemple manifesté à l’occasion du
récent débat sur la réglementation applicable respectivement aux taxis et aux véhicules
de tourisme avec chauffeur, au cours duquel, en dépit de la surface médiatique dont
dispose la profession de taxi, l’opinion s’est majoritairement rangée du côté des
nouveaux entrants, dans un contexte où les ruptures technologiques viennent au soutien
du mécanisme par lequel la concurrence rend du pouvoir aux consommateurs.
Cependant, si le consommateur est convaincu, pour le citoyen et le salarié, le cœur n’y
est pas. Les Français sont soucieux des effets de la concurrence à court terme sur le
tissu économique et, partant, sur l’emploi, et ce doute se retrouve chez les décideurs
publics, qui peuvent se déer de la dynamique concurrentielle. Celle-ci est par principe
disruptive des positions établies et, en recomposant de nouveaux équilibres, occasionne
une phase de transition qui peut être inconfortable, et dont il est naturel que les décideurs
politiques la redoutent comme facteur de mécontentement de l’opinion. En période de
crise, le mouvement ainsi imposé par le jeu concurrentiel peut susciter d’autant plus
de réticences que l’accompagnement budgétaire requis pour surmonter les rigidités
empêchant certains acteurs de tirer parti des nouvelles opportunités est restreint. Une
politique de concurrence est plus facile à mener en période de croissance, lorsque les
amortisseurs budgétaires sont mobilisables, mais il serait dangereux d’en déduire que
la concurrence ne « sert » que dans un contexte d’afuence, et que la régulation
concurrentielle doit s’effacer quand les indicateurs économiques sont à la peine. Ainsi,
non seulement il incombe continûment au régulateur concurrentiel d’exposer et de
prouver à quoi sert la concurrence, mais il lui appartient également de démontrer que
ses bénéces ne s’évanouissent pas en période de crise.
La concurrence, au service de tous, tout le temps
Si la mise en œuvre des règles de concurrence peut faire des gagnants et des perdants,
la concurrence n’a pas d’ennemi : tous les acteurs économiques ont à gagner à un jeu
concurrentiel ouvert et équitable. Le droit de la concurrence est d’abord un droit au
service de la compétitivité, en ce qu’il permet aux entreprises de jouer à armes égales,
si bien que les producteurs en tirent autant bénéce que les consommateurs.
Si en effet chacun se convainc aisément que les cartels sont dommageables pour les
consommateurs nals, ils sont également nuisibles à leurs auteurs, en geant leur
stratégie, agissant comme une désincitation à l’innovation et maintenant des prix
articiellement élevés qui, à terme, les pénalisent ; ils sont enn dommageables aux
autres entreprises, en augmentant le prix des produits intermédiaires et donc les coûts
de production pour les entreprises en aval, souvent des PME. De même, les entreprises

715
À QUOI SERT LA CONCURRENCE ?
Bruno Lasserre
sont les premières à souffrir des conséquences des abus de position dominante, qui
peuvent entraver l’entrée sur le marché d’acteurs innovants, ou brider le développement
des PME. C’est pourquoi le contrôle du respect des règles de concurrence ne peut être
relâché durant les périodes d’atonie économique, au motif que les entreprises auraient
besoin d’un environnement moins sévèrement concurrentiel pour maintenir leur
protabilité en ces temps difciles : leur capacité à tirer parti de la sortie de crise serait
anéantie si, dans l’intervalle, elles avaient été mises à l’abri de la pression concurren-
tielle, et l’on ne saurait décourager l’entrée de nouveaux acteurs innovants précisément
durant une phase où le dynamisme de l’activité fait défaut. Il a par exemple été
abondamment démontré que l’expérience américaine de mise en sommeil de la politique
de concurrence au cours des années 1930 durant la période dite du « New Deal »
(National Industrial Recovery Act de 1933) a eu pour effet de prolonger la crise, en
retardant les restructurations.
Des bénéces tangibles et mesurables,
fruit d’une action ciblée
Le premier outil dont dispose l’Autorité pour sauvegarder ou rétablir l’ordre public
économique, et ainsi soutenir la compétitivité, consiste en son pouvoir de sanction,
qu’elle dirige en priorité contre les pratiques les plus dommageables. L’Autorité a ainsi
poursuivi et sanctionné des ententes dans le secteur de la téléphonie mobile (2005) ou
celui des lessives (2011), qui ont eu un impact négatif direct sur le pouvoir d’achat des
consommateurs, mais également des cartels qui ont entraîné un surenchérissement des
coûts supportés par les entreprises, en particulier les PME, dans le secteur du travail
temporaire (2009), des commissions interbancaires (2010), ou des intrants de la lière
chimique (2013).
Pour démontrer à quoi sert la concurrence, il n’est guère de meilleur argument que
celui qui consiste à établir un chiffrage du surcoût généré par ces ententes. Il existe
une abondance d’études économiques visant à établir une estimation chiffrée du surprix
moyen associé à la mise en œuvre d’un cartel, un consensus semblant se dégager autour
d’un renchérissement moyen de l’ordre de 20 %, voire supérieur (v., par ex., J. Connor
et Y. Bolotova [2006], Cartel Overcharges: Survey and Meta-Analysis, International
Journal of Industrial Organization, 24, pp. 1109-1137, et J. Connor et R. Lande [2006],
The Size of Cartel Overcharges: Implications for U.S. and EU Fining Policies, Antitrust
Bulletin, 51, pp. 983-1022. V. égal. E. Combe et C. Monnier [2011], Fines Against
Hard Core Cartels in Europe: The Myth of Over Enforcement, Antitrust Bulletin, 56,
pp. 235-275, et E. Combe et C. Monnier [2012], Les cartels en Europe, une analyse
empirique, Revue française d’économie, vol. XXVII, octobre 2012). Ainsi, il a été
concrètement établi que le démantèlement du cartel de la signalisation routière (2010)
avait conduit à une chute des prix, alors que les pratiques d’entente sanctionnées, ayant
couvert l’ensemble du territoire national pendant près de dix ans, avaient affecté les
ressources publiques, au détriment des collectivités locales et de l’ensemble des
contribuables, du fait de la surévaluation articielle du montant des offres retenues. Il
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%