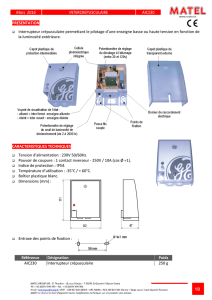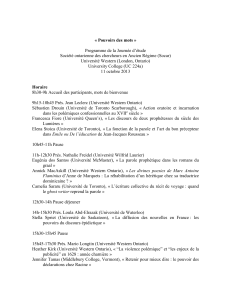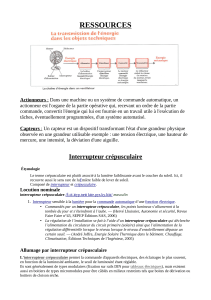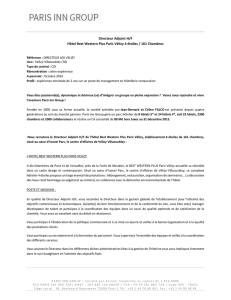Francois_Elodie_2013_memoire - Papyrus


Université de Montréal
Du western au crépusculaire :
textualités et narrativités du genre pour une approche de l'image-fin
par
Élodie François
Études cinématographiques
Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques
Faculté des arts et des sciences
Mémoire présenté à la Faculté des arts et des sciences
en vue de l'obtention du grade de maîtrise
en études cinématographiques
Avril 2013
© Élodie François 2013

i
Résumé
Notre étude porte le western crépusculaire et cherche plus précisément à extraire le « crépusculaire » du genre.
L'épithète « crépusculaire », héritée du vocabulaire critique des années 1960 et 1970, définit généralement un
nombre relativement restreint d'œuvres dont le récit met en scène des cowboys vieillissants dans un style qui
privilégie un réalisme esthétique et psychologique, fréquemment associé à un révisionnisme historique, voire au
« western pro-indien », mais qui se démarque par sa propension à filmer des protagonistes fatigués et dépassés
par la marche de l'Histoire. Par un détour sur les formes littéraires ayant comme contexte diégétique l’Ouest
américain (dime-novel et romans de la frontière), nous effectuons des allers et retours entre les formes épique et
romanesque, entre l’Histoire et son mythe, entre le littéraire et le filmique pour mieux saisir la relation dyadique
qu’entretient le western avec l’écriture, d’une part monumentale et d’autre part critique, de l’Histoire. Moins
intéressée à l’esthétique des images qu’aux aspects narratologiques du film pris comme texte, notre approche tire
profit des analyses littéraires pour remettre en cause les classifications étanches qui ont marqué l’évolution du
western cinématographique. Nous étudions, à partir des intuitions d’André Bazin au sujet du sur-western, les
modulations narratives du western ainsi que l’émergence d’une conscience critique à partir de ses héros mytho-
logiques (notamment le cow-boy). Notre approche est à la fois épistémologique et transhistorique en ce qu’elle
cherche à dégager du western crépusculaire un genre au-delà des genres, fondé sur une incitation à la narrativisa-
tion crépusculaire de la part du spectateur. Cette dernière, concentrée par une approche deleuzienne de l’image-
cristal, renvoie non plus seulement à une conception existentialiste du personnage dans l’Histoire, mais aussi à
une mise en relief pointue du hors-cadre du cinéma, moment de clairvoyance à la fois pragmatique et historicisant
que nous définissons comme une image-fin, une image chronogénétique relevant de la contemporanéité de ses
figures et de leurs auteurs.
Mots clés : western, western crépusculaire, dime-novel, historiographie, mythologies contemporaines,
philosophie et cinéma, Giorgio Agamben, Gilles Deleuze, Jean-Louis Leutrat, The Man Who Shot Liberty
Valance

ii
Abstract
Our study is centered on the “Twilight western” (western crépusculaire) and is more precisely concerned with the
“Twilight” aspect of the genre. The "Twilight" epithet, inherited from the French critical vocabulary of the 1960s
and 1970s, encompasses a relatively restrained number of works whose stories, often associated with revisionist
discourses, or as “pro-indian westerns”, are dedicated to aging cowboys with a style where aesthetical and psy-
chological realism is put forward in favor of showing how these tired protagonists feel outdated and outmarched
by History. By a turn on the literary forms that have for their diegetic background the American West (dime-
novels and novels more generally contextualized at the border), our research is structured by a back and forth
between the epic and romantic forms of narration, between History and its myths, and moreover between the
literary form and the filmic form for a better grasp of the dyadic relationship that the West entertain with its
writing of History, both with its more monumental and critical approaches. Less interested towards the aesthetic
of these “Twilight” images than the narratological aspects of the film considered as text, our approach is founded
on literary analysis to better challenge the classifications which have marked the evolution of the Western film.
Based on the intuitions of film critic André Bazin on the “sur-western” (high western), we study the narrative
modulations of the genre as much as the emergence of a critical awareness from its mythological heroes (mostly
the cowboy). Our approach is epistemological as it is transhistorical since it seeks to conceptualize “Twilight
western” as a genre beyond genres, not established on a collection of semantical observations, but on the incite-
ment of a twilight narrativization that emerges from the viewer. We concentrate this narrativization alongside the
deleuzian crystal-image as not only an existentialist conception of the western genre in regards to History, but
also as a highlighting of cinema’s “hors-cadre” (beyond-frame) perceived as an enlightenment that is both prag-
matic and historicizing. We define this precise kind of historiographical image as an “image-fin” (end-image), a
chronogenetic image axed on the contemporaneity of theses mythological figures and their authors.
Keywords: western, twilight western, dime-novel, historiography, contemporary mythologies, philosophy and
cinema, Giorgio Agamben, Gilles Deleuze, Jean-Louis Leutrat, The Man Who Shot Liberty Valance

iii
Table des matières
Introduction ........................................................................................................................ 1
Première partie ................................................................................................................... 8
1. Définitions ...................................................................................................................... 9
1.1 Du western en général .............................................................................................. 9
1.2 Du sur-western en particulier ................................................................................. 13
1.3 Vers une distinction : « l’action physique » et « l’action mentale » ....................... 20
2. Introduction à la littérature de l’Ouest ......................................................................... 23
2.1 Le dime novel ......................................................................................................... 26
2.2 Le roman de la frontière américaine ....................................................................... 31
3. Le western et le mythe .................................................................................................. 36
3.1 La création du mythe de l'Ouest ............................................................................. 39
3.2 Une approche de la démythification ....................................................................... 44
4. De l'histoire monumentale à l'histoire critique ............................................................. 47
5. De la grande à la petite forme ...................................................................................... 53
Deuxième partie ................................................................................................................... 61
1. Le western crépusculaire : définitions .......................................................................... 62
1.1 Le western crépusculaire : un sous-genre violent? ................................................. 65
1.2 Un retour à l'individualisme ................................................................................... 70
1.3 Catalogues et cognitivisme : la difficulté de traiter du genre ................................. 73
2. Approche sémio-pragmatique : vers la narrativisation crépusculaire .......................... 79
3. Déphasages ................................................................................................................... 91
4. Un cinéma crépusculaire .............................................................................................. 99
5. Approches de l'image-fin ............................................................................................ 102
Conclusion ...................................................................................................................... 110
Bibliographie .................................................................................................................. 116
Filmographie .................................................................................................................. 119
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
1
/
128
100%