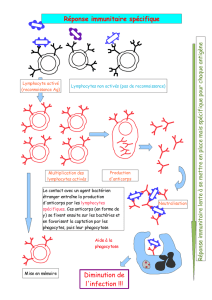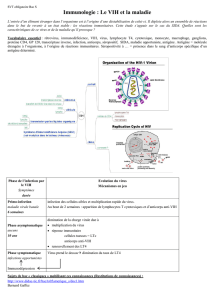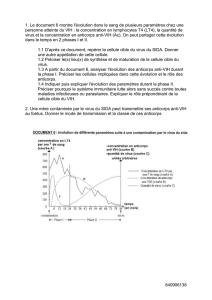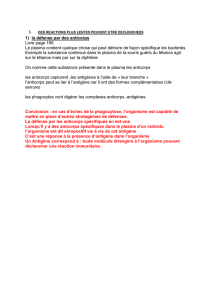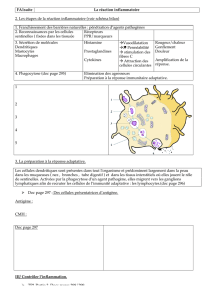Cliquez ici

SVT - TS
Activité I2
Les anticorps, agents de la réponse immune
adaptative
Corrigé
A
B
Objectifs de connaissance
Structure et spécificité des anticorps circulants
Objectifs de méthode
Recenser, extraire et exploiter des informations, y compris
expérimentales, sur les cellules et les molécules intervenant dans
l’immunité adaptative.
Concevoir et réaliser une expérience permettant de caractériser la
spécificité des molécules intervenant dans l’immunité adaptative.
• Madame Y. consulte le médecin suite à un ensemble de symptômes survenus très
brusquement : fièvre, céphalées, toux, douleurs musculaires et dans la gorge, fatigue et
perte d’appétit. Le médecin diagnostique une grippe et prescrit des anti-inflammatoires et
quelques jours d’arrêt de travail. Madame Y demande au médecin pourquoi il ne lui
prescrit pas d’antibiotiques. Le médecin lui répond que les antibiotiques empêchent les
bactéries de se multiplier, mais sont sans effet contre un virus comme le virus de la
grippe. En revanche, dit le médecin, « votre corps va fabriquer lui-même ses anticorps
pour se défendre ».
• Il s’agissait de préciser ce qu’est un anticorps, dans quelles conditions les anticorps sont
produits, et comment un anticorps peut permettre à l’organisme de se défendre contre un
virus.
Conditions(d’apparition(des(anticorps(dans(le(sang(
• Quelques jours après l’exposition à une substance étrangère à l’organisme, on remarque
une forte augmentation de la quantité de certaines protéines plasmatiques solubles : les
γ-globulines (document 1). Ces protéines sont des anticorps, dont la production a été
déclenchée par la substance étrangère. Donc, la production des anticorps est déclenchée
par une substance étrangère que notre système immunitaire est capable de détecter.
Cette substance joue le rôle d’antigène : un motif moléculaire (souvent présent sur un
agent pathogène tel qu’un virus, une bactérie…) capable de déclancher une réponse
adaptative.
Document 1. Deux lapins sont utilisés dans cette expérience. Le premier reçoit l’injection d’une
molécule étrangère, l’antigène (ce terme sera défini ultérieurement) et on injecte au second un
placebo. Dans cet exemple, l’antigène est une protéine bovine, la sérumalbumine bovine ou
SAB. Après quelques jours, les protéines plasmatiques de chaque lot sont séparées par
électrophorèse, une technique qui permet de séparer les protéines selon leur taille en les faisant
migrer dans un champ électrique. À la fin de l’électrophorèse, les protéines sont colorées et

SVT - TS
Activité I2
Les anticorps, agents de la réponse immune
adaptative
Corrigé
apparaissent sous la forme de bandes (A). L’intensité de la coloration des bandes peut être
quantifiée par ordinateur (B).
Première(propriété(des(anticorps(:(les(complexes(immuns(
• Les antigènes sont agglutinés par le sérum d’un individu à condition que celui-ci ait été
préalablement immunisé avec les mêmes antigènes. Cette agglutination est due à la
présence, dans le sérum de l’individu immunisé, d’anticorps capable de lier
spécifiquement l’antigène. L’étude plus détaillée de cette liaison montre que chaque
anticorps peut lier deux antigènes. Cela permet la formation d’assemblages moléculaires
de taille variable contenant plusieurs antigènes liés par un ou plusieurs anticorps : des
complexes immuns. Donc, les anticorps (protéines solubles) peuvent piéger les antigènes
qui ont provoqué leur production dans des complexes immuns.
Document 2.
Des lapins ont été immunisés contre un antigène (dans cet exemple, la SAB). Quelques jours plus tard, le sérum de
ces lapins a été prélevé. Une suspension d’antigènes couplés à des billes de latex a été déposée sur deux lames de
microscope. La première lame est le témoin (A). Dans la seconde lame (B), une goutte du sérum de lapin immunisé
contre la SAB a été ajoutée.
L’un éléments visibles sur la lame B appelés complexe immuns a été observé au microscope électronique (C-a).
L’antigène utilisé dans cette expérience (la SAB) est facilement reconnaissable sur le cliché. Un détail a été agrandi
(C-b).
(

SVT - TS
Activité I2
Les anticorps, agents de la réponse immune
adaptative
Corrigé
(
Seconde(propriété(des(anticorps(:(la(spécificité((
• Afin de déterminer si la liaison antigène-anticorps
est spécifique, on peut utiliser la méthode
d’immunoprécipitation ou test d’Ouchterlony.
• C’est une méthode d’immunodiffusion : les
antigènes à tester sont déposées dans les puits
creusés dans le gel, ainsi que le sérum contenant
les anticorps. Les antigènes et l’anticorps
diffusent de façon homogène dans toutes les
directions autour des puits. Deux auréoles de
diffusion peuvent donc entrer en contact
lorsqu’elles ont suffisamment progressé.
• Cette zone de contact reste invisible s’il n’y a pas de réaction entre les deux solutions.
Quand il y a réaction entre les solutions, il se forme un arc de précipitation visible à l’œil
nu. Celui-ci est dû à la formation de complexes immuns entre l’anticorps et le (ou les)
antigènes testé(s).
• Des arcs de précipitation apparaissent entre le puis central et le puits B contenant le
fragment moléculaire B du virus de la grippe. Cet arc est dû à la formation d’un complexe
immun entre les anticorps de Madame Y et cet antigène. Madame Y produit donc bien
des anticorps dirigés contre le virus de la grippe.
• Il n’y a pas d’arc de précipitation entre le puits central et les autres puits périphériques
incluant le témoin négatif. Donc, les anticorps produits par Madame Y reconnaissent
seulement le fragment moléculaire B du virus de la grippe et ne reconnaissent pas le
fragment O du même virus ni les fragments des autres virus. Cette expérience permet de
vérifier sur un exemple que la liaison des anticorps et des antigènes est très spécifique.
Puits¢ral&:&&
sérum&de&madame&Y&&
&
B&:&fragment&moléculaire&B&du&virus&de&la&grippe&&
&
O&:&fragment&moléculaire&O&du&virus&de&la&grippe&
&
L&:&fragments&moléculaires&du&virus&de&la&rougeole&
&
C&:&fragments&moléculaires&du&virus&de&la&varicelle&
&
E&:&eau&distillée&
&
Résultat& d’un& test& d’immunodiffusion& sur& gel& (test& d’Ouchterlony)& réalisé& sur& Madame& Y& afin& de&
vérifier&si&celle-ci&produit&des&anticorps&dirigés&contre&le&virus&de&la&rougeole&
B
O
L
C
E

SVT - TS
Activité I2
Les anticorps, agents de la réponse immune
adaptative
Corrigé
L’efficacité(des(anticorps(pour(lutter(contre(le(danger(associé(à(l’antigène(
• Dans les complexes immuns, l’antigène se trouve piégé (neutralisation) : il lui est plus
difficile d’entrer en contact avec les cellules de l’organisme, par exemple, dans le cas d’un
virus, il lui est plus difficile de se lier aux protéines membranaires des cellules cibles de
notre organisme pour les infecter.
• La mobilité de l’antigène piégé dans un complexe immun est réduite (agglutination), et il
est plus vite détecté par les phagocytes. De plus, l’anticorps fixé sur l’antigène augmente
l’efficacité de la phagocytose de cet antigène par les phagocytes et d’autres mécanismes
de destruction de l’antigène (opsonisation) :
• Chaque anticorps présente deux sites de liaisons à l’antigène parfois appelés sites
anticorps et un « fragment FC » qui est la partie constante de la protéine (voir activité I2).
1
/
4
100%