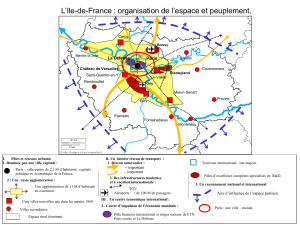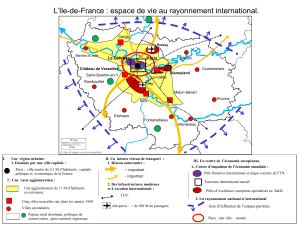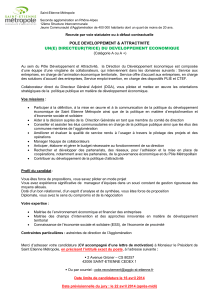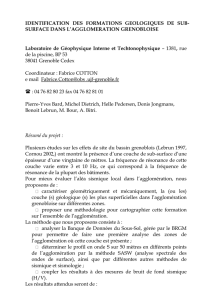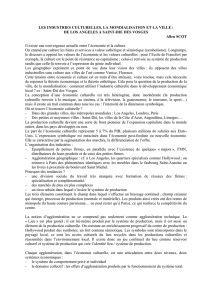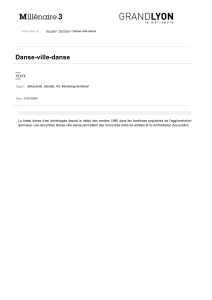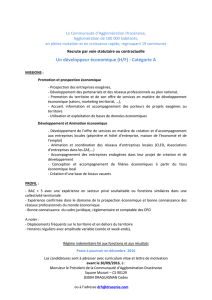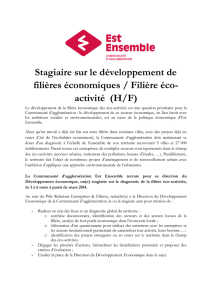1.4. Les économies d`agglomération

Economie géographique
Chapitre 1 – Les fondements de l’économie géographique : les déterminants de la
localisation des activités productives
1.1. La terre comme facteur de production et prix de la localisation : la rente foncière
Modèle de VON THÜNEN, Der Isolierte staat (1826)
Hypothèse :
- rationalité des acteurs, ie maximisation de leur revenu et rationalité des consommateurs, ie maximisation du prix
payé pour atteindre un certain niveau de satisfaction
- la plaine est homogène, sans accident géographique
- La ville est au centre de la plaine et est unique
- la fertilité des terres est identique en tout point sur la plaine et est unique
- les déplacements peuvent s’effectuer dans toutes les directions et les coûts de transport sont une fonction linéaire de
la distance et sont supportés par les agriculteurs/ producteurs qui vendent sur le marché
- la technologie de production d’un type de produit est la même pour toutes les fermes : taille d’exploitation
identique, mêmes coûts de production…
Modèle : les agriculteurs doivent transporter les denrées alimentaires produites de leurs terres jusqu’au marché en ville.
Ceux qui ont les terres les plus proches du marché ont les coûts de transport les plus faibles et ceux qui ont les terres les plus
éloignées, les coûts les plus élevés. Comme le prix de vente unitaire et les coûts de production (hors transport) sont
identiques pour tous les agriculteurs, ceux qui ont des terres proches du marché ont des gains plus élevés que ceux éloignés
du marché ; ces gains constituent des « rentes ». Par conséquent, chaque agriculteur à intérêt à avoir ses terres le proche du
marché possible pour augmenter ses rentes foncières. Néanmoins, face à une demande forte, le prix de ventes des terrains
augmente à mesure de leur proximité avec le marché. La rente obtenue, et donc la décision de la localisation d’une activité,
dépend du prix du sol, des coûts de production du prix de vente et, surtout, des coûts de transport. La décision de localisation
varie alors pour les différents biens qui ont des coûts de transport, des prix de vente et des coûts de production différents. Les
différentes production se répartissent autour de la ville en cercle concentrique (VT décrivait la répartition de 4 productions
différentes).
Intérêt :
- On peut par ex supposer que les producteurs de biens agricoles périssables (production maraîchères, lait…) sont
plus enclins à payer un prix élevé une rente foncière pour réduire le temps d’accès ; tandis que ceux qui produisent
des denrées facilement transportables, ou qui nécessitent de vastes pâturages (élevage de chevaux par exemple)
occupent les terres les plus éloignées.
- Ce modèle a été repris dans les années 1960 à travers la nouvelle économie urbaine pour expliquer la localisation
des ménages autour d’un centre-ville et la structure socio-spatiale des villes.
1.2. Localisation des facteurs de production et du marché
Modèle de WEBER, Uber den Standort der Industrën (1909)
Hypothèse du modèle :
- L’espace est une pleine homogène sans accident géographique
- L’emplacement des facteurs de production est fixé
- Le lieu du marché est fixé
- Quel que soit le prix du bien fixé on sait qu’il y aura une demande
- Les coûts de transport sont une fonction linéaire de la distance
- Les technologies de production sont fixes
Modèle : Avec l’industrialisation, les modèles de localisation ont quitté la question de la rente foncière liée à l’agriculture
pour s’intéresser à la localisation des entreprises industrielles ayant des facteurs de production dont l’offre est localisée tout
comme son marché. L’entreprise détermine son choix de localisation en fonction des ces différents coûts de transport que
WEBER appelle « poids » : les coûts de transports de la quantité nécessaire d’un premier facteur de production ; les coûts de
transport de la quantité nécessaire d’un second facteur de production ; les coûts de transport vers le marché d’une unité
produite. WEBER distingue le poids des facteurs de production (Pf) et le poids de la production finale (Pp). Soit le poids
d’indice matériel Im = Pf/Pp. Si Im > 1, alors il y a une « perte de poids » : Pf > Pp, la localisation est orientée vers les
ressources nécessaires à la production. Si Im< 1, alors il y a « un gain de poids ». Pf<Pp, la localisation de l’activité est

orientée vers le marché. L’objectif est de minimiser le coût de production total. Ce modèle permet de comprendre pourquoi
les entreprises qui ont des coûts de transport élevés pour le produit final se rapprochent du marché (ex les biens périssables).
WEBER a aussi étendu son modèle au marché du travail. Il considère que les travailleurs sont concentrés en certains lieux.
Or, lorsque l’entreprise s’implante dans ces lieux, cela lui procure un « gain ». Elle doit alors comparer ce gain aux coûts de
transport des facteurs de production et du bien produit et l’arbitrage final dépendra de ces coûts respectifs.
Intérêt :
- ce modèle s’inscrit dans la continuité du modèle de VT par la mise en avant des coûts de transport, mais le
complète en démultipliant des facteurs de production et leur localisation. Il abandonne le lien à la terre et au foncier,
seul facteur de production chez VT.
- Dans sa version plus complexe où WEBER inclut le marché du travail, ce modèle permet d’expliquer la
délocalisation dans les PED de certaines entreprises ayant une forte demande en travail non qualifié et des coûts de
transport faible. Ex : textile.
Limite :
- il ne prend pas en compte les éventuelles économies d’échelle et les externalités d’agglomération
- il n’intègre pas non la concurrence que peuvent se faire les entreprises pour se partager un marché.
1.3. La concurrence spatiale et les aires de marché
Un modèle simple : le modèle d’HOTELLING, « stability in competition » (1929)
Hypothèse : deux vendeurs dont la localisation et les aires de marché respectives sont déterminées ; les biens vendus sont de
qualité identique et ont le même prix ; les consommateurs supportent le coût de transport qui est proportionnel à la distance
parcourue pour acheter le bien.
Pour illustrer ce modèle, on prend souvent l’ex de deux marchands de glaces A et B. Supposons une première situation où A
est à l’extrémité d’une place et B à côté. Le producteur A a intérêt à se rapprocher de B afin d’avoir accès à un plus grand
marché. Mais B peut faire la même chose jusqu’à passer de l’autre côté A pour avoir accès à un plus grand marché et ainsi de
suite. Après plusieurs itérations, on arrive à une situation où les deux vendeurs sont localisés près du milieu, l’un desservant
le côté gauche, l’autre le côté droit. Il s’agit d’un équilibre stable : chaque marchand a une moitié de plage, et s'il se déplace
légèrement d'un côté ou de l'autre, il verra sa zone décroître au profit de son concurrent (ci-dessous, droite, le vendeur rouge
se déplace vers la gauche). C'est l'équilibre de Nash de ce jeu. Cet équilibre n’est pas Pareto-optimal pour les consommateurs
puisque les coûts de transport supportés par les ménages, la distance à parcourir n’est pas minimisée. Elle le serait si chaque
producteur était au milieu de son aire de marché.
L’intérêt de ce modèle est que la localisation induit une différence entre les biens. Pour un consommateur qui supporte des
coûts de transport ou de déplacement, deux biens sont homogènes sont en effet différents s’ils ne sont pas proposés au même
endroit. On parle de « différenciation avec adresse ».
Ce modèle a été affiné par D’ASPREMONT, GABSZEWICZ, THISSE, dans « On Hotelling's Stability in
Competition » (1979) : si on introduit une concurrence par les prix, sauf s’ils s’entendent pour maintenir un niveau de prix
élevé, les deux vendeurs vont s’engager dans une guerre des prix. Les deux producteurs ont donc intérêt à s’éloigner l’un de
l’autre. L’existence de coûts de transport permet en effet d’atténuer la concurrence puisque chaque acheteur prend sa
décision en fonction du prix d’achat affiché par chaque marchand mais aussi du coût du déplacement. Cette différenciation
spatiale restaure une marge de manœuvre pour les marchands qui disposent d’une latitude dans la détermination des prix.
1.4. Les économies d’agglomération
Dans un article de 1993 « On the Number of Location of Cities », KRUGMAN distingue deux explications aux disparités
spatiales de développement économique :
- les causes de « première nature » : il s’agit de l’ensemble des différences de dotations en ressources naturelles ou
en facteurs de production ou en capacité d’échange (ville côtière…). Ces causes sont exogènes de concentration
économique sont exogènes.
- Les causes de « seconde nature » : elles sont endogènes au développement économique car elles ont la particularité
d’être à la fois causes et conséquences de l’agglomération des activités économiques en raison du processus
cumulatif de développement qu’elles entrainent. On parle d’économies d’agglomération.
MARSHALL dans Principles of economics (1890) décline trois types d’économie d’agglomération :
- l’ampleur et la taille du marché du travail
- la taille de la demande qui s’adresse aux entreprises qu’elle émane des consommateurs ou d’autres entreprises (en
amont ou aval du processus de production)

- l’échange d’informations et de connaissances qui constituent une technologie de connaissances. Ces externalités de
connaissances se fondent sur deux mécanismes : les salariés des diverses entreprises communiquent entre eux ; la
mobilité entre entreprises de la partie de la main d’œuvre la plus performante constitue un transfert de
connaissances.
Autre catégorisation des éco d’agglo :
- les économies de localisation : elles sont liées à la proximité entre les entreprises du même secteur. Elles
proviennent de la présence d’une main d’œuvre, de savoirs-faire, d’innovations. MARSHALL parlait d’ « industry
in the air » (= atmosphère industrielle).
- Les économies d’urbanisation : elles découlent de la présence d’une plus grande quantité et diversité de main
d’œuvre, de savoirs-faire, de biens intermédiaires et d’innovations. Ce sont les relations possibles entre différents
secteurs et la diversité tant des biens que des facteurs qui jouent : mise en commun de biens collectifs, liens entre
clients-fournisseurs,
MYRDAL (Economic theory and underdeveloped regions, 1957) décrit le processus de développement localisé par une
relation de «causalité circulaire et cumulative». Le développement d’une région est enclenché par une condition
géographique ou historique particulière. On est ici proche du concept de cause de première nature de KRUGMAN (1993).
Les salaires réels et les rendements du capital sont plus élevés dans cette région qui va ainsi attirer de nouveaux facteurs de
production. La concentration de 1’activité économique dans une région va conduire à des rendements d’échelle croissants, en
raison de l’accumulation importante des connaissances et des savoir- faire issus de la forte concentration géographique. La
présence de ces rendements croissants va alimenter l’écart de productivité des facteurs. Un cercle “vertueux” de
développement est ainsi enclenché. Les différences initiales de technologie peuvent donc conduire à un développement
irrémédiablement inégal des régions.
Pour HIRSHMAN (1958), ce sont les «effets d’entraînements amont et aval» qui conduisent à un développement inégal
des régions. Les liens, par le jeu des demandes, entre les différents secteurs, conduisent les entreprises à s’agglomérer afin de
minimiser les coûts de transport. Ici, c’est une réactualisation du modèle de Weber, avec une généralisation à plusieurs
entreprises et industries, que l’on observe. L’agglomération des activités alimente alors le processus auto-entretenu de
développement.
PERROUX (« Note sur la notion de pôle de croissance », in Economie Appliquée, 1955) insiste sur le rôle de 1’innovation
pour expliquer la formation de «pôles de croissance » dans l’espace et s’inscrit dans la tradition schumpeterienne de
l’analyse du développement. La nécessité d’une taille critique pour innover et le coût de diffusion relativement élevé des
technologies entraînent une agglomération des industries pouvant bénéficier de ces innovations. Les pôles connaissent alors
une croissance auto-entretenue par la dynamique technologique. Les innovations effectuées dans 1’agglomération se
diffusent ensuite, à des vitesses variables, vers les industries localisées dans les espaces sous 1’influence des pôles de
croissance. Mais ces espaces environnants sont dépendants des pôles, ils ne peuvent être à l’origine du développement
régional qui passe par une concentration d’activités suffisante pour impulser la croissance de la région tout entière
AYDALOT, Dynamique spatiale et développement inégal (1976) s’est consacré, quant à lui, plus spécifiquement à
l’étude du marché du travail et a construit une théorie de la «division spatiale du travail». La formation et les savoir-faire de
la main-d’œuvre sont les piliers de cette théorie. La production de certains biens nécessite des savoir-faire spécifiques et/ou
une formation particulière. Ces inputs étant concentrés en ville, les entreprises appartenant aux secteurs pour lesquels ce type
de formation est déterminant vont s’y localiser. Il s’agit des secteurs les plus dynamiques et dont les entreprises sont prêtes à
rémunérer la main-d’œuvre en conséquence de sa formation. Les entreprises n’ayant pas à faire appel à ce type de main-
d’œuvre se localisent dans les régions périphériques. Les activités économiques sont donc distribuées dans l’espace en
fonction de leur niveau de technologie. Les industries de transformation sont localisées dans les espaces de faible densité, où
la main-d’œuvre est peu qualifiée mais bon marché. Les industries nécessitant une main-d’œuvre qualifiée, porteuse de
développement économique, sont localisées dans les agglomérations.

Chapitre 2 – les logiques de l’agglomération
1. Introduction
L’agglomération constitue un phénomène ancien et général : (i) La population des plus grandes villes croît régulièrement,
pour passer le seuil du million à la fin du premier millénaire (Bagdad) ; (ii) concentration des activités se fait au niveau
mondial : par exemple, en l’an 1000, l’Asie représente les deux tiers du PIB mondial.
Une urbanisation inédite : Au niveau mondial, le taux d’urbanisation a dépassé les 50 % depuis 2005. La moitié du PIB
mondial se concentre dans la Triade et sur seulement 1,5 % des terres émergées.
Centre d’agglomération peuvent varier : L’Asie représentait les deux tiers du PIB mondial en l’an 1000, l’Europe et ses
dépendances plus de 50% au début du XXe siècle.
Plusieurs questions se posent :
- Pourquoi les activités et les populations s’agglomèrent (les forces centripètes)
- Quels sont les gains individus et collectifs à l’agglomération ?
- Quelles en sont les limites ? (forces centrifuges)
2. Le rôle du hasard ?
La loi de l’agglomération, la loi de Zipf (1935), ne s’explique que par une distribution aléatoire. Si l’on prend un système
urbain, la taille de la ville de rang N est 1/N de celle de la première ville. La loi de Zipf s’explique extrêmement bien la loi de
Gibrat (1931) : on considère un ensemble de villes, le taux de croissance de chaque ville suit la même loi de probabilité
quelle que soit sa taille et sa population. Il n’y a aucun facteur – autres que purement aléatoires – qui pourrait déterminer le
taux de croissance de chaque ville. En définitive, l’aléa ne dépend pas de la population de la ville.
Statistiquement, la répartition spatiale réelle des activités n’apparaît pas totalement aléatoire : DURANTON et OVERMAN
(« Testing for Localization Using Micro-Geographic Data », 2005) ont pris très au sérieux cette hypothèse et ont essayé de
l’appliquer au secteur industriel anglais en 1996. Pour chaque secteur industriel, ils regardent si la distribution est probable
ou pas.
- Dans la moitié des secteurs industriels considérés, la distribution et la répartition réelle du secteur industriel réelle
ont moins de 5 % de chances d’être complétement aléatoires.
- L’autre moitié des secteurs industriels a plus de 5 % de chances d’être distribuée de manière aléatoire. Autrement
dit, la distribution géographique réelle de ces secteurs a moins de 5 % de chances d’apparaître de manière aléatoire.
Ainsi, si le hasard a potentiellement un rôle important car la moitié des secteurs industriels pourrait s’expliquer par une
probabilité industrielle a plus de 5 %, il n’explique pas tout. On voit donc que les forces d’agglomération n’ont pas toutes le
même impact sur le secteur économique. Cette dimension de choix révèle que les individus et les activités préfèrent
s’agglomérer dans les endroits déjà agglomérés. Les agents économiques font des choix qui ne se font pas au hasard,
puisqu’ils se dirigent vers les lieux où l’agglomération est la plus élevée. Attention, la loi de Zipf (1935) peut être expliquée
par une distribution aléatoire mais cela ne signifie pas pour autant que c’est le hasard qui l’explique entièrement.
DAVIS et WEINSTEIN (Bones, bombs and break points : the geography of economic activity, 2002) ont mené une étude
sur les villes allemandes et japonaises (Hiroshima et Nagasaki) d’après-guerre. Si la loi de Zipf est vérifiée, les villes
japonaises doivent présenter des taux de croissance indépendants de leur taille et donc de leurs valeurs passées. En cas
d’hystérèse des chocs, occasionnant des changements de trajectoires et d’équilibre, les taux de croissance antérieurs et
postérieurs doivent être positivement corrélés. Jusqu’en 1945, les deux villes japonaises connaissent des dynamiques de
croissance relativement linéaires. En 1945, suite aux bombardements nucléaires, la population décroit fortement. Pourtant,
après la guerre, les villes reviennent sur leur taux de croissance de LT. L’urbanisation n’est donc pas un phénomène
aléatoire : il n’existe en effet aucune raison pour que ces deux villes retournent à leur tendance de croissance de LT. Les
avantages de première nature joueraient pour les deux auteurs un rôle décisif dans l’explication de ce phénomène de
rattrapage.
3 – Les forces de dispersion
Le théorème d’impossibilité spatiale, STARRETT (1978) : si on considère une économie avec un nombre fini de lieux et
d’agents, si l’espace est homogène (= the production set of a firm is the same in all locations and + con- sumers’ preferences
are the same at all locations), si les préférences ne sont pas localement à satiété et si on est dans un cadre de CPP, alors à ce
moment, à partir du moment où on introduit des coûts de transport, il n’existe aucun équilibre avec de l’échange. Autrement
dit, si on introduit l’espace dans un équilibre de marché compétitif (cadre de CPP), il n’y a pas d’échanges. On a intérêt à
produire nous-même ce dont on a besoin pour notre consommation. Ce faisant, nous n’avons pas à aller chercher ce bien
ailleurs, en payant par là-même des coûts de transport. On devrait donc se trouver dans un « capitalisme d’arrière-cour »
(backyard capitalism) où chacun produit dans son arrière-cour.

De nombreuses forces centrifuges (= forces de dispersion) :
1) Pression sur des ressources spatiales rares. La proximité avec les autres peut être coûteuse. Certaines ressources
spatiales sont rares et si l’on se retrouve tous au même endroit, cela crée une pression sur celles-ci. Ex : rente
foncière (cf modèle de VT) Dans cette optique, les agents préfèrent donc s’installer dans un endroit où il n’y a
personne.
2) Coûts de transport internes à l’agglomération. Quand l’agglomération grandit, cela est plus compliqué de se
déplacer à l’intérieur même de l’espace aggloméré. Le coût est ici créé par la surface des agglomérations, en termes
d’argent et de temps.
3) Externalités négatives et congestion. Les infrastructures d’une agglomération peuvent être congestionnées (métro
surbooké…).
4) Force potentiellement centrifuge de la concurrence en prix. D’ASPREMONT, GABSZEWICZ, THISSE, dans
« On Hotelling's Stability in Competition » (1979) ont montré, en réinterprétant le modèle de Hotteling, qu’en cas
de concurrence en prix, les entreprises ont plutôt tendance à s’éloigner.
Il existe donc un ensemble de forces centrifuges à l’agglomération, qui poussent à la dispersion des individus et des
activités.
4 – Les forces d’agglomération
Nous sommes, pour saisir les forces d’agglomération, obligés sortir du cadre de CPP promu par Arrow et Debreu et dans
lequel s’inscrit le théorème d’impossibilité. On introduit l’hétérogénéité de l’espace, des externalités, les rendements
croissants et les comportements stratégiques.
A – Les causes de l’hétérogénéité de l’espace
- Les causes de première nature (causes exogènes) : contexte naturel (caractéristiques physiques, géopolitiques,
climatiques…). Certains endroits sont plus propices que d’autres à la vie et aux activités humaines. On peut penser
à l’Antarctique et à l’Eurasie, vides d’hommes. Deuxièmement, certaines activités dépendent des caractéristiques
physiques, à l’image de l’agriculture et des activités du secteur primaire. Troisièmement, les individus peuvent
préférer les aménités, les caractéristiques de certains endroits. Par exemple, Sophia Antipolis a été installé près de
Nice. Enfin, le contexte géographique a des conséquences directes sur la mobilité et les coûts de transport.
Ex : MELLINGER, SACHS, GALLUP « Climate, costal proximity and development » (2003) : les zones
tempérées côtières représentent 8% de la surface terrestre, 23% regroupe 23% de la population mondiale et
correspondent à 53% du PIB mondial. La création de richesses est 18 fois plus importante dans ces zones que dans
les zones non-tempérées éloignées des côtes.
Néanmoins, l’influence des causes de première nature mérite d’être relativisé : ELLISON et GLAESER (« The
Geographic Concentration of Industry : Does Natural Advantage Explain Agglomeration ? » 1999) : Les «
avantages naturels » n’expliquent que 20% environ de la localisation de l’industrie américaine.
- Les causes de seconde nature (causes endogènes) : ce sont des éléments du contexte d’un lieu qui sont déjà des
constructions humaines : institutions, infrastructures, agglomération. Ces éléments sont donc endogènes à
l’agglomération :
Le rôle des institutions : Selon NORTH (« Institutions », 1991), « les institutions sont des
contraintes créées par les hommes qui structurent les interactions politiques, économiques et
sociales ». Elles recouvrent des groupes humains, et donc, le plus souvent, des espaces, sur lesquels
elles ont deux conséquences essentielles : elles les différencient, elles les séparent (effet
d’hétérogénéité), du fait notamment des frontières (effet de distance).
L’effet des frontières : Les coûts de transport et de mobilité sont largement d’origine humaine.
Directement, du fait des frontières, indirectement, du fait des différences des « règles du jeu » entre
espaces. On observe une tendance à l’amenuisement des frontières mais cette tendance n’est pas
linéaire historiquement. De même, elle a relativement peu touché le travail.
Institutions et dynamisme d’un espace : Les institutions sont également responsables du
dynamisme comparé des différents espaces, et donc de l’agglomération qui va y prendre place. (i)
Les institutions peuvent être endogènes au développement : CACERES-DUTERTRE (« Un district
vigoureux dans une économie en détresse : Le miracle Gamarra » 2001) a montré l’importance de la
culture locale pour le succès d’un « district industriel » comme celui de Gamarra, au Pérou. La
culture locale crée ici des incitations, favorables ou non au développement local. Les habitants de
Gamarra ont l’impression de partager une culture collective. Le développement est ici
principalement endogène, car il est promu par les habitants de Gamarra : les outsiders ne sont pas les
bienvenus. (ii) les institutions peuvent être exogènes au développement : de SAXENIAN
(« Regional Advantage : Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 » 1996), qui
insiste sur le rôle des institutions dans le succès de la Silicon Valley par rapport à la Route 128. Les
règles institutionnelles qui prévalaient dans la Silicon Valley, du fait de la culture managériale,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%