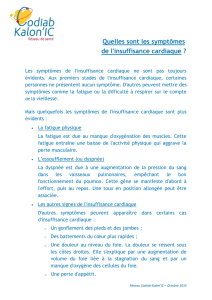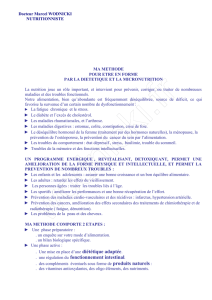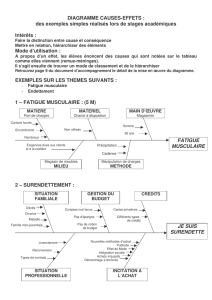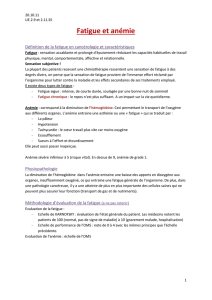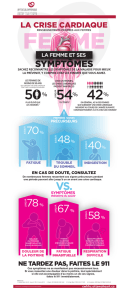9 Rencontres Scientifiques es

Cette fin de siècle se distingue par une ap-
proche particulièrement aiguë de l’aspect
social dans les soins dispensés aux malades.
Ainsi, le Dr Xavier Emmanuelli, an-
cien ministre et président-fondateur
du Samu social de Paris, tient à rap-
peler le rôle spécifiquement infirmier
face aux situations de précarité et
d’exclusion. «Il faut “généraliser” la
prise en charge des exclus. Or ce sont les
infirmières qui sont ici aux avant-postes. Malheu-
reusement, elles sont bien souvent démunies devant
la fragilité des psychismes qu’engendrent les situa-
tions d’exclusion et de précarité. A l’avenir, ce sont
pourtant elles qui devront faire le diagnostic et l’ac-
compagnement. Sur ce plan-là, je suis très optimiste
pour votre profession qui a un véritable rôle d’ac-
teur de santé publique ». La prise en charge mé-
dico-sociale intervient dans un contexte qui va
dans le sens de l’histoire : les soins sont mobili-
sést autour d’une personne malade. Cette prise
en charge s’appuie donc tout naturellement vers
cette autre forme de soins : les réseaux.
Le Dr Pierre Larcher, de la direction générale de
la Santé, lève la confusion qui entoure la défini-
tion de réseau. «Pour durer et se développer, un
réseau doit obéir à certaines règles, en particulier
celle d’encourager la capacité permanente d’initia-
tive de chacun de ses membres. L’infirmière en mi-
lieu rural, par exemple, voit à l’évidence mieux que
le chef de service du CHU le patient vivre sa douleur
à son domicile. Il n’en reste pas moins, concède-t-
il, qu’un réseau quel qu’il soit, suppose le volonta-
riat de tous les participants pour accepter un travail
supplémentaire exigeant, auquel leur formation ne
les a pas nécessairement préparés ».
17
●●●
9es Rencontres
Scientifiques
et Techniques infirmières
Compte rendu
Des formes de soins
qui font évoluer
la profession
L’évolution de la profession trouve un écho
particulièrement concret dans les deux formes
de soins qui marquent cette fin de siècle : les soins
médico-sociaux et les soins en réseau.
Sommaire
Cancérologie
Douleur
Anesthésie
Hygiène
Violence
en institution
Traitement
de substitution
Troubles
des conduites
alimentaires
Plaies et cicatrisations
Bilan urodynamique
Ont participé
à ce dossier :
Ludmilla Couturier,
Isabelle Forestier
et Stéphane Henri.

18
Spécial RSTI
Réseaux : le coup de pouce de l’État
A l’heure actuelle, ce sont les réseaux par pa-
thologies rares ou dont la connaissance évolue
très vite qui sont en plein développement. Il
s’agit en fait de réseaux centrés sur les profes-
sionnels de terrain à qui ils apportent référence
scientifique et formation. C’est le cas des ré-
seaux douleur, soins palliatifs, cancer,
hépatite C, mais aussi diabète, ostéoporose,
maladie d’Alzheimer, ou encore maladies rares
comme la neurofibromatose ou l’échinococcose
alvéolaire. «Ces réseaux ont vocation à s’articuler
sur les réseaux de proximité, très liés aux patients
et à la complexité de leur problématique, pour leur
apporter des outils complémentaires, souligne le
Dr Pierre Larcher. Ils sont donc tout à fait supplé-
mentaires. Ils obéissent aux mêmes règles, ensei-
gnées par l’expérience : la nécessité d’un père fon-
dateur, le volontariat, la complémentarité des
compétences, la légitimation par au moins une
institution sous forme de financement ou d’aide en
nature, l’esprit d’initiative de chaque acteur du
réseau : l’infirmière libérale, par exemple, voit le
patient vivre son alimentation ou sa douleur à son
domicile, et peut suggérer des modifications de
prise en charge qu’un “bouclage” du réseau venu
du haut pourrait, si on n’y prenait garde, rendre
impossible».
A ces conditions, auxquelles on ne peut déroger
sans risque, s’ajoutent des outils que l’on re-
trouve dans tous les réseaux solides et efficaces.
Parmi eux, l’évaluation est, avec la formation,
probablement le plus important. Pourtant, elle
est en général le parent pauvre. «Nous nous
sommes aperçus, reprend le Dr Larcher, que
c’était le moyen privilégié pour accélérer la matura-
tion naturelle des membres d’un réseau, en leur
permettant de prendre du recul par rapport aux
préoccupations quotidiennes, et donc de maîtriser
leur démarche. Il ne faut évidemment pas que ce soit
une évaluation externe, mais une auto-évaluation,
accompagnée et continue, pour ne pas faire marcher
le réseau par à-coups ». Or, on constate aujour-
d’hui que la maturation des professionnels
appartenant à un réseau s’effectue sur un temps
assez long. Avant de devenir un réseau complet
en pleine harmonie avec son public, un réseau
de proximité a, en effet, besoin au mieux de 5 à
7ans, au pire de 15 ans, et c’est l’évaluation qui
permet de faire la différence.
Face à ce constat, les exigences de l’État visent
à un développement aussi rapide que possible
parallèlement à une qualité tout aussi élevée.
Elles consistent essentiellement à formaliser ce
qui doit l’être (obligation d’un statut juridique,
obligation d’une charte, identification des res-
ponsables de chacune des grandes fonctions du
réseau pour être sûr qu’elles ne seront pas ou-
bliées), en préservant souplesse et adaptabilité
pour tout le reste.
En contrepartie de ces exigences, l’État assurera
un soutien méthodologique en mettant à dispo-
sition un guide de développement fondé sur
l’expérience des plus anciens, des formations
validées qui vont faire l’objet de décisions ré-
glementaires, et un guide de suivi-évaluation
commandé à l’ANAES à partir des “principes
d’évaluation des réseaux de santé” récemment
publiés. Sur le plan financier enfin, le Fonds
d’Aide à la Qualité des Soins de Ville (FAQSV),
doté cette année de 500 millions de francs, de-
vrait répondre à une large part des besoins. ■
●●●

19
Les normes de qualité et les démarches
d’évaluation aujourd’hui en cours dans les
hôpitaux amènent tout naturellement les soi-
gnants à se pencher sur des sujets jusqu’à
maintenant peu étudiés. Il en est ainsi de la
qualité de vie, qui fait actuellement l’objet de
multiples recherches, dans le secteur de l’onco-
logie notamment.
Il n’existe pas de définition précise de la qualité
de vie d’un patient. Celle de l’Organisation
mondiale de la santé reste trop évasive pour ser-
vir de référence. «La qualité de vie est multifacto-
rielle. Il importe de pouvoir la quantifier afin que la
notion de qualité de vie soit un élément comparatif
entre différents traitements », estime le Dr Xavier
Pivot, du centre anticancéreux de Lacassagne à
Nice. Au nombre des facteurs quantifiables, le
médecin retient le bien-être physique, l’état psy-
chologique du sujet, ses capacités à faire face à
la maladie, l’inconfort somatique induit par la
toxicité des médicaments, les symptômes et
l’évolution de la douleur, et les problèmes rela-
tionnels du patient dans son environnement.
Premières constatations
L’évaluation de la qualité de vie s’appuie, ou de-
vrait s’appuyer, sur des outils pour être quanti-
fiable. Les méthodes psychométriques exis-
tantes, avec échelles analogiques, permettent
l’évaluation de la douleur, du confort, de la fa-
tigue, de l’appétit... mais pas de la qualité de vie.
Plusieurs questionnaires existent, validés par le
Comité européen d’évaluation de la qualité de
vie, créé en 1986. Il en résulte des approches
partielles. Y recourir permet cependant de com-
prendre les causes de la détérioration de la qua-
lité de vie d’un patient et de justifier la prescrip-
tion de certains médicaments. «La prescription
de certains médicaments répondant à une plainte
spécifique a permis de mettre en exergue des élé-
ments insoupçonnés, malgré toutes les études scien-
tifiques effectuées dans ce domaine, indique le
Dr Xavier Pivot. Ainsi, les femmes traitées en can-
cérologie citent l’insomnie comme premier impact
négatif. Puis elles mettent en avant les syndromes
ménopausiques et le catastrophisme. Or ces trois
symptômes sont synonymes de fatigue. Aussi la
détérioration ou l’amélioration de la qualité de vie
en cancérologie est-elle, peut-être, en corrélation
directe avec la détérioration ou l’amélioration de
l’état de fatigue des patients [...] », suggère-t-il.
La fatigue, facteur déterminant
Dans les services d’oncologie, la fatigue des pa-
tients présente un caractère de fatalité lié à la
maladie et à ses traitements. En effet, la
Cancérologie
Quand la qualité de vie
devient un objectif du soin
L’heure est à la qualité de vie, qu’il est essentiel de préserver parce qu’un
patient qui voit celle-ci amoindrie perd ses facultés de résistance à la
maladie, d’acceptation des soins, et son envie de vivre. En oncologie
notamment, la première plainte concerne la fatigue dont la prise
en charge s’avère la première étape de l’amélioration de la qualité de vie.
●●●

20
Spécial RSTI
fatigue est le plus commun des symptômes
du cancer, devant la douleur et l’anorexie. Elle
existe chez environ 70 % des patients traités par
radiothérapie, et chez 90 % de ceux traités par
chimiothérapie. Face à ce phénomène, les soi-
gnants se sentent souvent impuissants. Pour-
tant, depuis le début de l’année 1996, on assiste
à une mobilisation européenne des profession-
nels de santé contre la fatigue en cancérologie.
Si elle est entendue, la fatigue peut et doit être
évaluée et prise en charge par le biais de moyens
d’action divers, parfois extrêmement simples.
Des formations spécifiques sur ce sujet se déve-
loppent et aident un plus grand nombre de soi-
gnants à bénéficier de connaissances et d’outils,
certes encore disparates. Petit à petit, il devient
évident que l’amélioration de l’état de fatigue du
patient intègre une forme de qualité des soins
dont l’influence sur la qualité de vie du malade
est conséquente.
La preuve par l’exemple
Infirmières et infirmier au centre anticancéreux
de Lacassagne à Nice, Magali Genoud, Carole
Marrot et Christophe Mornat ont travaillé à un
questionnaire sur la qualité de vie des patients,
essentiellement orienté vers le thème de la fa-
tigue. «Notre objectif était d’apprécier la relation
qui peut exister entre un questionnaire sur la qualité
de vie et une échelle visuelle analogique de la fa-
tigue », explique Magali Genoud.
Le questionnaire comporte 24 items notés de 1
à 4, un total de 86 points représentant l’altéra-
tion la plus élevée de la qualité de vie. L’échelle
visuelle analogique est classiquement graduée
de 0 à 10. Au total, 54 patients (46 hommes,
8femmes, âge médian de 60 ans), traités par des
chimiothérapies contenant des dérivés de pla-
tine, sont inclus dans l’étude. Pour 37 d’entre
eux, l’enquête est réalisée au cours de deux
cures différentes.
Les résultats sont sans équivoque : les scores
obtenus par le questionnaire et par l’échelle vi-
suelle analogique sont arithmétiquement simi-
laires. Tous les patients interrogés au deuxième
cycle de leur traitement se disent plus fatigués et
font valoir, via le questionnaire, une plus grande
détérioration de leur qualité de vie.
«Bien que cette étude ait été menée sur un petit
nombre de patients, nous avons été frappés par l’ho-
mogénéité des résultats, indique Magali Genoud.
Nous pensons sincèrement que la mesure de la qua-
lité de vie d’un patient par un questionnaire est à
l’identique de la seule utilisation de l’échelle visuelle
analogique de la fatigue ».
L’anémie, grande pourvoyeuse de fatigue
Une fois entendue et évaluée, la fatigue du pa-
tient doit être prise en charge. «Mais, puisqu’elle
est multifactorielle, la prise en charge doit l’être
aussi, rappelle le Dr Laure Chauvenet, onco-
logue à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu à Paris. Devant
toute fatigue, il faut rechercher une anémie, des
troubles métaboliques, des causes endocriniennes,
des causes psychologiques, et s’interroger sur une
possible évolution de la maladie, et sur les répercus-
sions des traitements ».
L’anémie est, bien entendu, une des causes les
plus fréquentes de fatigue ou, tout au moins,
une de ses composantes essentielles. Elle se dé-
finit par un taux d’hémoglobine inférieur à
11 g/dl chez la femme et 12 g/dl chez l’homme.
«Le plus important à considérer n’est pas unique-
ment ce taux classiquement défini, fait remarquer
le Dr Laure Chauvenet. Si un patient présente un
taux normal d’hémoglobine à 15 g/dl, le passage à
12 g/dl signifie, dans son cas, une vraie anémie,
donc l’installation d’une vraie fatigue ».
Les symptômes de l’anémie sont la pâleur, des
palpitations cardiaques, une asthénie et une
grande intolérance à l’effort. Ses conséquences
sont une perte d’autonomie, une diminution de
la vie sociale et, ce qui est plus grave, des réper-
cussions psychologiques qui font qu’un grand
nombre de patients pensent que leur fatigue est
synonyme d’une évolution défavorable du can-
cer. Une dépression peut alors apparaître très ra-
pidement et influer sur le devenir de la maladie.
Bien que la tolérance à l’anémie soit variable
selon l’âge, le terrain cardio-vasculaire et des
●●●

21
facteurs individuels, un traitement doit rapide-
ment être mis en œuvre, dont le plus classique
est la transfusion sanguine. Pour le Dr Didier
Mayeur, oncologue à l’hôpital André-Mignot au
Chesnay, «cette thérapeutique ne donne pas des ré-
sultats stables dans le temps. Car, s’il n’y a pas de
correction de la cause de l’anémie en amont de ce
traitement, l’effet bénéfique de la transfusion san-
guine disparaît au bout de trois semaines », pré-
vient-il. Il spécifie en outre que les patients font
preuve d’une grande retenue vis-à-vis de la
transfusion sanguine, répercussion négative, au-
jourd’hui encore, du scandale du sang conta-
miné. Lui-même reconnaît sa réserve vis-à-vis
des transfusions sanguines et évoque l’émer-
gence de pathologies, telles que le paludisme ou
des accès de fièvre inexpliqués pendant plu-
sieurs jours, ne facilitant pas le traitement du
cancer. «Il faut aussi avoir à l’esprit que les trans-
fusions sanguines n’ayant absolument plus cours
au domicile des patients, l’hospitalisation obligatoi-
rement induite par la mise en œuvre de cette théra-
peutique ne va pas dans le sens d’une améliora-
tion de la qualité de vie du malade », poursuit le
Dr Didier Mayeur.
Autre traitement de l’anémie, d’une grande ef-
ficacité : l’érythropoïétine (EPO). Son autorisa-
tion de mise sur le marché la réserve à la pré-
vention ou à la correction de l’anémie chez des
patients traités par des chimiothérapies exclusi-
vement à base de platine. Les études actuelle-
ment disponibles et les observations infirmières
font valoir une bonne tolérance au traitement.
Une surveillance particulière de la tension arté-
rielle s’impose, notamment chez les personnes
hypertendues, l’EPO pouvant induire une éléva-
tion des constantes habituelles.
«Le principal intérêt de l’utilisation de l’EPO
est d’éviter une transfusion sanguine, explique le
Dr Didier Mayeur. Pour autant, il ne sert à rien
d’injecter de l’EPO à un patient dont l’anémie
est clairement prononcée, car l’EPO mettant 3 à
4semaines avant de donner une réponse biolo-
gique, cette particularité demande une certaine
anticipation dans la mise en œuvre de cette
thérapeutique ».
Entre qualité de vie et désir de vivre
Fondé sur sa pratique quotidienne dans le ser-
vice d’oncologie de l’hôpital Avicenne, à Bobi-
gny, et sur les propos qu’elle retient des pa-
tients, le discours du Dr Karen Rosier-Kraeuter,
psychologue clinicienne, permet de cerner les
valeurs individuelles mobilisées dans l’appré-
ciation de la qualité de vie d’une personne. Elle
rappelle que la perte d’autonomie du patient
dans des situations de vulnérabilité telles que
l’impossibilité de se lever pour aller aux toi-
lettes ou pour se laver est parfois source d’une
grande souffrance : «La souffrance de dépendre
des autres est, pour certaines personnes, plus
grande que la peur de mourir ».
Mais elle considère surtout que la qualité de
vie en cancérologie doit s’entendre comme une
qualité de survie. «Certains patients, au bout
d’un certain temps dans la maladie, en viennent
àaccepter des situations qu’ils n’auraient jamais
acceptées au début de leur cancer. Les intérêts et
les valeurs se déplacent au fur et à mesure de
l’évolution de la maladie. Ces revirements sont
parfois surprenants et il est absolument impos-
sible de deviner à l’avance leur devenir, note le
Dr Karen Rosier-Kraeuter. Nous connaissons
tous des patients jugeant acceptable, voire très
bonne, la qualité de leur survie, alors que, à nos
yeux, la situation paraît insupportable. D’où la
nécessaire capacité de tout soignant de savoir pas-
ser des soins curatifs aux soins palliatifs ». Car être
attentif à la qualité de vie des patients, c’est
savoir la préserver jusqu’au bout, et s’interroger
sur la qualité de leur mort. Il y a, dans cette
acceptation et cet accompagnement, une réelle
mission soignante. ■
D’après les propos tenus
lors de l’atelier de formation
“Mesure de la qualité
de vie aujourd’hui en cancérologie”.
organisé en collaboration
avec les laboratoires Janssen Cilag.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%