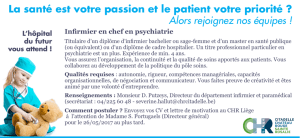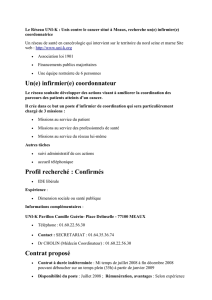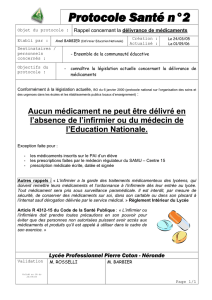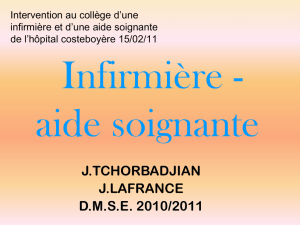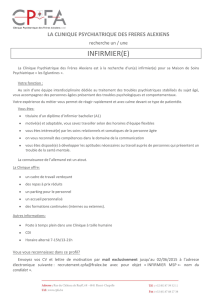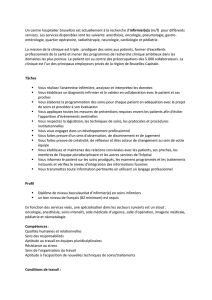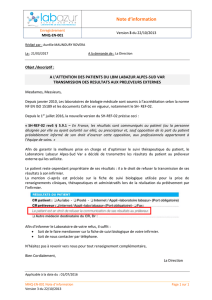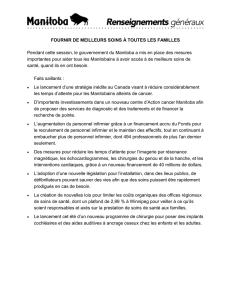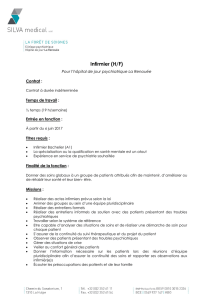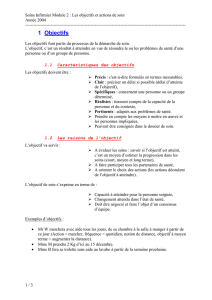U Un langage commun

Utilisé depuis plusieurs an-
nées dans les pays anglo-
saxons, le terme de “diagnostic
infirmier” n’a été officialisé dans
la législation française qu’en
1993. Il constitue le résultat du
processus diagnostique. Ce ré-
sultat, appelé jugement clinique,
est obtenu après le raisonnement
qu’effectue l’infirmière à partir
des données recueillies chez le
malade et/ou sa famille. Le pro-
cessus, quant à lui, est intégré
dans une démarche de soins.
Le raisonnement clinique infir-
mier permet de mieux connaître
le patient avant et pendant sa ma-
ladie, d’identifier très rapidement
ses réactions et ses problèmes de
santé réels ou potentiels. L’infir-
mière perçoit ainsi les indices, re-
père les signes qui orientent sa ré-
flexion vers une hypothèse de
diagnostic. A la vérité, le diagnos-
tic infirmier est complémentaire
du diagnostic médical. Mais sa
formulation permet aux infir-
mières de concrétiser les réactions
de la personne soignée en utili-
sant le même vocabulaire, la
même classification.
Une meilleure
communication autour
du malade
A priori, les bénéfices apportés
par l’utilisation du diagnostic in-
firmier doivent autant profiter à
la personne soignée qu’à la pro-
fession, ou même, à la santé pu-
blique. Il permet globalement
d’améliorer la qualité des soins
par une meilleure communica-
tion des équipes à propos du ma-
lade. Le langage commun du dia-
gnostic infirmier développe en
effet chez les soignants une
compréhension mutuelle qui fa-
cilite la mise en œuvre d’actions
concertées pour la continuité des
soins, avec une évaluation précise
des résultats. Le projet de soins
ainsi élaboré doit intégrer la par-
ticipation du malade et/ou de sa
famille à son éducation, en vue
de sa sortie de l’hôpital. En outre,
une fiche de synthèse compre-
nant le diagnostic infirmier peut
permettre la liaison entre les ser-
vices de l’hôpital et les structu-
res de soins coordonnés, comme
l’hospitalisation à domicile ou
les structures extrahospitalières.
A partir d’un même plan de soins
individualisé au malade, va donc
s’instaurer, en complémentarité,
une collaboration des différents
professionnels de santé autour de
la personne soignée. Le diagnos-
tic infirmier permet également de
développer le professionnalisme,
en construisant un “savoir infir-
mier” et en générant des re-
cherches cliniques en soins infir-
miers. Des échanges avec des
infirmier(e)s d’autres régions – et
d’autres pays - peuvent s’effectuer
avec les mêmes références. Enfin,
le bénéfice sera tout aussi net
pour l’estimation des coûts des
soins et la valorisation en termes
de santé publique. On le sait, le
diagnostic infirmier est men-
tionné dans le résumé des soins
infirmiers. Or, ce dernier met en
évidence la nature des soins dis-
pensés. Il peut donc être l’objet
d’études statistiques à visées épi-
démiologiques.
Stéphane Henri
12
Diagnostic infirmier
Un langage commun
L’utilisation du diagnostic infirmier améliore la qualité
des soins dispensés car il suscite la réflexion préalable
à l’action et précise les données dans un langage pro-
fessionnel commun. Surtout, il permet de développer
le rôle autonome de l’infirmière.
Brèves…
Génériques
Le nouveau répertoire des mé-
dicaments génériques est paru.
Il inclut 160 nouveaux pro-
duits et en supprime 17 an-
ciens. Mais le marché des gé-
nériques ne décolle pas, car
le taux de vente est d’envi-
ron 5 %.
Amiante
La direction des risques pro-
fessionnels de la CNAMTS
vient de signer un accord avec
les fédérations professionnelles
concernées, différents organis-
mes de prévention et le minis-
tère de l’Emploi pour coordon-
ner leurs actions et regrouper
leurs moyens pour mieux infor-
mer les salariés concernés par
le problème de l’amiante. A cet
effet, une opération d’informa-
tion, pilotée par la CNAMTS au
niveau national et les CRAM au
niveau régional, dispose d’un
budget de 1,5 million de francs.
Carte Sésam-Vitale
Selon les dernières statistiques,
à la mi-janvier, près de 63 %
des médecins utilisaient la carte
Sésam-Vitale. Paris et la Corse
sont à la traîne. Le 5 janvier
dernier, la neuf millionnième
feuille a été réalisée, par un
médecin de la Marne, pour être
précis. L’entrée en vigueur de la
CMU pourrait accentuer l’aug-
mentation de la diffusion de la
télétransmission.
Accréditation
Selon le programme de travail
de l’Anaes, environ 500 éta-
blissements hospitaliers de-
vraient être accrédités cette
année. Parmi les thèmes de
réflexion traités cette année,
treize concernent les profes-
sions paramédicales autour des
soins auxquels elles participent.
1
/
1
100%