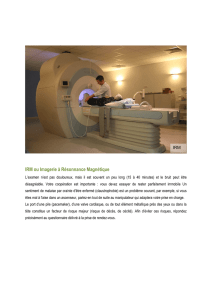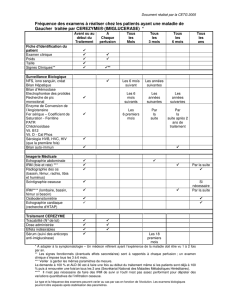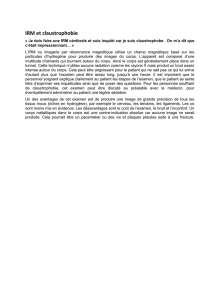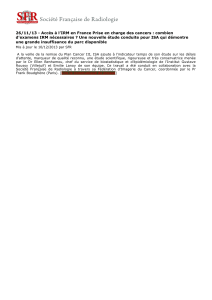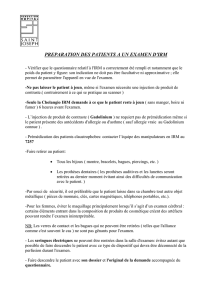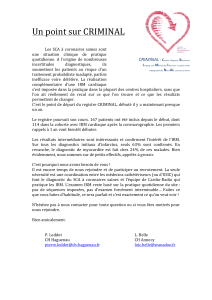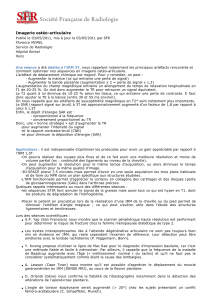L’ Quelle imagerie au cours du myélome multiple ? SYNTHÈSE

Figure 2. Bassin de face : aspect de lésion lytique de l’aile
iliaque droite.
Figure 1. Rachis dorsolombaire sans anomalie évidente en
dehors d’une déminéralisation diffuse prédominante au
rachis dorsal.
La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 1 au n° 360 - mars 2010 | 3
SYNTHÈSE
Quelle imagerie
au cours du myélome multiple ?
Q. Monzani*, A. Felter*
* Service de rhumatologie, groupe
hospitalier de la Pitié-Salpêtrière,
Paris.
L’
incidence du myélome multiple (MM) est de
4,7/ 100 000 et 80 % des personnes qui en déve-
loppent un ont ou auront une atteinte osseuse. La
mise en évidence de cette atteinte est essentielle
pour le diagnostic, la détermination du stade, le pro-
nostic, la décision thérapeutique et, donc, le suivi
et la réponse au traitement.
Les substances libérées par les plasmocytes
malins sont au premier plan de la physiopatho-
logie de l’ atteinte osseuse du MM. La balance
ostéoformation/ ostéorésorption est déséquili-
brée du fait de l’inhibition des ostéoblastes et de
l’activation des ostéoclastes, ces derniers étant
eux-mêmes activés par des substances telles
que l’IL-1 ou le TNFα responsables de la lyse
osseuse.
Évaluation
des différents examens
Radiographies standard corps entier
Il s’agit du bilan standard comprenant des radio-
graphies du crâne, du rachis entier, du grill costal,
des os longs et du bassin. Elles permettent de
déterminer le stade selon la classification de
Salmon et Durie (1975). Les atteintes osseuses ne
sont visibles qu’après une lyse de plus de 30 % de
l’os, elles sont donc d’une sensibilité faible et 10 à
20 % des lésions ne sont pas diagnostiquées. Les
lésions lytiques les plus fréquemment retrouvées
atteignent le rachis (65 % des MM avec atteinte
osseuse) et un examen même minutieux sur ces
rachis souvent dégénératifs est difficile (figures 1
et 2). La corrélation inter observateur est mau-
vaise : jusqu’à 32 % de reclassement au sein de la
classification de Salmon et Durie après relecture
par un radiologue spécialisé. La lésion typique à
rechercher est la lyse “à l’emporte-pièce” des os
plats, sans réaction scléreuse de l’os adjacent, étant
donné l’inactivation des ostéoblastes par les fac-
teurs locaux.

Figure 6. IRM T1 du rachis lom-
baire : perte de signal du corps
vertébral par rapport au disque
(diminution du contraste) à
tous les étages indiquant une
atteinte diffuse.
Figure 7. IRM CE en séquence STIR : hypersignal de plusieurs
corps vertébraux.
Figure 5. Rachis sagittal en
séquence STIR montrant une
infiltration diffuse des corps ver-
tébraux, aspect “poivre et sel”.
Figure 4. Même patient que la figure 2.
Figure 3. Aspect mité du corps vertébral au scanner.
4 | La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 1 au n° 360 - mars 2010
SYNTHÈSE
Scanner corps entier (ou Low Dose CT)
Il permet de diagnostiquer des lésions infraradio-
logiques (figures 3 et 4). L’acquisition des images
est plus rapide, ne nécessite pas la mobilisation de
patients souvent douloureux, et elle rend possible
une reconstruction en 3D. L’estimation du risque
fracturaire (notamment vertébral) permet de poser
l’indication d’une ostéosynthèse/ vertébroplastie.
Elle aboutit à un changement de stade dans 18 à
30 % des cas. Néanmoins, le scanner n’est pas sans
avoir des limites : l’irradiation est importante (cela
pouvant être résolu par le recours à des scanners
low dose) et, tout comme la radiographie, il ne rend
pas possible la différenciation des atteintes myélo-
mateuses décalcifiantes diffuses des ostéopathies
raréfiantes métaboliques telles que l’ostéo porose.
IRM rachidienne et IRM corps entier
(IRM CE)
L’IRM rachidienne fait désormais partie de l’imagerie
usuelle du MM lors du diagnostic (figures 5 et 6).
Elle est réalisée en séquences T1, T2, STIR et T1 avec
injection de gadolinium. Les lésions osseuses appa-
raissent en hyposignal T1, hypersignal T2 et STIR, et
seront rehaussées par le gadolinium. L’IRM est parti-
culièrement sensible pour les atteintes rachidiennes
et pelviennes. On trouve des lésions osseuses chez
19 % des patients avec des radiographies standard
normales. On peut visualiser une atteinte de la
moelle épinière ainsi que la moelle osseuse. Les
atteintes recherchées peuvent être une lésion lytique
focale, une infiltration diffuse homogène, l’associa-
tion d’une infiltration diffuse et d’une atteinte focale
ou encore un aspect “poivre et sel” d’une moelle
non homogène dans laquelle s’interposent des îlots
graisseux. Cet examen aboutit à la classification de
Salmon et Durie plus.
L’IRM CE a pour principal avantage d’explorer
l’ ensemble du squelette en un examen et de rem-
placer les radiographies standard du squelette entier
(figure 7). Au sein des antennes IRM actuelles, la
mise en pratique de cet examen crée des problèmes
de logistique puisque l’évaluation des différentes
séquences proposées prend actuellement plus d’une
heure par patient.

Figure 9. Algorithme proposé lors du diagnostic de myélome.
IRM CE disponible*
Oui Non
Radiographie standard CE
+ IRM rachis et bassin
* ou PET scan
Figure 8. PET scan : atteinte
étagée des corps vertébraux.
La Lettre du Rhumatologue • Suppl. 1 au n° 360 - mars 2010 | 5
SYNTHÈSE
• Delorme S, Baur-Melnyk A. Imaging in multiple myeloma.
Eur J Radiol 2009;70:401-8.
• Dimopoulos M, Terpose E, Comenzo RL et al. Inter-
national Myeloma Working Group consensus sta-
tement and guidelines regarding the current role
of imaging techniques in the diagnosis and moni-
toring of multiple myeloma. Leukemia 2009;
23:1545-56.
• Lütje S, de Rooy JW, Croockewit S, Koedam E, Oyen WJ,
Raymakers RA. Role of radiography, MRI and FDG-PET/
CT in diagnosing, staging and therapeutical evaluation
of patients with multiple myeloma. Ann Hematol 2009;
88:1161-8.
• Winterbottom AP, Shaw AS. Imaging patients with
myeloma. Clin Radiol 2009;64:1-11.
Pour en savoir plus…
Une imagerie de type IRM CE serait plus précise
pour mieux évaluer l’atteinte osseuse, le PET scan
et l’IRM CE étant les examens les plus performants.
L’accessi bilité limitée de ces examens rend difficile
d’y recourir en pratique courante et si l’IRM CE n’est
pas disponible, nous proposons d’associer systéma-
tiquement une IRM pelvienne à l’IRM rachidienne,
car l’atteinte pelvienne (30 % des atteintes osseuses
du MM), mal visualisée sur la radiographie standard
est l’une des plus fréquentes.
En pratique,
quelle imagerie pour le suivi ?
L’imagerie n’est pas systématique, et ce sont surtout
l’apparition de nouveaux symptômes cliniques et
l’aggravation ou la récidive des anomalies biolo-
giques qui posent l’indication.
La faible sensibilité des radiographies CE et le fait que
ni la radiographie standard ni le scanner ne permet-
tent de visualiser la moelle osseuse rendent inadé-
quats ces 2 examens. L’IRM, avec une diminution du
signal T2, et le PET scan, avec une diminution de la
fixation permettant de visualiser l’activité tumorale,
peuvent avoir une certaine pertinence pour mesurer
la réponse au traitement ou détecter une récidive
ainsi qu’une nouvelle atteinte.
Perspectives d’avenir
Les examens les plus sensibles et les plus spécifiques
que sont l’IRM CE et le PET scan au 18-FDG, déjà
disponibles dans certains centres, vont entrer dans
la pratique courante.
L’arrivée des nouvelles antennes IRM permettra
de diminuer le temps de l’examen (une IRM STIR
CE durera alors moins de 9 minutes). Certaines
séquences comme l’IRM de diffusion sont actuel-
lement en cours d’étude, notamment dans l’évalua-
tion de la réponse au traitement par la mesure du
coefficient de diffusion. ■
PET scan au 18-FDG
Sa sensibilité est de 89,2 %, contre 83,3 % pour
l’IRM, 70,4 % pour le scanner (figure 8) et 47,4 %
pour les radiographies standard. Cet examen a pour
défauts, principalement, son prix, son insuffisante
disponibilité et son irradiation. De plus, les faux
positifs ne sont pas rares et il n’est pas possible de
distinguer l’atteinte myélomateuse de celle d’une
infection ou d’une inflammation. L’indication prin-
cipale, en pratique courante, est le bilan d’extension
du plasmocytome solitaire.
Scintigraphie au technétium 99
Son utilité est désormais réduite, sa sensibilité étant
médiocre du fait de l’inactivité ostéoblastique (résul-
tant des facteurs locaux) par opposition aux méta-
stases osseuses. Sa prescription est donc limitée
aux diagnostics difficiles, afin d’éliminer d’autres
pathologies néoplasiques ou infectieuses.
En pratique,
quelle imagerie pour faire
le diagnostic de MM ?
Actuellement, le bilan le plus pratiqué lors du dia-
gnostic de MM associe radiographie standard corps
entier (CE) et IRM du rachis (figure 9).
1
/
3
100%