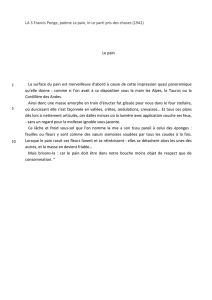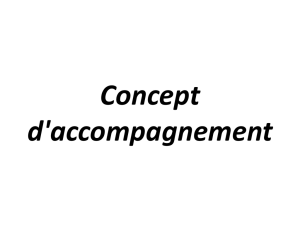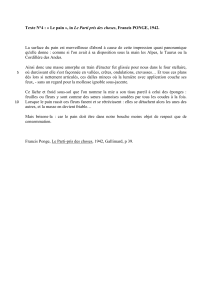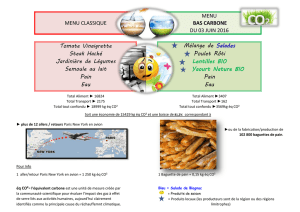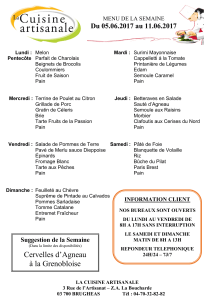U Le soulagement optimal de la douleur Considérations bioéthiques

Antalgie interventionnelle en fin de vie
Le soulagement optimal de la douleur
est-il toujours la solution optimale ?
Considérations bioéthiques
Alex Cahana*
Diverses revues de la littérature ainsi que des recomman-
dations cliniques et des études d’évolution à long terme
sont disponibles sur l’administration intrathécale d’antal-
giques (3). La qualité d’analgésie relevée chez des pa-
tients correctement sélectionnés et traités dans ces di-
verses études est bonne et reproductible, et l’incidence
des effets collatéraux et des complications paraît accep-
table au regard de la qualité du soulagement obtenu (4).
L’utilisation des technologies implantables, en revanche,
est trop récente, et les données recueillies sont trop peu
abondantes pour poser un jugement définitif sur leur effi-
cacité. De ce fait, la réponse à la question “le soulagement
optimal de la douleur est-il la meilleure solution pour les pa-
tients dans un contexte de fin de vie ?” n’est pas univoque.
Trois patients de notre institution, souffrant tous de néo-
plasie évoluée, se présentent dans notre unité, porteurs de
douleurs intolérables et d’effets adverses majeurs, notam-
ment d’une confusion mentale sévère (tableau I). Tous trois
ont un essai thérapeutique de sept jours associant fentanyl
et bupivacaïne par voie péridurale et deux sont “implan-
tés” avec une pompe intrathécale programmable (5) (le troi-
sième patient, M. D., a refusé la pompe et a poursuivi son
traitement antérieur).
Après mise en place de leur pompe, les deux patients ont eu
un soulagement estimé à 50 % et une amélioration signi-
ficative de leurs performances cognitives (tableau II). Mais,
parallèlement à cette amélioration, on notait une majora-
tion significative de la dépression et de l’anxiété ainsi
qu’une diminution du bien-être selon les diverses échelles
d’évaluation de la dépression et de l’anxiété (Beck Depres-
sion Inventory, Speilberger Anxiety Trait Inventory et
Edmonton Symptom Assessment Scale). Les patients ont
été traités en hospitalisation dans notre centre de soins
palliatifs et ont été suivis par l’équipe de psychologues.
Bien que leurs activités quotidiennes aient significative-
ment augmenté, dans des conditions plus favorables, les
deux patients ont connu des conflits conjugaux et ont dû
être inclus dans un programme de thérapie familiale. La
nature de ces conflits consistait en des altercations inter-
personnelles entre le patient et ses proches : “Arrêtez de
me parler uniquement de la douleur et des nausées...” ou,
à l’inverse, “Arrêtez de me dire ce que je dois faire, je ne
suis pas votre esclave...”. Les sujets antérieurs de préoc-
cupations familiales (enfants, épouse, ex-épouse, belle-fa-
mille) viennent au premier plan des sujets de méconten-
tement. Finalement, le cancer et la mort elle-même émergent
comme un fardeau émotionnel majeur pour le conjoint :
“Tu étais déjà mort, que fais-tu là à nouveau ? Je ne peux
pas supporter de te perdre à nouveau.”
Ces deux cas mettent en exergue la complexité des consé-
quences imprévisibles de nos interventions médicales. Les
indications de dispositifs implantables sont apparemment
bien codifiées, les procédures sont standardisées et l’évo-
lution probable après mise en place peut être exposée aux
patients. Dans ces conditions, pourquoi nos patients ont-
ils connu cette évolution défavorable ? Aurions-nous pu
Mots-clés : Douleur : fin de vie - Antalgie interventionnelle -
Éthique - Soutien psychologique.
U
ne prévalence élevée de douleurs insuffi-
samment traitées est rapportée dans les ser-
vices médicaux, chirurgicaux et d’oncologie, malgré
plusieurs décennies d’efforts pour proposer aux cliniciens
un certain nombre d’alternatives thérapeutiques
(1)
.
Néanmoins, des traitements antalgiques, que l’on
pourrait qualifier de
“high tech”
, tels que PCA (anal-
gésie contrôlée par le patient), cathéters périduraux ou
sous-arachnoïdiens, ou encore pompes implantables in-
trathécales, sont utilisés de plus en plus fréquemment
pour la minorité de patients pour lesquels les mesures
thérapeutiques plus simples ne suffisent pas
(2)
.
28
Le Courrier de l’algologie (3), n
o
1, janvier/février/mars 2004
Éthique
Éthique
* Responsable de l’Unité d’antalgie interventionnelle, Département d’anes-
thésie, pharmacologie et soins intensifs, hôpital cantonal, CHU de Genève,
Suisse.
Note de l’auteur : Ces cas cliniques évoqués dans cet article ont été présen-
tés à la réunion du Groupe de travail “Éthique” du congrès annuel 2002 de
l’American Pain Society Meeting à Baltimore (États-Unis).

anticiper ces risques ? À défaut, cela doit-il influencer nos
décisions thérapeutiques ? Tenter d’analyser cette évolu-
tion reste du domaine de la spéculation. L’absence d’effets
euphorisants avec les opiacés par voie intrathécale (ces
effets étant dépendants de la dose) contribue probablement
de manière directe à l’apparition de la dépression et de
l’anxiété. De même, l’amélioration cognitive pourrait
amener les patients à prendre conscience de leur fin proche
et cristalliser ainsi un état dépressif. On peut également
imaginer que l’amélioration cognitive a conduit à une
nouvelle dynamique conjugale, trop tôt entrée dans un
état catatonique et, par voie de conséquence, à un état de
stress supplémentaire dû à des problèmes négligés ou non
résolus en raison de l’état antérieur. Finalement, on pour-
rait imaginer que la mise en place d’une solution “high-
tech” demande au malade et à son entourage immédiat un
investissement (médical et personnel) trop important, dans
une situation où le deuil est déjà fait et où une “résurrection”
n’est pas souhaitée.
Quelles que soient les éventuelles prédispositions, pré-
textes ou situations prémorbides, l’évolution est décrite
comme difficile à accepter et doit induire une réflexion
éthique quant à nos interventions. Habituellement, nous
avons coutume de considérer les douleurs rebelles, les effets
adverses sévères incontrôlables des traitements par voie
orale et la bonne compréhension de la thérapeutique par
le patient comme de bonnes indications de mise en place
de dispositifs implantables. Dans ces deux cas, il semble
que l’état de détresse psychologique soit lié au fait que ces
patients souffraient de douleurs non contrôlées et d’effets
adverses sévères depuis de nombreux mois avant implan-
tation. Ce fait n’est pas anodin. Apparemment, en effet, la
douleur non traitée n’imprime pas uniquement une “marque
cellulaire”, mais aussi une prédisposition comportemen-
tale et interrelationnelle vis-à-vis de la douleur (6).
Ainsi, si le timing est crucial, on doit se demander quel est
le moment le plus opportun pour proposer la mise en place
d’un traitement invasif. Est-ce trop tard en fin de vie ?
Y a-t-il un “trop tard” ? Une attitude de type “mieux vaut
tard que jamais” est-elle appropriée ? Ces questions se
justifient par la recherche d’un équilibre entre une obli-
gation de ne pas nuire, c’est-à-dire l’obligation de ne pas
créer de dommages (Primum non nocere) et une obliga-
tion d’apporter une aide aux patients. Cette distinction est
importante, car elle sous-tend le concept de “proportion-
nalité”, qui permet d’évaluer le rapport coût-bénéfice de
nos interventions. Et si l’on mesure ce rapport en termes
de qualité de vie, on peut se demander si cet objectif a été
atteint pour nos deux patients. C’est ainsi que l’obligation
de ne pas nuire doit prendre en compte le fait de ne pas
interférer avec les souhaits personnels de vie (et de style
de vie) (7).
Finalement, quelles sont les solutions ? Une approche
rigide (ne pas nuire) en fin de vie, au risque de priver cer-
Tableau I. Caractéristiques des patients.
Âge Diagnostic Traitement Effets adverses
Monsieur B. 58 ans Métastases carcinome 1,5 g morphine Troubles cognitifs
bronchique à petites cellules 4 mg clonazépam Obnubilation
6 mg dexaméthasone Myoclonies
Madame P. 52 ans Métastases carcinome 1,2 g morphine Troubles cognitifs
col utérin 2 400 mg gabapentine Obnubilation
4 mg dexaméthasone Myoclonies
Monsieur D. 65 ans Métastases 350 µg/h/48 h fentanyl Troubles cognitifs
adénocarcinome gastrique 4 mg clonazépam Obnubilation
8 mg dexaméthasone
Tableau II. Évolution thérapeutique des patients.
* intrathécale
Diagnostic Traitement Effets adverses
Monsieur B. Métastases carcinome 4,5 mg morphine i.t.* Nausées transitoires
bronchique à petites cellules 4 mg clonazépam
Madame P. Métastases carcinome 3,5 mg morphine i.t.* Hypercalcémie (corrigée)
col utérin 210 µg IT clonidine
2 400 mg gabapentine
29
Le Courrier de l’algologie (3), n
o
1, janvier/février/mars 2004
Éthique
Éthique

tains patients des bénéfices de thérapies interventionnelles
efficaces ? Une intervention plus précoce serait évidem-
ment souhaitable afin d’éviter des périodes de douleur indues
et, à la lumière de cas similaires, devrait être associée à un
support psychologique adapté. L’expérience humaine de
la douleur et de la souffrance est faite d’un écheveau exis-
tentiel et psychique complexe, ces deux notions sous-
tendant des concepts non totalement similaires. L’éthique
de l’analgésie et l’éthique de la science médicale sont
intimement liées et le reconnaître ne fait que marquer le
début d’un long processus d’actions correctives et d’amé-
liorations graduelles. Exposer ces deux cas n’a pour but
que de stimuler cette réflexion et ce processus. ■
Références bibliographiques
1.
Quality improvement guidelines for the treatment of acute and cancer pain.
APS Consensus Statement. JAMA 1995 ; 274 : 1874-80.
2.
APS TAsk Force. Treatment of pain at the end of life. APS Bulletin 1997 ; 7 : 11.
3.
Portenoy RK, Hassenbusch SJ. PolyAnalgesic Consensus Conference 2000.
J Pain Symp Manag 2000 ; 20 : S1-S50.
4.
Wallace M,Yaksh TL. Long term spinal analgesic delivery : a review of pre-
clinical and clinical literature. Reg Anesth Pain Med 2000 ; 25 : 117-57.
5.
Patt RB, Hassenbusch SJ. Implantable technology for pain control. In :
Waldman SD (ed). Interventional pain management (2nd ed). Philadelphie :
WB Saunders, 2001 : 654-70.
6.
Chapman RC, Garvin J. Suffering : the contributions of persistent pain.
Lancet 1999 ; 353 : 2233-7.
7.
Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. Oxford Press,
5th edition, 2001.
Le soulagement optimal de la douleur est-il toujours
la solution optimale ? Considérations bioéthiques
Les deux cas évoqués illustrent quelques-uns des aspects les
plus ambigus des conséquences de l’antalgie interventionnelle
en fin de vie. Ils permettent de souligner le paradoxe d’un
contrôle adapté de la douleur qui augmenterait plutôt qu’il ne
diminuerait le besoin d’un soutien psychologique en fin de vie.
De quoi s’agit-il ? La réponse n’est pas univoque, et l’on peut ci-
ter Karl Marx : “Le seul antidote à la souffrance de l’esprit est
la douleur physique.” Certains patients traités en psychiatrie,
par exemple, ne survivent à leur souffrance mentale qu’en se
mutilant. Et Tolstoï fait dire à Ivan Illich sur son lit de mort : “Et
maintenant tout est accompli et il n’y a plus que la mort”.
Is optimal pain relief always optimal?
Those two cases show some of the more confusing unintended
consequences of interventional pain management at the end of
life. They serve to remind us that pain occurs within the complex
homeostatic system of the person. These cases raise the para-
doxical possibility that good pain control may increase rather
than decrease the need for psychological support at the end of
life. Why could this be? I don’t have the answer, but will leave
you with two quotes. Karl Marx stated : “The only antidote to
mental suffering is physical pain.” Some psychiatric patients,
for example, find they can survive their mental torment only by
cutting on themselves. And Tolstoy’s Ivan Illich says to himself
on his deathbed : “And now it is all done and there is only death.”
Keywords: Pain: end-of-life - Interventional pain management -
Ethics - Psychological support.
Résumé/
Summary
30
Le Courrier de l’algologie (3), n
o
1, janvier/février/mars 2004
Éthique
Éthique
Au sommaire
•Comment traiter les douleurs... à domicile
(J.M. Gomas, Limoges)
•Analgésie et sédation consciente pour soins
dentaires chez l’enfant (Y. Delbos et al., Bordeaux)
•Prise en charge de la douleur aiguë
en oncologie (1re partie) (F. Lakdja, Bordeaux)
•Principes et indications de l’épiduroscopie
(J.W. Kallewaard et al., Arnhem)
•Céphalées posturales après saccoradiculographie
(E. Viel, Nîmes)
du prochain numéro du
avril-mai-juin 2004
1
/
3
100%
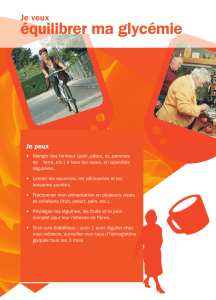
![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)