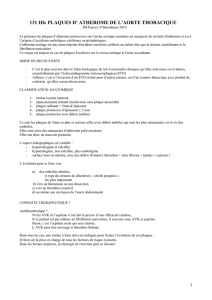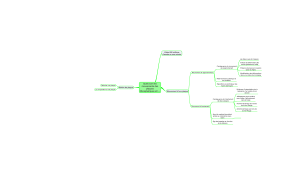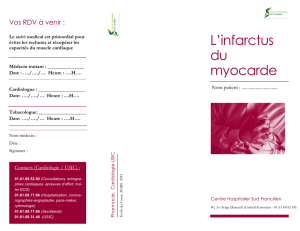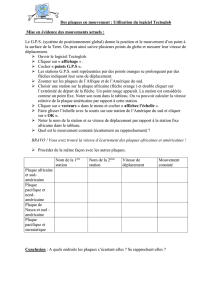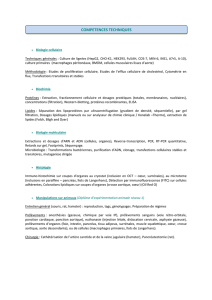Lire l'article complet

La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999
24
DOSSIER
échocardiographie transœsophagienne (ETO) permet
une approche originale dans la démarche diagnostique
des accidents emboliques centraux ou périphériques.
Parmi les différentes anomalies parfaitement détectées par cette
technique figurent en bonne place les atteintes athéromateuses de
la crosse de l’aorte. Cette pathologie était auparavant diagnosti-
quée essentiellement en peropératoire d’une chirurgie aortique
ou lors d’une autopsie. De nombreux travaux ont récemment été
consacrés à l’approche de cette pathologie par l’ETO. Il est donc
intéressant d’évaluer ce qu’ont apporté ces travaux, tant sur la
connaissance de la pathologie elle-même que sur ses implications
cliniques et thérapeutiques, sans éluder, bien sûr, les nombreuses
questions qui restent posées et incitent donc à poursuivre ces
études.
POURQUOI LA CROSSE EST-ELLE UN SITE PRIVILÉGIÉ POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE LÉSIONS ATHÉROSCLÉREUSES ?
Le développement d’une lésion athéromateuse au niveau de la
crosse aortique reflète l’hétérogénéité des différents segments
artériels vis-à-vis de l’athérosclérose, laquelle touche en priorité
les bifurcations et les segments courbes (1). Au niveau de la
crosse, les oscillations de la direction des contraintes de cisaille-
ment augmentent le temps de stagnation des particules sanguines
et, en conséquence, le temps d’exposition de l’endothélium aux
particules athérogènes. Ces interactions sang-paroi favorisent
alors le développement des lésions d’athérosclérose. Les plaques
d’athérome ainsi formées s’ulcèrent assez fréquemment, entraî-
nant des embolies de bouillie athéromateuse ou de cristaux de
cholestérol. Mais, sur le site de l’ulcération, un thrombus peut se
former, qui se développera, puis migrera ou régressera, soit spon-
tanément, soit après traitement médical ou chirurgical.
L’imputabilité de la crosse dans la survenue d’accidents embo-
liques a été évoquée à partir d’études anatomopathologiques (2).
Amarenco et coll. ont mis en évidence, sur une série de 500 autop-
sies, une prévalence significativement plus importante de plaques
ulcérées chez les patients décédés d’accident vasculaire cérébral
comparativement aux patients décédés d’une autre cause neuro-
logique, et ce d’autant plus qu’aucune étiologie à l’accident embo-
lique n’avait été rétrouvée. Dans une autre étude autopsique, la
présence de plaques aortiques représentait, après la fibrillation
auriculaire, le facteur de risque le plus important pour les embo-
lies systémiques (3). Toutefois, il est souhaitable de ne pas se
contenter d’un diagnostic autopsique, et il semble alors logique
d’assurer une détection de l’athérosclérose aortique autre que post
mortem ! L’échographie transœsophagienne prend alors tout son
intérêt. La technique, simple et accessible dans la plupart des
centres cardiologiques, peut être répétée, pour peu que l’examen
initial n’ait pas laissé un souvenir douloureux au patient.
MÉTHODES DE DÉTECTION DES PLAQUES
L’ETO offre en effet une vue tout à fait optimale tant sur la crosse
aortique que sur l’aorte ascendante ou descendante (dans sa por-
tion sus-diaphragmatique), grâce aux images en petit ou grand
axe, en utilisant les coupes dans le plan longitudinal ou trans-
versal. Les images d’athérome détectées à l’ETO dépendent bien
évidemment de l’importance du processus pathologique. Plu-
sieurs classifications ont été proposées (tableau I). Toutes res-
pectent bien sûr un certain continuum, allant d’une intima un peu
épaissie à une plaque complexe, calcifiée, faisant protrusion dans
la lumière aortique, associée à des ulcérations et à des éléments
thrombotiques mobiles (figure 1).
●Z.H. Jankowski, T. Laperche*
*Centre cardiologique du Nord, 32-36 rue des Moulins-Gémeaux,
93200 Saint-Denis.
■La crosse aortique est un site privilégié pour le dévelop-
pement de lésions athéromateuses.
■
Double intérêt de l’échocardiographie par voie transœso-
phagienne : d’une part diagnostique (identification des
plaques), d’autre part pronostique (plaques à risque : épais-
seur 4 mm, hypoéchogènes et ulcérées).
■Une forme particulière : les thromboses pédiculées de
la crosse, souvent développées au contact d’une plaque
isolée.
■Pas d’études randomisées disponibles pour définir le trai-
tement optimal, lequel n’est certainement pas chirurgical
mais passerait plus vraisemblablement par les anticoagu-
lants oraux.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
L
‘
Attitude pratique devant un athérome de la crosse aortique

L’épaisseur de la plaque est un élément important pour le pro-
nostic, les complications étant plus nombreuses pour les plaques
d’une épaisseur supérieure ou égale à 4 mm. L’aspect échogra-
phique est d’ailleurs assez bien corrélé aux données anatomopa-
thologiques. Celles-ci montrent, dans les atteintes peu sévères,
un noyau lipidique de faible importance et un dépôt fibreux parié-
tal, et, dans les stades extrêmes, un épaississement important de
la média, de nombreux dépôts lipidiques dans une intima très
remaniée, et des éléments fibrino-cruoriques associés (4). L’ETO
n’est d’ailleurs pas la seule technique d’identification de ces
plaques athéromateuses, des résultats fort encourageants étant
obtenus avec le scanner à acquisition rapide (figure 2). Cette
dernière méthode est encore en cours d’évaluation dans ce cadre
pathologique.
RISQUES ENGENDRÉS PAR LA PRÉSENCE DE PLAQUES AOR-
TIQUES DÉTECTÉES À L’ETO
L’importance de ces plaques de la crosse aortique peut être cor-
rélée avec la fréquence de survenue d’accidents vasculaires céré-
braux. Chez des patients de plus de 60 ans ayant fait un accident
vasculaire cérébral, des plaques supérieures ou égales à 4 mm
sont retrouvées sur la crosse aortique, en amont de l’artère sous-
clavière gauche, dans 14 % des cas, contre 2 % chez des sujets
témoins appariés pour l’âge (5). Le suivi sur 2,3 ans de
331 patients
ayant fait un infarctus cérébral montre un risque de
récidive de 11,9 % par année-patient en présence de plaques athé-
romateuses de la crosse supérieures ou égales à 4 mm contre
2,8 % par année-patient en l’absence de plaques (6). Le carac-
tère évolutif de ces plaques à l’ETO explique l’incidence des
complications emboliques. Ainsi, dans un travail de Montgo-
mery et coll., une ETO de contrôle a été réalisée chez 30 patients,
20 mois après la découverte d’un athérome profus au niveau de
la crosse. Au contrôle échographique, une modification de l’as-
pect a été observée chez un tiers de ces 30 patients, cette modi-
fication correspondant soit à une progression de l’atteinte, soit
à une disparition d’éléments mobiles ou à une formation de nou-
veaux éléments mobiles au niveau de la plaque (7). Dans ces
atteintes athéromateuses prononcées de la crosse, le processus
pathologique, très évolutif, notamment au niveau des éléments
mobiles développés sur la plaque, se manifeste par la sévérité
des complications. Dans ce dernier travail, c’est d’ailleurs dans
le groupe dont l’atteinte échographique était la plus sévère que
se trouvait la plus forte mortalité observée durant le suivi (mor-
talité de 24 % sur un suivi de 18 mois) (7). Les plaques athéro-
mateuses de l’aorte sont aussi responsables d’embolies de cho-
lestérol, le site privilégié responsable de ces embolies étant l’aorte
thoracique descendante (8).
La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999
25
DOSSIER
Figure 1. Athérome profus de la crosse aortique chez un patient de 52 ans
ayant présenté des accidents emboliques rénaux. L’ETO met en évidence
une plaque très épaissie, anfractueuse, avec présence d’éléments
mobiles.
Figure 2. Résultat d’un scanner à acquisition rapide de l’aorte thora-
cique réalisé chez un patient ayant présenté un accident embolique d’un
membre inférieur. L’examen radiologique montre une plaque athéroma-
teuse très anfractueuse faisant protrusion dans l’aorte descendante (cli-
chés dus à l’obligeance du Dr Sablayrolles, Centre cardiologique du
Nord, Saint-Denis).
Fazio (23) Ribakove (24) FAPS (6)
Grade 1 paroi normale paroi normale paroi < 1 mm
Grade 2 épaississement épaississement
1 mm plaque < 4 mm
pariétal peu intimal
important
et régulier
Grade 3 plaque irrégulière
athérome < 5 mm
plaque 4 mm
ou ulcérée
Grade 4
plaque protubérante,
athérome 5 mm
éléments mobiles
Grade 5
athérome mobile
Tableau I. Exemples de classifications de l’athérome aortique propo-
sées dans la littérature.

Toutefois, si l’aspect échographique de la plaque aortique
influence largement le pronostic des patients, les athéromes très
calcifiés ne sont pas les plus à risque d’événements péjoratifs.
Ainsi, chez 334 patients de plus de 60 ans suivis sur une période
de 2 à 4 ans après un infarctus cérébral, le risque de survenue
d’événements cardiovasculaires est significativement plus élevé
en présence de plaques d’une épaisseur supérieure ou égale à
4mm, hypoéchogènes ou ulcérées. Ce risque cardiovasculaire
est systématiquement plus élevé pour les plaques non calcifiées
supérieures ou égales à 4 mm comparativement aux plaques cal-
cifiées, et ce quels que soient les autres aspects morphologiques
de la plaque aortique à l’ETO (9). On retrouve ainsi à l’étage
aortique des notions connues dans la pathologie athéromateuse
coronarienne, à savoir que le potentiel thrombogène d’une plaque
athéromateuse est en relation étroite avec la présence en son sein
d’un large noyau lipidique (10). Les corrélations anatomo-écho-
graphiques ont montré que ce noyau lipidique était surtout pré-
sent dans les formes les plus avancées des plaques aortiques,
mais ne dépendait pas de la présence ou non de calcifications
(4). Cela permet d’expliquer une forme tout à fait particulière
d’athérome aortique, les thromboses pédiculées. Elles survien-
nent chez des sujets généralement jeunes ayant présenté un acci-
dent embolique artériel central ou périphérique souvent sévère.
L’ETO réalisée à la recherche de la source emboligène met alors
en évidence une thrombose pédiculée mobile dans la lumière
aortique, s’insérant généralement sur une plaque athéromateuse,
complexe ou non (figure 3) (11). Cette entité anatomo-clinique
diffère en bien des points des athéromes profus de la crosse aor-
tique (sujets généralement plus jeunes, plaque localisée sur la
crosse, aorte échographiquement normale ou très faiblement
athéromateuse par ailleurs), mais résulte d’un processus patho-
logique comparable et n’est qu’une variante de l’expression de
la maladie athéromateuse.
INFORMATIONS TIRÉES DE LA DÉCOUVERTE D’UN ATHÉROME
AORTIQUE
La maladie athéromateuse étant plurifocale, il est tentant de cor-
réler la présence de ces plaques aortiques à la présence de lésions
athéromateuses sténosantes à l’étage coronaire. L’une des impli-
cations serait d’éviter une coronarographie préopératoire systé-
matique à des patients devant être opérés d’une valvulopathie et
qui auront une ETO pour le bilan anatomique des lésions. Ainsi,
quel que soit l’âge des patients, même au-delà de 70 ans, l’ab-
sence d’athérome aortique profus est fortement prédictive de l’ab-
sence d’athérome coronaire (12). Certaines équipes développent
des critères croisés combinant l’aspect de la crosse aortique et de
la paroi carotidienne pour prédire l’existence de lésions coro-
naires (13).
Enfin, la découverte d’un athérome profus au niveau aortique peut
conduire à modifier la voie d’abord pour une coronarographie.
Ainsi, dans un travail de Karalis, un accident embolique post-
cathétérisme est survenu chez 17 % des patients porteurs d’un
athérome profus au niveau de la crosse après abord par voie fémo-
rale, contre 3 % des sujets contrôles indemnes de lésions aor-
tiques. Aucun des 11 patients porteurs d’un athérome aortique
profus mais ayant eu un abord brachial n’a présenté de compli-
cations emboliques (14). Dans ce travail, les éléments cliniques
fortement prédictifs de la présence d’un athérome aortique étaient
l’âge avancé (au-delà de 80 ans, le risque était multiplié par 6,8
par rapport à la tranche d’âge 60-69 ans) et l’existence d’une
atteinte artérielle périphérique. Ce travail ne se prononçait pas
sur la nécessité de pratiquer une ETO avant toute coronarogra-
phie chez un sujet à risque !
La mise en évidence d’un athérome aortique peut aussi conduire
le chirurgien cardiaque à modifier son lieu de canulation pour
mettre en place la circulation extra-corporelle.
Enfin, chez les patients ayant une fibrillation auriculaire d’ori-
gine non valvulaire, la mise en évidence à l’ETO d’un athérome
aortique évolué (plaque complexe) est un indicateur puissant du
risque thromboembolique et doit inciter à traiter ces patients par
anticoagulants (INR 2 à 3), d’autant plus que des anomalies de
l’oreillette gauche sont également présentes (thrombus dans l’au-
ricule, contraste spontané ou vitesse dans l’auricule < 20 cm/s)
(15).
ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE
C’est, bien sûr, notre préoccupation première devant la décou-
verte d’un athérome aortique. Malheureusement, nous ne pou-
vons énoncer ici une attitude validée puisque, dans ce cadre patho-
logique, les études ayant abordé le traitement sont essentiellement
des analyses rétrospectives et non des études randomisées. Dans
cette démarche thérapeutique, il est traditionnel d’opposer l’op-
tion du traitement médical à celle du traitement chirurgical.
Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical, généralement une endartériectomie, ne
peut pas représenter une approche satisfaisante du traitement des
athéromes profus de la crosse aortique. En effet, l’aorte est glo-
balement touchée par le processus athéromateux, et l’exérèse de
la plaque se fait sur un tissu fragilisé, expliquant les fortes mor-
La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999
26
DOSSIER
Figure 3. Patient de 38 ans ayant présenté une embolie du bras gauche.
À l’ETO, découverte d’une thrombose pédiculée, mobile dans la lumière
aortique, s’insérant au niveau de l’isthme aortique sur une plaque athé-
romateuse très localisée. .../...

bidité et mortalité péri-opératoires : ainsi, chez 268 patients subis-
sant une chirurgie cardiaque et présentant un athérome aortique
profus, l’exérèse de cet athérome s’est compliquée d’un accident
vasculaire cérébral dans 35 % des cas, alors que le taux de com-
plications n’était que de 12 % lorsque l’athérome était respecté
(16). Même si l’exérèse est techniquement possible, elle est rare-
ment justifiée (17). La seule situation où la chirurgie est réali-
sable est celle des thromboses pédiculées de la crosse aortique,
le geste devant alors comporter une thrombectomie et une exé-
rèse de la plaque athéromateuse. Toutefois, là encore, aucune
étude randomisée n’a confirmé les résultats satisfaisants de la chi-
rurgie, constatés lors d’une analyse rétrospective (11).
Traitement médical
Quant au traitement médical, il reste controversé. Des suivis de
cohortes ont montré que le traitement anticoagulant ou antiagré-
gant ne modifiait pas le cours évolutif de la pathologie (pas de
minoration du risque d’événement vasculaire) (6,18).Ainsi, dans
l’étude FAPS, il n’y avait pas de différence significative dans le
taux de complications entre les patients ayant une plaque aortique
supérieure ou égale à 4 mm traités par aspirine et ceux traités par
antivitamines K. Mais le but de ces études n’était pas l’évalua-
tion d’une stratégie thérapeutique, de sorte que les résultats obser-
vés ne peuvent se substituer à un essai thérapeutique rigoureux,
avec étude prospective randomisée. D’ailleurs, en opposition aux
travaux précédents, d’autres études prospectives, mais toujours
non randomisées, ont montré un bénéfice des anticoagulants supé-
rieur à celui des anti-agrégants (19, 20). Dans le travail de Dress-
ler et coll., les patients ayant eu un accident embolique et pré-
sentant un athérome aortique profus avec éléments mobiles
avaient un taux d’événements vasculaires bien moindre sous anti-
coagulants oraux qu’en leur absence, et ce indépendamment de
la taille des débris mobiles (18). Certains auteurs déconseillent
les anticoagulants du fait du risque d’embolies de cholestérol. En
fait, si le traitement anticoagulant est habituellement contre-indi-
qué chez les patients présentant des embolies de cholestérol, cela
découle le plus souvent d’observations sporadiques où pareille
association a été observée. Pourtant, bien des patients sous anti-
coagulants qui seraient des candidats potentiels aux embolies de
cholestérol ne développent pas pour autant une telle pathologie.
Dans le travail de Dressler, ce risque n’a nullement été majoré
par les anticoagulants oraux. Ce point vient d’être confirmé par
l’étude SPAF III, puisque le taux d’embolies de cholestérol chez
les patients sous anticoagulant était comparable, que ces patients
soient indemnes de plaques aortiques (taux de 0,7 %/année-
patient ; IC à 95 % : 0,1-5,3) ou porteurs (taux de 1,3 % ; IC à
95 % : 0,2-9,5) (21).
CONCLUSION
Ces incertitudes thérapeutiques montrent combien une étude ran-
domisée contre placebo évaluant de façon prospective l’effica-
cité des anticoagulants et celle des anti-agrégants est nécessaire.
Compte tenu de nos connaissances actuelles sur l’évolution natu-
relle de la plaque athéroscléreuse, il semble difficile d’exclure
d’une telle étude un hypolipémiant de type statine. En outre, des
travaux préliminaires réalisés sur de faibles effectifs de patients
porteurs d’une hypercholestérolémie familiale ont montré une
régression significative de l’épaisseur de la plaque athéromateuse
sous une association de régime hypolipidique, pravastatine et pro-
bucol (22). Ces études sont indispensables pour que nous puis-
sions rapidement nous placer, vis-à-vis des plaques athéroma-
teuses de la crosse, non plus dans un cadre contemplatif, mais
dans un cadre résolument actif, dans le but de prévenir leurs
complications, souvent lourdes et invalidantes. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Zarins C.K., Giddens D.P., Bharadvaj B.K. et coll. Carotid bifurcation athe-
rosclerosis. Quantitative correlation of plaque localization with flow velocity pro-
files and wall shear stress. Circ Res 1983 ; 53 : 502-14.
2.
Amarenco P., Duyckaerts C., Tzourio C. et coll. The prevalence of ulcerated
plaques in the aortic arch in patients with stroke. N Engl J Med 1992 ; 326 : 221-5.
3. Khatibzadeh M., Mitusch R., Stierle U. et coll. Aortic atherosclerotic plaques
as a source of systemic embolism. J Am Coll Cardiol 1996 ; 27 : 664-9.
4. Vaduganathan P., Ewton A., Nagueh S.F. et coll. Pathologic correlates of aor-
tic plaques, thrombi and mobile “aortic debris” imaged in vivo with transeso-
phageal echocardiography. J Am Coll Cardiol 1997 ; 30 : 357-63.
5. Amarenco P., Cohen A., Tzourio C. et coll. Atherosclerotic disease of the aor-
tic arch and the risk of ischemic stroke. N Engl J Med 1994 ; 331 : 1474-9.
6. The French Study of Aortic Plaques in Stroke Group. Atherosclerotic disease
of the aortic arch as a risk factor for recurrent ischemic stroke. N Engl J Med
1996 ; 334 : 1216-21.
7. Montgomery D.H., Ververis J.J., McGorisk G. et coll. Natural history of
severe atheromatous disease of the thoracic aorta : a transesophageal echocar-
diographic study. J Am Coll Cardiol 1996 ; 27 : 95-101.
8. Ferrari E., Taillan B., Drai E. et coll. Investigation of the thoracic aorta in
cholesterol embolism by transesophageal echocardiography. Heart 1998 ; 79 :
133-6.
9. Cohen A., Tzourio C., Bertrand B. et coll. Aortic plaque morphology and vas-
cular events. A follow-up study in patients with ischemic stroke. Circulation
1997 ; 96 : 3838-41.
10. Fernandez-Ortiz A., Badimon J.J., Falk E. et coll. Characterization of the
relative thrombogenicity of atherosclerotic plaque components : implications for
consequences of plaque rupture. J Am Coll Cardiol 1994 ; 23 : 1562-9.
11. Laperche T., Laurian C., Roudaut R. et coll. Mobile thromboses of the aortic
arch : a transesophageal echocardiographic finding associated with unexplained
arterial embolism. Circulation 1997 ; 96 : 288-94.
12. Tribouilloy C., Peltier M., Colas L. et coll. Multiplane transesophageal echo-
cardiographic absence of thoracic aortic plaque is a powerful predictor for
absence of significant coronary artery disease in valvular patients, even in the
elderly. Eur Heart J 1997 ; 18 : 1478-83.
13. Le Roux A., Carville C., Guéret P. Peut-on prédire de façon non invasive la
maladie coronaire chez des patients porteurs de valvulopathie ? Sang Thromb
Vaiss 1997 ; 9 :346-53.
14. Karalis D.G., Quinn V., Victor M.F. et coll. Risk of catheter-related emboli in
patients with atherosclerotic debris in the thoracic aorta. Am Heart J 1996 ; 131 :
1149-55.
15. The Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators Committee on
Echocardiography. Transesophageal echocardiographic correlates of throm-
boembolism in high-risk patients with non valvular fibrillation. Ann Intern Med
1998 ; 128 : 639-47.
16. Stern A., Tunick P.A., Culliford A.T. et coll. High risk of stroke and death
during heart surgery in patients with protruding aortic arch atheromas (abstract).
Circulation 1997 ; 96 : I102-3.
La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999
29
DOSSIER
.../...

La Lettre du Cardiologue - n° 313 - mai 1999
30
DOSSIER
17. Gandjbakhch I., Jault F., Rama A. Faut-il effectuer l’exérèse des plaques
d’athérothrombose aortique ? Arch Mal Cœur 1997 ; 90 (II) : 25-8.
18. Tunick P.A., Rosenzweig B.P., Katz E.S. et coll. High risk for vascular events
in patients with protruding aortic atheromas : a prospective study. J Am Coll
Cardiol 1994 ; 23 : 1085-90.
19. Ferrari E., Vidal R., Chevalier T. et coll. Atherosclerosis of the thoracic aorta
as a marker of poor prognosis. Benefit of oral anticoagulants (abstract).
Circulation 1997 ; 96 : I185.
20. Dressler F.A., Craig W.R., Castello R. et coll. Mobile aortic atheroma and
systemic emboli : efficacy of anticoagulation and influence of plaque morphology
on recurrent stroke. J Am Coll Cardiol 1998 ; 31 : 134-8.
21. Blackshear J.L., Pearce L.A., Zabalgoitia M. Low risk of cholesterol crystal
embolization during warfarin therapy in patients with aortic plaque. Circulation
1998 ; 98 : I101.
22. Tomochika Y., Okuda F., Tanaka N. et coll. Improvement of atherosclerosis and
stiffness of the thoracic descending aorta with cholesterol-lowering therapies in
familial hypercholesterolemia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1996 ; 16 : 955-62.
23. Fazio G.P., Redberg R.F., Winslow T., Schiller N.B. Transesophageal echo-
cardiographically detected atherosclerotic aortic plaque is a marker for corona-
ry artery disease. J Am Coll Cardiol 1993 ; 21 : 144-50.
24. Ribakove G.H., Katz E.S., Galloway A.C. et coll. Surgical implications of
transesophageal echocardiography to grade the atheromatous aortic arch. Ann
Thorac Surg 1992 ; 53 : 758-63.
Athérome de la crosse aortique
1. À propos des plaques athéromateuses de la crosse aortique, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?
a.
les plaques dont l’épaisseur est ≥4 mm ont un risque plus élevé de complications cardiovasculaires que les plaques d’épais-
seur moindre
b.ce sont les plaques calcifiées qui exposent au risque de complications le plus important
c.le caractère hypoéchogène d’une plaque est un facteur péjoratif pour le pronostic
d.les calcifications sont absentes des plaques d’une épaisseur ≥4 mm
e.les données de l’échographie transœsophagienne sont bien corrélées aux données histologiques
2. Concernant la prise en charge de l’athérome aortique, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?
a.les études randomisées ont montré l’intérêt du traitement anticoagulant dans la prévention des complications
b.le bénéfice des anticoagulants oraux pourrait être supérieur à celui des anti-agrégants plaquettaires
c.le traitement anticoagulant oral est contre-indiqué du fait du risque d’embolies de cholestérol
d.l’exérèse chirurgicale représente la solution idéale pour prévenir les complications de l’athérome aortique
e.la chirurgie d’exérèse peut être proposée dans certaines thromboses pédiculées de la crosse
Réponses FMC : 1. a, c, e ; 2. b, e.
AUTOQUESTIONNAIRE
FMC
Les articles publiés dans
“La Lettre du Cardiologue”
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de reproduction, d'adaptation
et de traduction par tous procédés
réservés pour tous pays.
© mai1983 - EDIMARK S.A.
Imprimé en France
Differdange S.A. - 95110 Sannois
Dépôt légal 2etrimestre 1999
RECTIFICATIF
Nous désirons rectifier le texte de la page “Rendez-vous
français” de l’ACC, La Lettre du Cardiologue n° 311 - avril
1999, p. 9.
L’opération “Cartes postales” a été réalisée en partenariat
avec Bayer Pharma.
1
/
5
100%