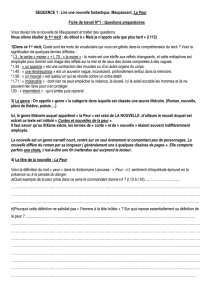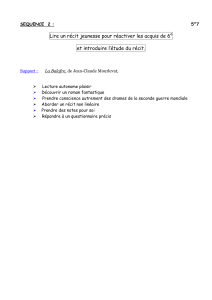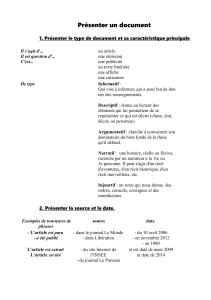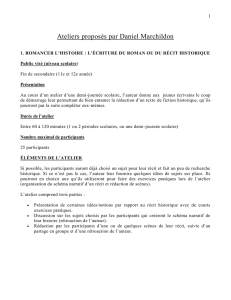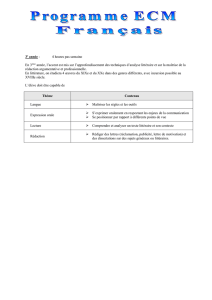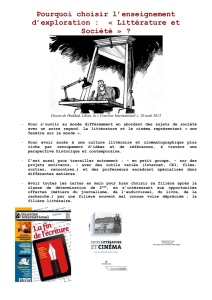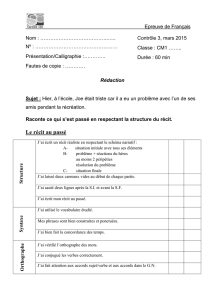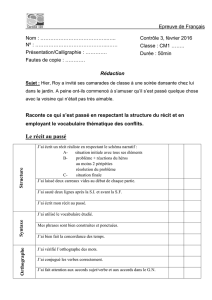De l'intérêt E

La Lettre du Rhumatologue - n° 239 - février 1998
30
a littérature (surtout le roman, pour simplifier) peut-elle aider le
médecin dans sa pratique ? Oui, pour aimer prendre le temps de sus-
citer les questions et écouter avec intérêt l'histoire des malades.
Le roman est le genre littéraire où domine la narration, l'action de déployer
un récit le long d'une expérience temporelle. La narration dite littéraire et la
narration médicale (recueil écrit de cas ou consultation orale) constituent
toutes deux des récits. Toutefois, l'usage du langage obéit à des stratégies dif-
férentes pour narrer un cas médical du point de vue du médecin ou pour se
raconter du point de vue de celui qui souffre, qui est malade.
En termes de récit médical, les symptômes recueillis par le médecin sont des
péripéties qui se déroulent en trois temps (le passé, ou anamnèse, le présent
ou diagnostic et traitement, le futur ou pronostic). Souvent, le savoir ou le
savoir-faire du médecin suffisent pour saisir des repères sémiologiques, les
grouper, les interpréter et pour nommer telle maladie. C'est l'opération men-
tale du passage d'un ensemble de phénomènes subjectifs du côté du malade
vers le diagnostic objectif du côté du médecin qui représente la fameuse objec-
tivation médicale que Roland Barthes nommait “la conscience objectivante du
médecin”.
Mais que se passe-t-il quand les phénomènes de la plainte ne sont ni pen-
sables, ni classifiables par le médecin, échappant ainsi à la logique de l'ana-
tomie et de la physiologie ? On pense au “nervosisme” cher au siècle dernier,
et à toutes les plaintes dites fonctionnelles qui sont des signes du corps, par-
fois des symptômes d'une douleur d'un autre ordre. Telle est la souffrance du
plus grand nombre qui s'adresse chaque jour à la médecine et ne cesse de la
mettre en échec.
Depuis des siècles, le récit littéraire nous entretient de cette souffrance-là. En
effet, il nous raconte soit ce qui échappe à la nosographie médicale (le mal-
aise, le mal-être), soit le point de vue du malade sur la maladie nommée au
sens de la science. Un exemple : quelle différence entre le récit médical d'un
cas de cancer ou de sida dans un traité de pathologie et les récits littéraires
sur le même thème ? Eh bien, c'est un changement de point de vue, une orien-
tation différente du regard. L'un n'annule pas la valeur de l'autre : l'un est dif-
férent de l'autre. Les deux discours ne sont pas du même ordre. Le récit litté-
raire d'un être souffrant révèle au discours médical la limite de son regard,
son aporie.
De nos jours, ces deux regards différents ne peuvent plus s'ignorer. En effet,
si le discours littéraire s'est toujours emparé du discours des sciences et de la
médecine, l'inverse n'est plus vrai depuis que la médecine multiplie ses tech-
niques et remporte des succès considérables. Le récit du patient, en dehors des
renseignements essentiels au diagnostic (souvent recueillis en cochant des
cases sur un questionnaire standard), n'a plus vraiment cours en médecine. Il
est jugé superflu ou sans valeur pour le pronostic et le traitement. Cet efface-
ment de la parole du malade ne fait que croître depuis environ un siècle. La
valeur du langage est alors confiée à la psychiatrie et à la psychanalyse. On
ne manquera pas de nous objecter que l'écoute est meilleure chez les méde-
cins de famille, ceux qui ont fait des études classiques, ou ceux qui pratiquent
les groupes Balint. Certes, mais ils sont peu nombreux. Cette objection ne tient
pas, car nous sommes tous formés dans l'institution hospitalière qui imprime
l'ordre de son discours sur le corps médical entier.
La médecine ne nous apprend pas qu'il revient en définitive au malade, à son
désir secret (une histoire personnelle dans un entourage de vivants et de
EXPRESSION
De l'intérêt
de la lecture
littéraire
pour la pratique
médicale
La souffrance ne peut être tue,
elle appelle le récit.
Paul Ricœur
G. Danou*
* Rhumatologue, Centre de traitement de
la douleur, CH Gonesse,
et Département de littérature française,
Université Paris VIII, Paris.
L

La Lettre du Rhumatologue - n° 239 - février 1998
31
morts), de décider de guérir, de rester malade, ou parfois de mourir. Tel cet
exemple récent : une dame âgée est hospitalisée pour un cancer avancé. Elle
sait parfaitement son état, et s'éteint rapidement, bien que les marqueurs
biologiques de sa maladie soient redevenus normaux. Qu'en penser ? Certains
se sont étonnés d'une telle discordance. Il aurait pourtant suffi de considérer
sur le même plan d'importance tant la démarche médicale que la biographie
pour comprendre, sans ressentir d'échec, que la patiente n'espérait plus rien
de sa vie.
Toutefois, on observe depuis quelques années (peut-être avec le sida) le besoin
exprimé de réfléchir sur une pratique de la médecine par l'étude de la philo-
sophie et des sciences humaines. Certains, aux États-Unis, proposent des
cours sur “littérature et médecine” pour la formation éthique du médecin
(Brody, 1987 et la revue “Literature and medicine”, John Hopkins University
Press, Baltimore, 1987) (1). Mais l'enseignement de la littérature en médecine
ne va pas sans quelques précautions. La littérature n'est pas la réalité, mais
elle peut permettre de mieux la comprendre en offrant un regard critique que
le quotidien ne laisse pas le temps de saisir. Le roman double et prolonge l'ex-
périence de la vie. L'expérience du livre enrichit l'épreuve de la réalité. En
explorant une multiplicité de mondes possibles, la littérature serait pour cer-
tains une science du vivre. En effet (rien n'est banal si on veut bien y porter
attention), comment oser de nos jours, dans un grand centre anticancéreux
parisien, faire entrer directement en slip dans la salle de consultation des
hommes et des femmes tenaillés par la peur de la maladie grave et de la mort ?
Oui, comment oser cela et avancer, pour se disculper, l'argument du manque
de temps ? Quelle méconnaissance et quel mépris des autres et de soi pour
accepter une telle pratique ! Ceci, la littérature ne cesse de le dénoncer. C'est
sa force.
On comprend alors que la pratique assidue de la lecture puisse favoriser
l'écoute des malades, eux qui n'enseignent pas seulement un savoir technique
mais un savoir humain. Ce savoir sur soi-même à travers les autres est fonda-
mental, car il revient au médecin de se représenter, comme le disait Georges
Canguilhem : “qu'il est un malade potentiel et qu'il n'est pas mieux assuré que
ne le sont ses malades de réussir, le cas échéant, à substituer ses connais-
sances à son angoisse”.
Le médecin agit contre la défaillance des corps. La pratique de la littérature
affine la qualité de son écoute des malades. Elle implique aussi le médecin
dans la question que les écrivains contemporains ne cessent d'explorer : qui
sommes-nous, et que devons-nous faire en pratique, entre l'histoire passée,
notre histoire personnelle et l'histoire en train de se dérouler ? ❏
De l'intérêt
de la lecture
littéraire
pour la pratique
médicale
La souffrance ne peut être tue,
elle appelle le récit.
Paul Ricœur
(1) Un enseignement sur “médecine et littérature” est aussi dispensé par nos soins à
la faculté de médecine de Bobigny (Paris-Nord).
Lire sur ce thème :
•Danou G. Le corps souffrant, littérature et médecine. Champ Vallon, 1994.
•Danou G., Olivier A. Anthologie littéraire à l'usage des étudiants en médecine.
Éd. Ellipses, Paris (à paraître début 1998).
1
/
2
100%