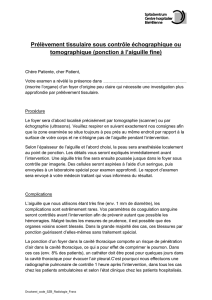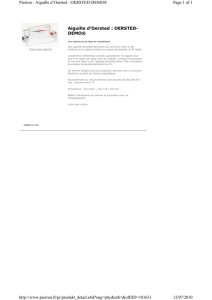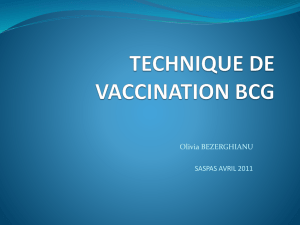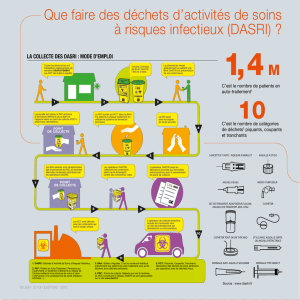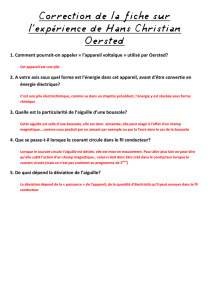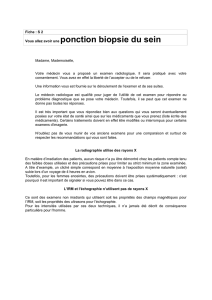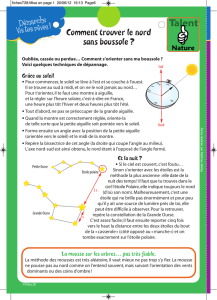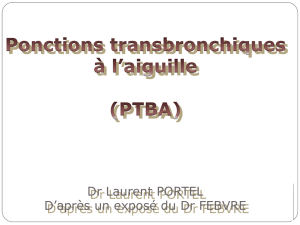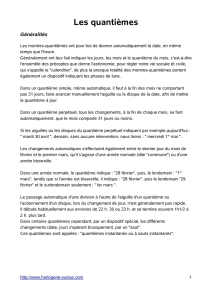S o m m a i r e Radiologie interventionnelle Scanner

Sommaire
37
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
!
!
Scanner et IRM
D. Buthiau*, J.P. Spano**, S. Taillibert**,
D. Nizri**, D. Coeffic**, D. Khayat**
T
OMODENSITOMÉTRIE INTERVENTIONNELLE
Biopsies percutanées guidées
par tomodensitométrie
(8)
Les biopsies percutanées des lésions circons-
crites guidées par l’imagerie représentent une
acquisition fondamentale qui ajoute la spécifi-
cité diagnostique à la sensibilité de détection
élevée qui est le propre de l’imagerie en coupe.
Par sa précision anatomique la tomodensito-
métrie se prête tout particulièrement au gui-
dage des biopsies percutanées. Les appareils
actuels offrent les conditions requises pour une
technique sûre et rapide. L’ouverture large et
évasée du châssis détermine le point de ponc-
tion cutané et le contrôle millimétrique des
déplacements de la table d’examen fait retrou-
ver le plan de coupe souhaité. La revue rapide
des images et l’acquisition volumique rédui-
sent le temps de la procédure. L’écran de télé-
vision disponible à l’intérieur de la salle d’exa-
men permet à l’opérateur de rester tout le
temps à proximité de son patient (8). Le radio-
logue doit disposer d’une liberté décisionnelle
vis-à-vis des autres médecins pour indiquer un
prélèvement percutané en connaissance de
l’ensemble du dossier médical et de l’effectuer
le plus souvent possible au cours de l’examen
diagnostique même. Cette démarche réduit le
temps d’attente du diagnostic définitif et les
coûts de santé.
Indications
Toute image d’allure tumorale, mais non patho-
gnomonique, peut faire l’objet d’une confirma-
tion de sa nature par prélèvement percutané.
Les indications générales peuvent être schéma-
Radiologie
interventionnelle
Scanner
et IRM
T
OMODENSITOMÉTRIE
INTERVENTIONNELLE
IRM
INTERVENTIONNELLE
Échographie
(Pelvis féminin et pathologie
cardiovasculaire exclus)
G
ÉNÉRALITES
O
RGANES SUPERFICIELS
P
ATHOLOGIE OSTÉO
-
ARTICULAIRE
T
HORAX
A
BDOMEN
D
RAINAGE PERCUTANÉ
DES ABCÈS HÉPATIQUES
R
EIN
:
LA NÉPHROSTOMIE
PERCUTANÉE
(NPC)
P
ROSTATE
C
ONCLUSION
Angioplastie
transluminale
(Artérites des membres
inférieurs)
A
RTÉRIOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE
T
RAITEMENT ENDOVASCULAIRE
C
OMPLICATIONS DES TECHNIQUES
ENDOVASCULAIRES
R
ÉSULTATS DE L
’
ANGIOPLASTIE
S
URVEILLANCE À LONG TERME APRÈS
ANGIOPLASTIE
C
ONCLUSION
Ce dossier a été soumis à un comité de lecture
composé de médecins généralistes,
de spécialistes universitaires et libéraux.
* Centre d’imagerie RMX, Paris.
** SOMPS, Paris.
dossier

tisées de la façon suivante, sans tenir compte
d’indications particulières spécifiques aux dif-
férents organes :
•
•image d’allure tumorale maligne primitive
(figure 1) : la confirmation du diagnostic est pri-
mordiale si une radiothérapie ou une chimio-
thérapie sont envisagées préalablement à la
résection chirurgicale ou, en cas de tumeur
dépassée, quand le traitement sera palliatif uni-
quement. La confirmation du diagnostic de
malignité peut éclairer aussi certains patients
jusque là résistants à une intervention chirurgi-
cale exploratrice ;
•
•métastase(s) pulmonaire(s), hépatique(s),
ganglionnaire(s), osseuse(s), ou autres locali-
sations (figure 2). Trois éventualités se présen-
tent :
– la tumeur primitive est connue, mais la ou les
métastases sont de localisation inhabituelle
pour ce type de cancer ;
– le patient présente plusieurs tumeurs primi-
tives concomitantes ou un cancer et un lym-
phome ou une hémopathie maligne ;
– le patient est en rémission clinique ;
•
•image d’allure tumorale qui persiste après
régression initiale de la lésion sous l’effet d’une
chimiothérapie ou d’une radiothérapie. La
lésion est-elle stérilisée ou contient-elle encore
des cellules tumorales ? Un exemple type est
représenté par les métastases pulmonaires des
tumeurs germinales ;
•
•diagnostic différentiel entre tumeur bénigne
et métastase pour un organe qui est fréquem-
ment le siège de tumeurs bénignes solides. Les
glandes surrénales sont fréquemment coloni-
sées par des métastases de cancer bronchique,
et sont aussi le siège d’adénomes non fonction-
nels chez 7 % de la population ;
•
•image de tumeur bénigne atypique : les méta-
stases nécrotiques pseudokystiques, les cyst-
adénocarcinomes biliaires ou pancréatiques,
ou les hypernéphromes pseudokystiques sont
des exemples de tumeurs pouvant évoquer un
kyste bénin. Un autre exemple est représenté
par le diagnostic différentiel entre hépatocarci-
nome et nodule dysplasique ou de régénéra-
tion ;
•
•prélèvement pour dosage des récepteurs hor-
monaux, de cytométrie ADN ou pour des tests
de sensibilité thérapeutique in vitro ;
•
•repérage préopératoire au harpon de nodules
pulmonaires avant résection, sous contrôle
pleuroscopique (20).
Contre-indications
Elles sont d’ordre général pour les biopsies per-
cutanées abdomino-pelviennes, pour autant
que le diamètre de l’aiguille reste inframillimé-
trique. Les ponctions transdigestives sont auto-
risées lors d’un accès antérieur de lésions pro-
fondes, mais le risque infectieux augmente lors
de la traversée de segments digestifs distaux.
Quand une tumeur hépatique hypervascularisée
est biopsiée, du tissu sain doit rester interposé
entre la capsule et la lésion pour éviter des com-
plications hémorragiques. La plupart des
contre-indications relatives concernent les biop-
sies pulmonaires : poumon unique, infarctus
myocardique récent, emphysème pulmonaire
diffus ou bulles emphysémateuses s’interpo-
sant sur le trajet de l’aiguille, hypertension arté-
rielle pulmonaire, insuffisance cardiaque, venti-
lation artificielle, etc. Avant toute ponction, un
kyste hydatique ou des structures vasculaires
normales ou pathologiques doivent être recon-
nus. Toute anomalie de coagulation, spontanée
ou entretenue par médication, doit être corrigée
avant la ponction. La collaboration du patient
doit être optimale : la dyspnée, le hoquet, la
douleur et l’angoisse peuvent représenter des
facteurs limitatifs à la réalisation du prélève-
ment percutané. L’information concise sur l’ob-
jectif et le déroulement de la procédure est la
meilleure garante pour s’assurer la coopération
du patient.
Technique
La réalisation d’un examen tomodensitomé-
trique avant et après injection de produit de
contraste est indispensable avant toute ponc-
tion percutanée d’un processus circonscrit.
L’opacification sert à :
– reconnaître une structure vasculaire normale,
anévrismale, pseudo-anévrismale ou une fis-
tule artérioveineuse ;
– établir le diagnostic d’angiome typique sur la
base d’un comportement dynamique caracté-
ristique de la captation du produit de contraste,
rendant superflu le prélèvement percutané ;
– reconnaître des cloisons et des épaississe-
ments pariétaux dans une tumeur d’allure kys-
tique, en sachant que l’échographie est supé-
rieure à la tomodensitométrie ;
– apprécier le degré de vascularisation de la
lésion qui détermine le choix de l’aiguille de
ponction ;
38
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
dossier
Figure 1. Tumeur hilaire pulmonaire
droite de 3 cm. Prélèvement
fibroscopique transbronchique négatif.
Prélèvement percutané (flèche) sous
contrôle scanographique par un abord
axillaire droit : épithélioma bronchique
indifférencié ou anaplasique.
Figure 2. Adénopathie de la chaîne
iliaque droite, responsable d’une
empreinte vésicale. Biopsie percutanée
sous contrôle scanographique par un
abord transglutéal (flèche). Métastase
ganglionnaire de cancer du col de
l’utérus réséqué.

– identifier les zones de nécrose tumorale cen-
trale qui sont à éviter par l’aiguille ;
– reconnaître l’environnement immédiat anato-
mique de la cible et des structures vasculaires,
nerveuses ou viscérales à éviter.
Les prélèvements percutanés guidés par tomo-
densitométrie sont préférentiellement effec-
tués dans un plan axial transverse suivant une
approche perpendiculaire ou parallèle au plan
de la table d’examen. Cette façon de faire rend
superflue l’utilisation de dispositifs goniomé-
triques ou de tout autre système de mesure
d’angulation et permet d’effectuer tous les pré-
lèvements viscéraux à main levée. Le point de
ponction cutané est déterminé de telle façon
que le trajet interne soit le plus court possible
et traverse le moins de compartiments anato-
miques ou d’organes différents avant d’at-
teindre sa cible.
Devant une tumeur dont le haut degré de mali-
gnité est suspecté, le trajet de ponction est pla-
nifié de telle façon qu’il pourra être inclus dans
une éventuelle résection en bloc ultérieure. Le
système de repérage au laser matérialise sur la
peau du patient le point de coupe qui contien-
dra le trajet de ponction. Le point de ponction
cutané est matérialisé par une aiguille qui est
placée perpendiculairement au plan de coupe,
lui-même tracé au feutre sur la peau.
L’intersection de l’aiguille et du plan de coupe
détermine le point d’entrée cutané. Les plans
cutanés et sous-cutanés sont anesthésiés. La
progression intraparenchymateuse de l’aiguille
souple est quasi indolore. Seuls le diaphragme,
les neurinomes ou certaines tumeurs s’accom-
pagnant d’une réaction inflammatoire impor-
tante sont douloureux à la ponction. La ponc-
tion des nerfs sciatiques réveille des douleurs
identifiées par leur irradiation. L’extrémité de
l’aiguille est reconnue par une hypodensité
distale.
Le choix de l’aiguille de ponction est déterminé
ensemble par le radiologue et le cytologiste ou
l’anatomopathologiste, de même que la tech-
nique d’étalement du matériel sur lames et les
procédés de fixation des fragments histolo-
giques. Le changement fréquent du type d’ai-
guille utilisé est inutile, car le rendement des
différentes aiguilles fines disponibles est équi-
valent (10). Les aiguilles les plus simples don-
nent d’excellents résultats (5). En revanche, le
radiologue aura à sa disposition plusieurs
types d’aiguilles différents pour les biopsies
viscérales, les lésions à forte cohérence cellu-
laire comme les sarcomes, ou à forte stroma-
réaction, et pour les biopsies osseuses. Quand
un pistolet automatique est utilisé, l’avance de
la longueur de l’aiguille doit être inférieure au
diamètre de la lésion. Ces dispositifs ont l’avan-
tage de donner des prélèvements de qualité
constante (2). En pratique, on note les ten-
dances suivantes : l’utilisation d’aiguilles dont
le diamètre varie autour de 18 G et dont la confi-
guration de l’extrémité permet le recueil simul-
tané de matériel histologique et cytologique, la
multiplication des passages de l’aiguille, qui
sont de l’ordre de 3 à 4, et la pratique des pré-
lèvements en ambulatoire après une sur-
veillance du patient de 1 à 4 heures. À côté des
passages multiples à main levée, les tech-
niques en tandem ou coaxiale sont utilisées :
– la technique en tandem consiste à insérer plu-
sieurs aiguilles identiques et de même lon-
gueur au voisinage immédiat et suivant un tra-
jet parallèle à la première aiguille, dont la
bonne position à l’intérieur de la lésion a été
vérifiée préalablement en tomodensitométrie.
Cette technique est particulièrement utile pour
réaliser rapidement des prélèvements multiples
dans une lésion de petite taille difficile à repé-
rer, comme dans le pancréas par exemple (16) ;
– la technique coaxiale consiste à insérer une
aiguille de diamètre plus réduit à travers une
première aiguille déjà en place, ce qui facilite
des prélèvements répétés à l’intérieur de la
cible sans répéter le repérage (17). Cette tech-
nique est utile pour les biopsies pulmonaires,
l’aiguille coaxiale externe étant amenée jus-
qu’au contact de la plèvre seulement. Il suffit
alors d’introduire l’aiguille de petit calibre dans
la lésion pulmonaire, dans la bonne direction
qui est matérialisée par l’aiguille coaxiale
externe.
Résultats
Les biopsies hépatiques, pulmonaires, surréna-
liennes et osseuses sont le plus fréquemment
réalisées en oncologie et ont une précision dia-
gnostique de 90 à 95 % pour la mise en évi-
dence d’une tumeur maligne. Le rendement est
de 85 % pour les lésions pancréatiques (18). La
valeur prédictive positive d’un prélèvement per-
cutané est de l’ordre de 98 %, les faux diagnos-
tics positifs étant rares. Le rendement des pré-
39
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
Vous pouvez consulter
les images du dossier
sur notre site :
http://www.edimark.fr

lèvements percutanés est fortement influencé
par la taille de la lésion. Les biopsies à l’aiguille
fine d’hépatocarcinomes d’un diamètre com-
pris entre 1 et 2 cm sont faussement négatives
dans 50 % des cas. La confirmation d’une réci-
dive lymphomateuse est relativement aisée,
mais il est difficile d’affirmer le diagnostic et de
typer un lymphome malin hodgkinien ou non
hodgkinien sur la base d’un prélèvement percu-
tané (8, 17). Les lymphomes à très forte stro-
maréaction, ainsi que les déterminations hodg-
kiniennes pauci-cellulaires, nécessitent des
résections tissulaires larges pour le typage
précis.
Complications
Les complications cliniquement significatives
résultant des biopsies percutanées à l’aiguille
fine sont rares. Deux revues de près de 65 000
patients ont documenté un taux global de com-
plications de 0,1 à 0,5 %, un taux de complica-
tions majeures de 0,05 % et un taux de morta-
lité de 0,008 % (13, 22). Les complications les
plus redoutées sont la pancréatite aiguë
hémorragique, l’hémorragie intrapéritonéale, la
péritonite biliaire et le sepsis. L’observation
d’une technique rigoureuse est primordiale
dans la prévention des complications. Le dépôt
de métastases dans le trajet de ponction ou à la
peau résulte d’un nombre de ponctions élevé
(supérieur à dix) et de l’utilisation d’un disposi-
tif de ponction de gros calibre (16 ou 14 G).
Neurolyse percutanée du plexus solaire
et des nerfs splanchniques
(8)
Grâce à sa résolution élevée, la tomodensito-
métrie est mise à profit pour guider l’injection
de substances neurolytiques dans les struc-
tures qui véhiculent les fibres sensitives tho-
raco-abdominales. La neurolyse du plexus
solaire et des nerfs splanchniques, le blocage
du ganglion stellaire et l’infiltration de la chaîne
sympathique thoracique et lombaire ainsi que
du plexus sacré sont préférentiellement réali-
sés sous contrôle tomodensitométrique. Nous
nous limitons à la description de la neurolyse
du plexus solaire percutanée sous contrôle
tomodensitométrique (9, 12).
Indications
Les ganglions semi-lunaires reçoivent des fibres
sensitives des organes de l’abdomen supérieur
(pancréas, foie, voies biliaires, rate, estomac).
Leur neurolyse ou celle des nerfs splanchniques
est indiquée dans le traitement des douleurs
émanant de tumeurs siégeant dans ces organes
ou qui infiltrent directement les structures ner-
veuses. Le cancer corporéal du pancréas est le
meilleur modèle descriptif. L’envahissement
tumoral direct de l’espace rétropéritonéal
médian préaortique ou la réaction desmoplas-
tique autour des structures nerveuses sont res-
ponsables des douleurs dites “solaires” que le
patient situe profondément dans l’abdomen
avec leur irradiation postérieure classique.
Technique
Elle est fondée sur les constatations radio-ana-
tomiques (6). Les ganglions du plexus solaire
sont situés de part et d’autre de la ligne
médiane, entre l’émergence du tronc cœliaque
et de l’artère mésentérique supérieure, et res-
tent en contact constant avec ces artères. Les
nerfs splanchniques forment un tronc commun
qui résulte de la convergence de filets nerveux
à la hauteur de D11. Ils sont situés dans l’es-
pace graisseux, de chaque côté de l’aorte, der-
rière les piliers du diaphragme. Pour la neuro-
lyse percutanée du plexus solaire, le patient, à
jeun, est placé en décubitus dorsal. Le niveau
D12 est repéré par radiographie digitalisée de
l’abdomen. L’émergence aortique du tronc
cœliaque et de l’artère mésentérique supé-
rieure est reconnue après injection intravei-
neuse de produit de contraste. Une aiguille de
22 G est introduite par voie transabdominale
antérieure, au niveau du plan de coupe qui
contient la racine du tronc cœliaque.
L’extrémité de l’aiguille est avancée au contact
de la face antérieure de l’aorte abdominale
(figure 3). La traversée du parenchyme pan-
créatique sain est évitée. La traversée des
parois gastriques doit être réalisée avec une
ponction franche, car l’aiguille de type Chiba
est déviée facilement par les parois de l’esto-
mac. Un à 3 ml de produit de contraste dilué
sont injectés à travers l’aiguille. La stase du
contraste autour de l’extrémité de l’aiguille est
attestée par des coupes de contrôle. Si la pro-
cédure est réalisée en période non algique ou si
le patient reste sous médication antalgique au
moment de la procédure, 1 à 3 ml d’éthanol
absolu sont injectés à travers l’aiguille. Cette
injection provoque les douleurs habituelles et
40
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
dossier
Figure 3 a. Cancer du pancréas respon-
sable de douleurs solaires rebelles aux
médications antalgiques.
L’examen scanographique après
injection intraveineuse en bolus
de produit de contraste situe le niveau
d’émergence du tronc cœliaque
(flèche).
b. Diffusion préaortique de 40 ml
d’éthanol absolu injecté au contact de
la racine d’émergence du tronc
cœliaque (l’éthanol se traduit par les
densités négatives).
À noter : l’approche percutanée trans-
viscérale antérieure (flèche) et la diffu-
sion de l’éthanol de part et d’autre de
l’émergence du tronc cœliaque.
a.
b.

confirme la bonne position de l’extrémité de
l’aiguille. Ensuite, 10 ml de xylocaïne à 1 % sont
injectés à travers l’aiguille. Les douleurs doi-
vent être calmées instantanément. Vingt-cinq
ml d’éthanol sont alors injectés à travers l’ai-
guille. L’injection est répétée en plaçant l’ai-
guille de l’autre côté du tronc cœliaque si la dif-
fusion controlatérale de l’éthanol n’a pas été
satisfaisante. Avant toute injection d’éthanol,
une aspiration prolongée à la seringue est
nécessaire pour s’assurer que l’extrémité de
l’aiguille ne se trouve pas dans la lumière d’un
vaisseau. Les coupes de contrôle démontrent la
diffusion locale de l’éthanol par des densités
négatives en avant de l’aorte de part et d’autre
de la ligne médiane. La voie d’accès percutanée
postérolatérale est beaucoup moins confor-
table pour le patient qui est placé en procubi-
tus. La neurolyse des nerfs splanchniques, en
revanche, doit être pratiquée par un abord pos-
térieur, latérorachidien au niveau D11. Quinze à
20 ml d’éthanol sont injectés pour chaque côté.
Résultats
La neurolyse du plexus solaire entraîne un effet
antalgique subjectif et une diminution de la
prise médicamenteuse dans 87 % des cas (9).
Les causes d’échec de la procédure sont liées
au positionnement incorrect de l’aiguille trop à
distance des ganglions solaires, une diffusion
trop latérale et rétropéritonéale ou antérieure
de l’éthanol, une quantité d’éthanol injecté
insuffisante, la régénération des fibres ner-
veuses démyélinisées, la progression de la
tumeur sous-jacente et l’emprunt d’autres
voies sensitives.
Complications
Les complications sont habituellement mineures
et ne nécessitent pas de traitement particulier.
La résorption veineuse rapide de l’éthanol peut
se traduire par une alcoolémie et des expres-
sions cliniques variables. La libération du frein
vasomoteur de la circulation splanchnique peut
provoquer une hypotension systémique passa-
gère par afflux de sang dans le territoire mésen-
térique et oblige à garder les patients plusieurs
heures en observation après la procédure. Nous
avons observé chez quelques patients une diar-
rhée motrice persistant pendant 2 à 3 mois. La
diffusion trop antérieure de l’éthanol peut irriter
le péritoine pariétal postérieur et réveiller une
péritonite chimique, modérée et transitoire se
traduisant par un iléus. Les autres complications
liées à la technique percutanée sont évitées par
l’application d’une technique soigneuse sous
contrôle tomodensitométrique. Il est exception-
nel d’observer une pancréatite, un pneumotho-
rax, un hémothorax ou une perforation digestive.
Autres procédures interventionnelles
(8)
"
"La tomodensitométrie est utilisée occasion-
nellement comme moyen de guidage pour l’im-
plantation percutanée de sources radioactives
dans le traitement de récidive tumorale locale
ou de lésion résiduelle de cancer mammaire ou
bronchique au niveau de la paroi thoracique par
exemple et pour en apprécier les résultats, y
compris au niveau du foie (14). La tomodensito-
métrie peut également servir à diriger l’implan-
tation transpérinéale d’implants radioactifs
pour le traitement local du cancer de la prostate
(figure 4).
"
"Le suivi thérapeutique d’autres procédures
qui sont réalisées couramment soit par cathété-
risme artériel, soit sous contrôle échogra-
phique est obtenu par contrôle tomodensito-
métrique. Il s’agit du traitement percutané
d’hépatocarcinome par injection d’éthanol
absolu, ou d’application de sondes de cryothé-
rapie, de sondes laser pour ablation thermique,
d’ultrasons de haute énergie ou de sondes
d’électrocoagulation dans le traitement de
tumeurs hépatiques (1, 4, 11, 21, 23).
La tomodensitométrie montre le caractère
dévascularisé ou nécrosé des tumeurs après
traitement local ou, en cas de réactivation
tumorale, un rehaussement de la périphérie
nodulaire après injection de produit de
contraste ou des localisations tumorales satel-
lites au voisinage immédiat de la lésion traitée
(figure 5).
"
"La tomodensitométrie est utile pour établir la
cartographie de distribution d’une chimiothéra-
pie intra-artérielle (3). Avant toute infusion thé-
rapeutique au niveau du pelvis viscéral par
exemple, il est souhaitable de pratiquer un exa-
men artériotomodensitométrique par injection
de produit de contraste à travers les cathéters
d’infusion mis en place dans les deux axes
iliaques internes. Cet examen indique l’axe vas-
culaire qui est prédominant dans la vascularisa-
tion d’une tumeur située sur la ligne médiane et
confirme l’injection totale ou partielle de la
41
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
Figure 4. Implantation de sources
d’iode radioactif par voie percutanée
postérieure, le patient étant placé en
procubitus, dans un foyer de récidive
locale de cancer du rectum après résec-
tion chirurgicale. Étude du bassin mon-
trant la distribution des sources radio-
actives de topographie pelvienne
postérieures sur la ligne médiane.
Figure 5. a. Chimio-embolisation d’hé-
patocarcinome du lobe gauche du foie :
tumeur hypervasculaire développée
à partir de l’artère hépatique gauche
dans le segment 3.
b. Dévascularisation et nécrose
subtotale de la tumeur lors
d’un examen artérioscanographique
réalisé par injection du produit de
contraste dans l’artère hépatique,
après la cinquième cure, un an après
le début du traitement.
a.
b.
 6
6
1
/
6
100%