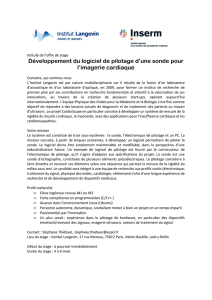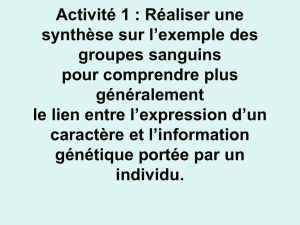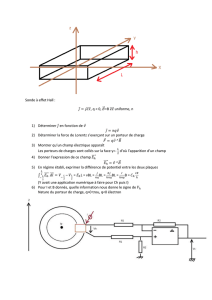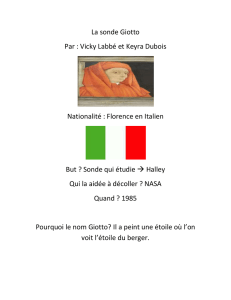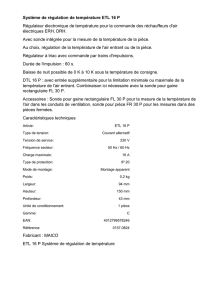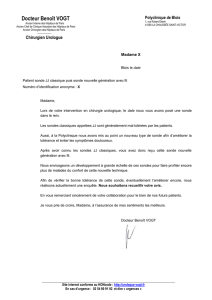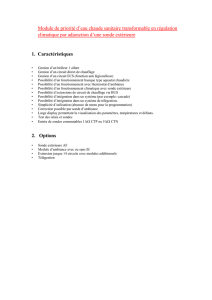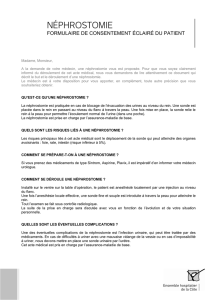Les dérivations urinaires “palliatives“ d “Palliative” urinary diversion

Dossier thématique
Dossier thématique
410
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007
Les dérivations urinaires “palliatives“
“Palliative” urinary diversion
●● M. Peyromaure*
* Service d’urologie, hôpital Necker, Paris.
RÉSUMÉ
Le terme de dérivation urinaire “palliative” s’applique à la
prise en charge urologique des compressions de l’appareil
urinaire par un cancer. Du fait de l’incidence croissante des
cancers, notamment urologiques, et du développement des
soins de support, les dérivations urinaires “palliatives” sont
de plus en plus nécessaires en pratique courante.
Cet article fait le point sur les diff érents procédés utilisés.
Mots-clés : Dérivations urinaires – Cancer.
▶SUMMARY
Urinary diversion is applied when urinary system is blocked
with a cancer. Because of enhancement in urologic
neoplasm, and supportive care development, palliative
urinary diversion are daily needed. This text is a review in
diff erent process.
Keywords: Urinary diversion – Cancer.
▶
L
e terme de dérivation urinaire “palliative” s’applique à la
prise en charge urologique des compressions de l’appareil
urinaire par un cancer. Il s’agit d’un drainage urinaire, soit
de la vessie lorsque l’obstacle tumoral est urétral, soit du rein
lorsque l’obstacle est urétéral. Du fait de l’incidence croissante
des cancers, notamment urologiques, et du développement des
soins de support, les dérivations urinaires “palliatives” sont de
plus en plus nécessaires en pratique courante. Paradoxalement,
elles sont peu décrites dans les congrès et la littérature médicale.
Cet article fait le point sur les diff érents procédés utilisés.
DÉRIVATION VÉSICALE
Généralités
Une dérivation de la vessie est nécessaire en cas de rétention
vésicale par compression ou envahissement de l’urètre. L’obs-
tacle est lié à une tumeur pelvienne : cancer prostatique, vésical,
rectal, utérin, etc.
La rétention vésicale par compression tumorale occasionne
rarement des douleurs, car il ne s’agit pas d’un obstacle aigu.
L’obstruction se fait sur un mode progressif, et ses principales
complications sont l’infection urinaire, l’incontinence par
regorgement et l’insuffi sance rénale. Ces complications ont
un impact non seulement sur la qualité de vie, mais également
sur le traitement du cancer lui-même. En eff et, la survenue
d’une complication, en particulier infectieuse, nécessite souvent
d’interrompre une chimiothérapie en cours ou de diff érer sa
mise en route.
Résection endoscopique “palliative“
Il s’agit du traitement de choix des obstacles urétraux. Sous
anesthésie générale ou rachianesthésie, l’intervention consiste à
réséquer, à l’aide d’un endoscope, le tissu tumoral obstructif. La
résection se fait à l’aide d’une anse métallique par laquelle passe
un courant électrique de section. Elle dure quinze à quarante-
cinq minutes, et nécessite une hospitalisation de deux à trois
jours.
Cette intervention est similaire à la résection endoscopique
réalisée classiquement pour l’hypertrophie bénigne de prostate,
mais le risque d’incontinence postopératoire est plus élevé (1).
En eff et, la tumeur infi ltre parfois le sphincter strié de l’urètre,
qui n’a pas une compliance normale. La résection risque donc
de démasquer un mauvais fonctionnement sphinctérien. Elle
doit être minimale, et doit simplement rétablir une lumière
urétrale. Un antécédent de radiothérapie pelvienne majore le
risque d’incontinence postopératoire.
Dans les tumeurs évoluées, la résection endoscopique “palliative”
doit souvent être répétée à plusieurs mois d’intervalle, du fait
de la repousse tumorale. Le risque d’incontinence augmente
avec le nombre de résections.
Endoprothèses urétrales
Les endoprothèses urétrales sont une autre possibilité que la
résection endoscopique, chez les patients inopérables. Ces endo-
prothèses se placent en consultation, sous anesthésie locale. Il
existe deux types d’endoprothèses : les prothèses permanentes
et les prothèses temporaires, qu’il faut changer régulièrement.
Ces prothèses sont surtout utilisées comme traitement des
rétrécissements de l’urètre et de l’hypertrophie bénigne de la
prostate. Leurs complications sont nombreuses : migration,
infections, troubles mictionnels.

Dossier thématique
Dossier thématique
411
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007
Leur place chez les patients présentant un obstacle tumoral est
très discutée, ce pour deux raisons. D’une part, l’urètre n’est
pas compliant en cas de cancer, et la mise en place de l’endo-
prothèse est la plupart du temps impossible. D’autre part, la
progression du cancer entraîne rapidement une incarcération
de la prothèse dans la tumeur, et celle-ci devient inextirpable.
Bien que quelques cas aient été publiés, l’endoprothèse urétrale
n’est donc pas recommandée dans cette indication.
Sonde vésicale et cathéter sus-pubien “à demeure“
Il s’agit du seul recours chez les patients inopérables ou en phase
terminale. Cette solution, le plus souvent, est bien tolérée par
les patients, et améliore de manière signifi cative leur qualité de
vie. L’extrémité libre de la sonde vésicale peut être fermée par un
fosset, ce qui évite le recours à une poche collectrice ; le patient
ouvre alors lui-même le fosset à intervalles réguliers pour évacuer
l’urine. La plupart du temps, cependant, la sonde est reliée à
une poche collectrice. Des poches avec attaches à la cuisse sont
disponibles afi n de faciliter la marche et les activités diurnes.
La sonde vésicale peut entraîner des douleurs urétrales ou
pelviennes (contractions de la vessie), s’infecter ou se boucher.
Des changements itératifs, toutes les quatre à douze semaines,
sont nécessaires. En cas de mauvaise tolérance de la sonde, ou
d’impossibilité technique à sa pose, on pourra avoir recours à la
mise en place d’un cathéter sus-pubien. L’inconvénient principal
du cathéter sus-pubien est d’être facilement arraché par le patient,
surtout si ce dernier présente des épisodes d’agitation.
L’utilisation d’une sonde ou d’un cathéter sus-pubien “à demeure”
est très fréquente, que ce soit ou non dans le cadre d’une maladie
cancéreuse. Cependant, il n’existe pas d’étude dans la littérature
sur ce type de soin. En particulier, aucune équipe n’a analysé la
tolérance ou la qualité de vie des patients.
DÉRIVATION RÉNALE
Généralités
Une dérivation rénale est nécessaire en cas d’obstacle urétéral.
L’obstacle urétéral peut être lié à une tumeur de l’uretère, ou
bien à un envahissement ou à une compression par un autre
type de tumeur. Il peut se situer à l’abouchement intravésical de
l’uretère (cancer avancé de la vessie ou de la prostate) ou sur tout
le trajet urétéral (adénopathies, carcinose péritonéale, etc.). Les
complications potentielles en sont la lombalgie, la pyélonéphrite
et, à l’extrême, la perte de la fonction rénale.
Facilement détectée par l’échographie, l’hydronéphrose repré-
sente une indication de drainage rénal sauf dans de rares cas
où elle est modérée et asymptomatique.
Sonde double J
Sous anesthésie générale ou rachianesthésie, une sonde est
montée par voie endoscopique de la vessie vers le rein. L’extré-
mité supérieure de la sonde est positionnée dans le rein, l’extré-
mité inférieure dans la vessie. Le rein est ainsi drainé, car l’urine
s’écoule par la sonde. Une sonde double J est habituellement
changée tous les six mois, car, au-delà de ce délai, le risque
de calcifi cation est important. Certaines sondes peuvent être
laissées en place jusqu’à un an (sondes de longue durée).
L’avantage principal de la sonde double J est qu’il s’agit d’une
dérivation interne. Il n’y a pas d’appareillage, et le patient n’est
pas limité dans ses activités. Cependant, la sonde est parfois
mal tolérée, car elle occasionne certains troubles : pollakiurie,
impériosités, douleurs, hématurie. De plus, elle favorise les
infections urinaires et la formation de calculs. Enfi n, elle peut
être comprimée par la tumeur, ce qui aboutit parfois à des hospi-
talisations répétées pour changements de sonde.
Néphrostomie percutanée
Sous anesthésie générale ou rachianesthésie, ou sous simple
anesthésie locale, une sonde est introduite dans le rein sous
guidage échographique et par voie transcutanée. Cette sonde
s’extériorise par la fosse lombaire, et l’urine est recueillie dans
une poche. L’inconvénient majeur est qu’il s’agit d’une dérivation
externe, mais l’avantage est qu’il n’y a ni troubles mictionnels
ni risque de compression par la tumeur.
Sonde double J ou néphrostomie ?
En pratique courante, la question se pose souvent. Le profi l du
patient et les caractéristiques de son cancer guident la décision.
Chez un patient actif, dont le cancer est peu évolutif, la sonde
double J est préférable. Chez un patient présentant une mobilité
restreinte et/ou un cancer très agressif, la néphrostomie est plus
adaptée. En eff et, il faut alors privilégier la qualité de vie en
réduisant le nombre d’hospitalisations. La sonde double J expose
à des changements fréquents. S.Y. Chung et al. (2) ont étudié
ses résultats chez 101 patients présentant une compression
urétérale par un cancer. Dans leur série, 138 montées de sonde
double J ont été tentées. Le taux d’échec était de 40 %. De plus,
30 % des patients chez lesquels la sonde double J avait pu être
montée ont eu secondairement une néphrostomie, après un délai
moyen de 40 jours. Une seule étude a comparé spécifi quement
la sonde double J et la néphrostomie chez des patients présen-
tant un obstacle tumoral (3). Dans cette étude, le taux global
de complications des deux procédures était identique, mais
la néphrostomie était associée à un meilleur taux de drainage
(98,7 % versus 89 %).
Monter une sonde double J n’est pas toujours possible soit parce
que le méat urétéral n’est pas visible dans la vessie, soit parce
que l’obstacle urétéral est infranchissable. La néphrostomie
percutanée reste alors la seule option. Il est parfois possible de
descendre secondairement une sonde double J par la néphro-
stomie.
Endoprothèse urétérale
Il s’agit d’un stent, de quelques centimètres de longueur, mis
en place à l’intérieur de l’uretère au niveau de l’obstacle. Cette
technique est parfois utilisée pour des rétrécissements fi breux
de l’uretère. Elle n’est pas recommandée dans les obstacles tumo-
raux. Une seule étude a rapporté l’utilisation d’endoprothèses
urétérales chez des patients présentant un obstacle tumoral (4).

Dossier thématique
Dossier thématique
412
La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 9 - novembre 2007
Dans les trois cas étudiés, l’endoprothèse était obstruée par le
cancer au bout de quelques mois, et des néphrostomies ont dû
être mises en place.
Pontage réno-vésical
Cette intervention consiste à relier le rein à la vessie, en shun-
tant l’uretère, par deux tubes en matériau synthétique sous-
cutané connectés l’un à l’autre. L’étude la plus importante a
inclus 31 patients (5) ; elle montrait la faisabilité technique de la
procédure, mais avec un risque signifi catif d’infection et d’obs-
truction (environ 20 %).
CONCLUSION
En cas d’obstacle urétral, la résection endoscopique représente
la meilleure solution pour réaliser une dérivation de la vessie.
Il s’agit d’une intervention simple, mais associée à un risque
signifi catif d’incontinence postopératoire.
En cas d’obstacle urétéral, il existe deux options : la sonde double J
ou la néphrostomie. La sonde double J est préférable chez les
patients actifs, mais elle nécessite des hospitalisations régulières
pour changements itératifs. La néphrostomie, qui permet un
drainage plus sûr des cavités rénales, nécessite un appareillage
externe. Elle est donc réservée aux patients à mobilité restreinte
ou à ceux qui ont présenté un échec à la pose d’une sonde
double J. ■
RéféRences bibliogRaphiques
1. Crain DS, Amling CL, Kane CJ. Palliative transurethral prostate resection
for bladder outlet obstruction in patients with locally advanced prostate cancer.
J Urol 2004;171:668-71.
2. Chung SY, Stein RJ, Landsittel D et al. 15-year experience with the mana-
gement of extrinsic ureteral obstruction with indwelling ureteral stents. J Urol
2004;172:592-5.
3. Ku JH, Lee SW, Jeon HG, Kim HH, Oh SJ. Percutaneous nephrostomy versus
indwelling ureteral stents in the management of extrinsic ureteral obstruction in
advanced malignancies: are there diff erences? Urology 2004;64:895-9.
4. Ahmed M, Bishop MC, Bates CP, Manhire AR. Metal mesh stents for ureteral
obstruction caused by hormone-resistant carcinoma of prostate. J Endourol
1999;13:221-4.
5. Schmidbauer J, Kratzik C, Klingler HC, Remzi M, Lackner J, Marberger M.
Nephrovesical subcutaneous ureteric bypass: long-term results in patients with
advanced metastatic disease-improvement of renal function and quality of life.
Eur Urol 2006;50:1073-8.
1
/
3
100%