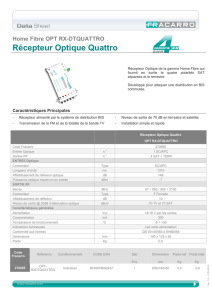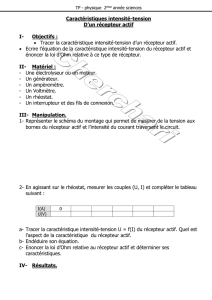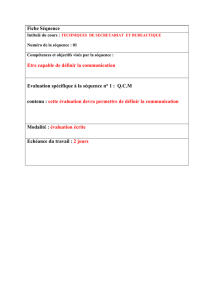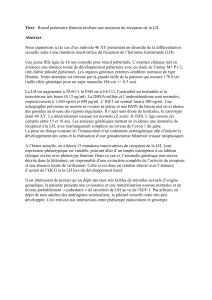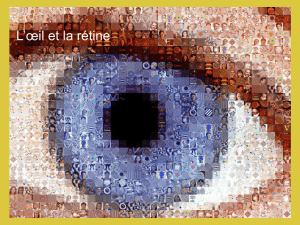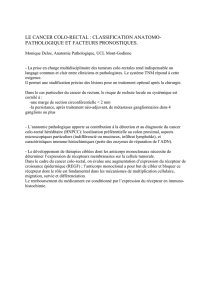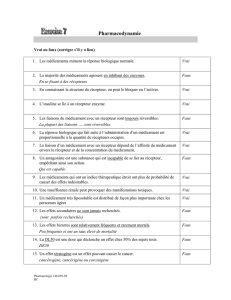25 Congrès de la Société Française d’Endocrinologie ✓

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 1 - janvier-février 2009
10
10
Échos des congrès
Martial Ruat (institut Alfred-Fessart)
✓
a présenté
le concept de modulation allostérique des récep-
teurs à sept domaines transmembranaires couplés
aux protéines G (GPCR). Ce chercheur a rappelé que
le récepteur du calcium, exprimé par les cellules
parathyroïdes, est un GPCR qui lie, au niveau de sa
région extracellulaire N-terminale, le calcium circulant.
L’activation du récepteur par des concentrations de
Ca
2+
supérieures à 2 mM réduit la sécrétion de PTH,
permettant de rééquilibrer la calcémie. Martial Ruat
a décrit la capacité de modulateurs allostériques à
potentialiser l’activation du récepteur en présence
de faibles concentrations de Ca2+ (calcimimétique),
comme le cinacalcet, prescrit depuis 2005 dans
l’hyperparathyroïdisme secondaire à l’insu sance
rénale chronique. Il a également présenté des calcily-
tiques, des modulateurs allostériques capables d’in-
hiber l’activation du récepteur en présence de fortes
concentrations de Ca
2+
. Ces calcilytiques, comme le
Calhex 231, actuellement en cours de développe-
ment, pourraient avoir une application dans le traite-
ment de l’ostéoporose. La modélisation moléculaire
révélant la structure chimique du récepteur en trois
dimensions a permis de localiser le site de liaison des
modulateurs allostériques au niveau des segments
transmembranaires, dans deux poches distinctes, et
d’identi er les acides aminés interagissant avec les
modulateurs. La visualisation des interactions chimi-
ques entre les ligands allostériques et le récepteur du
Ca2+ permettra la synthèse de nouvelles molécules
de plus haute a nité. L’application de ce nouveau
concept de pharmacologie à d’autres GPCR conduira
prochainement au développement de modulateurs
allostériques spéci ques des di érents récepteurs.
Au cours de sa présentation,
✓
David Planchard (ins-
titut Gustave-Roussy) a indiqué que l’activité tyrosine-
kinase (TyrK), c’est-à-dire la capacité à phosphoryler
des protéines sur des résidus tyrosine, est présente
dans la région intracellulaire de 59 récepteurs mem-
branaires (VEGFR, EGFR, IGFR1, HER2, etc.) ou portée
par 32 protéines cytoplasmiques connues à ce jour.
L’activité enzymatique d’un récepteur à TyrK participe
à la transduction du signal lors de l’activation de ce
récepteur. Celle portée par des protéines cytoplasmi-
ques régule la transcription de gènes cibles. Les TyrK
jouent un rôle clé dans le contrôle de la prolifération,
de la di érenciation et de l’apoptose des cellules. La
dérégulation, la surexpression ou la mutation activatrice
de TyrK conduisent au développement tumoral. David
Planchard a d’ailleurs rappelé que 70 % des oncogènes
et des proto-oncogènes sont des TyrK, ce qui souligne
l’intérêt des inhibiteurs de TyrK en cancérologie. Ces
inhibiteurs bloquent le site actif des enzymes, empê-
chant la transduction du signal et/ou l’activation de
gènes cibles, ce qui réduit la prolifération cellulaire.
Plusieurs inhibiteurs de TyrK, dont l’imatinib, l’erlotinib
et le lapatinib ont permis d’observer une réduction
25e Congrès de la Société Française d’Endocrinologie
Réunion interface SFE-Inserm :
nouvelles thérapies en endocrinologie
Lille, 1
er-4 octobre 2008
Estelle Louiset*
Lors du congrès de la Société Française d’Endocrinologie (SFE), la réunion d’in-
terface avec l’Inserm fut consacrée aux nouvelles thérapies en endocrinologie.
Au cours de cette journée ont été abordés les aspects les plus fondamentaux,
comme la modélisation moléculaire de récepteur et le drug design, ainsi que
les projets d’applications cliniques basées sur la pharmacologie, les thérapies
génique et cellulaire.
* Laboratoire de neuro-
endocrinologie cellulaire et
moléculaire, Inserm U413,
IFRMP, université de Rouen,
Mont-Saint-Aignan.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 1 - janvier-février 2009
11
11
Réunion interface SFE-Inserm : nouvelles thérapies en endocrinologie
transitoire des masses tumorales et un allongement de
la survie sans récidive chez certains patients sou rant
d’un cancer du poumon, du sein ou du pancréas ou
d’une tumeur stromale gastro-intestinale. De nouveaux
inhibiteurs de TyrK, tels que le ZD6474, en cours d’étude
pour le traitement du cancer de la thyroïde, inhibent
à la fois la prolifération des cellules tumorales et l’an-
giogenèse, ce qui entraîne une excavation des masses
tumorales. David Planchard a précisé qu’un traitement
par un inhibiteur de TyrK doit intervenir en deuxième
intention, après développement de la résistance à la
chimiothérapie anticancéreuse classique. L’analyse
génétique par microarray des mutations ou délétions
a ectant des gènes codant des récepteurs à TyrK, en
particulier le récepteur de l’EGF, permet de prédire la
réponse thérapeutique à certains inhibiteurs de TyrK et
de cibler les patients a priori répondeurs au traitement.
Malgré la très grande e cacité des inhibiteurs de TyrK
sur la réduction des masses tumorales des patients
répondeurs, ces derniers finissent par développer
une résistance et échapper au traitement. L’orateur a
indiqué que la synthèse d’inhibiteurs spéci ques des
di érentes formes de récepteurs et protéines cyto-
plasmiques à TyrK permettrait à l’avenir de mettre en
œuvre des protocoles utilisant séquentiellement deux
ou trois inhibiteurs distincts après chaque apparition
d’une nouvelle résistance. David Planchard estime que
l’utilisation successive d’inhibiteurs de TyrK devrait aug-
menter d’au moins une année la survie sans récidive
des patients.
Florence Cabon (institut Curie)
✓
a présenté l’utili-
sation prometteuse des ARN d’interférence (siRNA)
dans le traitement du cancer de la prostate. Au cours
de l’évolution de cette maladie, les tissus métasta-
siques échappent à l’e et béné que de la castration
ou des antagonistes des récepteurs des androgènes.
Dans ce cas, les cellules tumorales surexpriment le
récepteur natif ou synthétisent un récepteur muté
qui est soit constitutivement actif, soit sensible à
d’autres hormones stéroïdiennes. Les siRNA sont de
petits ARN (20 nucléotides) capables de s’hybrider sur
l’ARNm d’un gène d’intérêt et d’induire sa dégradation.
Florence Cabon a montré qu’une seule injection de
siRNA spéci ques du récepteur des androgènes freine
durablement (60 jours) la prolifération des cellules de
lignées de cancer de la prostate (LNCaP, C4-2, 22RV1)
implantées chez la souris. Les siRNA inhibent l’expres-
sion du récepteur des androgènes dans les cellules
tumorales, ce qui entraîne une réduction de la prolifé-
ration cellulaire et une augmentation de l’apoptose. En
parallèle, les chercheurs ont observé une diminution
de l’angiogenèse, expliquée par le fait que le VEGF est
un gène cible des récepteurs des androgènes. L’e et
antitumoral des siRNA n’implique pas une activation
du système immunitaire, mais il met en jeu le com-
plexe protéique RISC, qui clive spéci quement l’ARNm
hybridé. Les études de biodisponibilité ont révélé que
les siRNA injectés quittent rapidement (2 minutes) le
compartiment sanguin. La di usion dans les tissus
n’est pas homogène : elle est quasiment inexistante
dans le cerveau et le cœur, faible dans le foie, le pou-
mon, l’os et le rein, modérée dans la rate et très forte
dans la prostate. L’e cacité des siRNA dirigés contre
le récepteur des androgènes dans le modèle murin du
cancer de la prostate ouvre une nouvelle perspective
thérapeutique du traitement de cette pathologie chez
l’homme.
Des essais de thérapie cellulaire visant à remplacer ✓
les cellules bêta, détruites au cours de la réponse auto-
immune à l’origine du diabète de type I, ont été réalisés
avec des cellules pancréatiques di érenciées prélevées
en post mortem. Cette approche thérapeutique est limi-
tée d’une part par la faible disponibilité des cellules bêta
des donneurs, celles-ci représentant moins de 4 % de la
masse du pancréas adulte, et d’autre part par la perte
de fonctionnalité du gre on à moyen terme. Bertrand
Duvillié (faculté Necker) propose une autre option de
thérapie cellulaire du diabète de type I, fondée sur des
cellules précurseurs du pancréas embryonnaire. Dans le
but de mettre au point cette nouvelle approche théra-
peutique dans un modèle animal, Bertrand Duvillié s’est
xé pour objectif d’ampli er in vitro les cellules souches
du pancréas prélevées sur des embryons de souris pour
obtenir un grand nombre de cellules, puis de les di é-
rencier en cellules de type bêta. Pour cela, il a recherché
les di érentes voies de signalisation et les facteurs de
transcription (FGF10, PDX-1, Notch, Neurogenin 3, etc.)
impliqués dans le contrôle de ces deux processus. La
compréhension de ces mécanismes de régulation l’a
conduit à mettre en œuvre des protocoles originaux
de culture cellulaire permettant d’activer séquentielle-
ment la prolifération puis la di érenciation des cellules
progénitrices en cellules bêta matures. La transposition
de ces protocoles de culture aux cellules souches du
pancréas humain pourrait fournir un grand nombre de
cellules bêta en vue d’une thérapie cellulaire.
■
1
/
2
100%