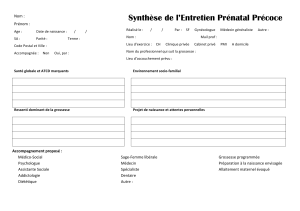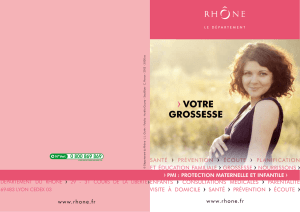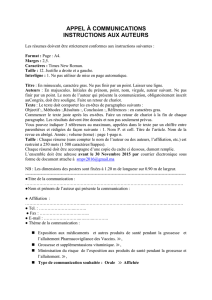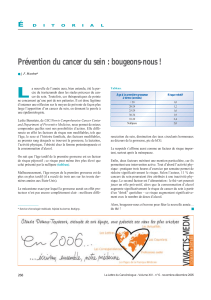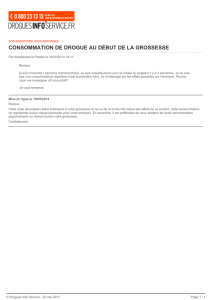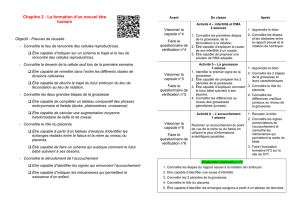Lire l'article complet

La fissure anale
Elle survient préférentiellement durant
les semaines qui suivent l’accouche-
ment, avec une incidence variant de 3 à
39 % selon les auteurs ; son incidence
est faible pendant le troisième trimestre
de la grossesse (1,2 à 3 %) (1, 3).
Les symptômes n’ont rien de spécifique :
douleur déclenchée par la selle, rector-
ragies, constipation “réflexe”. La fissure
anale se localise préférentiellement au
pôle antérieur de l’anus, avec un aspect
de fissure jeune à bords souples, sans
annexes et sans hypertonie du sphincter
interne (3,4). L’association à la maladie
hémorroïdaire est peu fréquente.
Sa physiopathologie semble spécifique,
puisqu’il a été démontré, par manomé-
trie ano-rectale, une absence d’augmen-
tation de pression du canal anal, voire
une diminution de la pression maximale
de repos et de contraction volontaire chez
les patientes avec fissure et par rapport
à celles indemnes de fissure en post-
partum (4). L’intrication de plusieurs
mécanismes dans la genèse de l’hypo-
tonie anale du post-partum est évoquée :
atteinte directe du sphincter interne par
compression lors de l’engagement de la
tête du fœtus, atteinte du sphincter externe
si une épisiotomie large est associée ou
par déchirure directe, atteinte neurogène,
soit par étirement des nerfs honteux in-
ternes, soit par compression directe pro-
longée de ces mêmes nerfs, probable
retentissement hormonal local jouant sur
le tonus musculaire (3).
Le principal facteur favorisant de la fis-
sure est la constipation terminale. D’autres
facteurs pourraient jouer un rôle favori-
sant, et particulièrement les facteurs
traumatiques liés à l’accouchement :
primiparité,épisiotomie, forceps, poids
important du bébé, terme d’accouche-
ment tardif, travail prolongé.
Sur le plan thérapeutique, les traitements
visant à lever le spasme sphinctérien
n’ont pas d’intérêt, puisqu’il n’existe pas
d’hypertonie. La régularisation du tran-
sit est l’élément clé du traitement ; les
topiques locaux peuvent être utilisés. La
guérison est obtenue dans pratiquement
tous les cas (4) ; le recours à la chirurgie
est exceptionnel, et aucun geste sphinc-
térien ne devra être réalisé, sous peine
de dévoiler ou de favoriser une incon-
tinence anale.
La pathologie hémorroïdaire
La grossesse et le post-partum repré-
sentent une période “privilégiée” pour
la survenue de manifestations aiguës de
la maladie hémorroïdaire (1,5). Il s’agit
surtout de thromboses multiples, avec
réaction œdémateuse marquée. L’inci-
dence des thromboses hémorroïdaires
externes varie, selon les études, de 12 à
34 % dans le post-partum (9 fois sur 10
dans les heures qui suivent l’accouche-
ment) et de 7,9 % à 38 % pendant la
grossesse (8 fois sur 10 durant le troi-
sième trimestre de la grossesse) (1, 3).
Aucune conséquence fœtale ou mater-
nelle n’a été rapportée, si ce n’est une
dégradation de la qualité de vie de la
mère liée aux douleurs et à l’inconfort.
La plupart du temps, l’examen clinique
suffit à confirmer le diagnostic et à éli-
miner une autre cause de douleur (fissure
anale, abcès, épisiotomie, herpès).
Au cours de la grossesse et de l’accou-
chement, différents facteurs peuvent
induire ou aggraver la maladie hémor-
roïdaire (1, 5) :
–la constipation, très fréquente (11 à
52 % des patientes selon les études), et
souvent associée à une dyschésie ;
–la gêne au retour veineux secondaire
à la compression induite par l’utérus
gravide ;
–l’action directe des hormones sur les
vaisseaux hémorroïdaires ;
–les antécédents personnels et fami-
liaux d’hémorroïdes ;
–un accouchement traumatique (for-
ceps, gros bébé, long travail d’expulsion,
déchirure) ; la césarienne est très nette-
ment associée à une moindre incidence
de cette pathologie.
Les recommandations pour la pratique
clinique sur le traitement de la maladie
hémorroïdaire chez la femme enceinte
ont défini par accord professionnel que
le traitement doit être avant tout médical
(régulateur du transit, veinotonique [dios-
mine], topiques contenant de l’hydro-
cortisone ou un de ses dérivés, ainsi que
ceux contenant un excipient lubrifiant,
antalgiques) (6, 7).
Proctologie
S. Sultan*
* Service de proctologie, groupe hospitalier
Diaconesses-Croix-Saint-Simon, Paris.
L
a pathologie proctologique survenant pendant la grossesse néces-
site une prise en charge spécifique, car les principes médicaux et les
pratiques cliniques universellement acceptés et appliqués de façon
standardisée dans la population générale doivent être adaptés à la
femme enceinte, en particulier les examens invasifs, les médicaments et
la chirurgie, afin de garantir la sécurité du fœtus et celle de la mère. La
pathologie proctologique de la grossesse et du post-partum est dominée
par la maladie hémorroïdaire, en particulier les thromboses externes, et
par la fissure anale. Elles représentent les deux principales causes de
douleur anale chez la parturiente. Elles sont fréquentes, puisque l’on
estime qu’un tiers des parturientes en souffrent durant leur grossesse,
mais elles n’ont fait l’objet que de peu d’essais thérapeutiques (1, 2).
37
Tube digestif
Supplément à La Lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VIII - mai-juin 2005
et grossesse

La prise en charge de la douleur repose
sur l’utilisation des antalgiques (8-10).
Le paracétamol peut être utilisé jusqu’à
la dose de 3 à 4 g/j pendant toute la
grossesse et en cas d’allaitement ; l’asso-
ciation paracétamol et dextropropoxy-
phène est utilisable pendant la grossesse,
mais pas pendant l’allaitement en rai-
son de risques de pauses respiratoires
chez le nouveau-né. Les AINS et l’as-
pirine ne présentent pas de risque mal-
formatif, mais font courir en fin de gros-
sesse des risques fœtaux. Bien que très
efficaces sur la douleur et l’œdème, ils
ne doivent pas être utilisés au cours du
troisième trimestre de grossesse (risque
de fermeture prématurée du canal arté-
riel, insuffisance rénale, complications
hémorragiques) et lors de l’allaitement
(risque tératogène chez l’animal). Tou-
tefois, l’Académie américaine de pédia-
trie considère que l’ibuprofène, l’indo-
métacine et le naproxène peuvent être
prescrits chez la femme qui allaite (10).
Il n’y a pas actuellement de cas publiés
sur des malformations fœtales rapportées
aux anti-Cox 2 ; en revanche, ces molé-
cules peuvent entraîner des compli-
cations rénales fœtales. Leur rôle sur
l’appareil cardio-pulmonaire fœtal n’est
pas clairement établi. Leur prescription
chez la femme allaitant a été peu étudiée,
si bien qu’ils ne sont pas recommandés
(10). Les corticoïdes (prednisone et pred-
nisolone), en revanche, peuvent être uti-
lisés sans restriction pendant la gros-
sesse, en cure courte, même à forte dose
(1 mg/kg). Ils peuvent constituer un trai-
tement d’appoint en application locale.
La prednisolone peut être poursuivie
pendant l’allaitement ; certains préco-
nisent d’attendre 4 heures entre la prise
du médicament et l’allaitement.
La morphine (chlorhydrate injectable
ou, mieux, sulfate de morphine LP en
comprimés calibrés) est utilisable sans
risque tératogène, même au long cours,
à condition de ne jamais l’interrompre
brutalement.
L’incision, avec excision d’une throm-
bose externe après anesthésie locale à
la lidocaïne, peut être réalisée, sauf en
cas de thrombose œdématiée, et en évi-
tant de les réaliser juste avant l’accou-
chement, l’expulsion favorisant les
hémorragies locales. Les traitements
instrumentaux (photocoagulation infra-
rouge, ligature élastique) n’ont pas été
évalués chez la femme enceinte ; ils ont
été réalisés sans complications spéci-
fiques par certains auteurs (11). La sclé-
rothérapie est contre-indiquée en cas de
grossesse, l’absence de toxicité fœtale
en cas de passage systémique n’étant
pas démontrée pour les produits scléro-
sants (6).
En cas d’échec du traitement médical,
la chirurgie peut être proposée, sous
anesthésie locorégionale de préférence,
et sans geste associé à type de sphinc-
térotomie, afin de limiter les risques
d’incontinence (12).
À ce jour, il n’existe pas de médication
préventive, notamment en cas de throm-
bose hémorroïdaire à répétition lors d’une
grossesse précédente. En revanche, des
précautions hygiénodiététiques peu-
vent être prises : régime riche en fibres
et en boissons hydriques, qui augmentent
le bol alimentaire et permettent la régu-
larisation du transit. La chirurgie préven-
tive à distance de l’accouchement n’est
pas validée.
Maladie de Crohn
Chez les femmes avec atteinte périnéale
de maladie de Crohn (MC), la présence
de lésions anopérinéales actives au
moment de l’accouchement est une indi-
cation à la césarienne, car l’accouche-
ment par voie basse aggrave les symp-
tômes périanaux préexistants (13, 14).
En revanche, il n’est pas établi que la
césarienne préventive diminue le risque
de rechute de lésions anopérinéales dans
les formes quiescentes ; l’épisiotomie
peut être dangeureuse chez les femmes
atteintes de MC, en raison du risque de
fistule rectovaginale (13).
Chez les femmes porteuses d’une ana-
stomose iléo-anale avec réservoir, les
modalités d’accouchement doivent être
décidées sur la base de considérations
obstétricales, et l’accouchement par voie
basse doit être évité chez les femmes
dont le périnée est non compliant et/ou
rigide (14).
En conclusion, l’indication de la césa-
rienne au cours des MICI doit être large
pour protéger la continence fécale,
notamment en cas d’anastomose iléo-
anale ou de lésions anopérinéales, mais
pas systématique.
Il n’existe pas d’étude contrôlée prou-
vant l’efficacité des antibiotiques dans
le traitement des fistules anales croh-
niennes ; en pratique clinique, l’utilisa-
tion du métronidazole (750 à 1 500 mg/j)
ou de la ciprofloxacine (1 000 mg/j) est
réalisée pendant 3 à 4 mois, en l’absence
de grossesse.
Le métronidazole en prescription de
courte durée (7 à 10 jours) est sans dan-
ger chez la femme enceinte. Il convient
d’en éviter l’administration prolongée,
car il entraîne chez la souris des effets
mutagènes et carcinogènes. La cipro-
floxacine est contre-indiquée pendant la
grossesse et l’allaitement en raison de
son arthropathogénicité.
Autres pathologies
proctologiques
Les abcès de la marge anale et les suppu-
rations sont rares chez la femme enceinte
et menacent rarement la grossesse.
L’incision et le drainage de ces lésions
doivent être réalisés rapidement ; la fistu-
lectomie sera effectuée après l’accouche-
ment. En cas de fistule(s) importante(s)
et/ou complexe(s), une césarienne doit
être discutée.
L’infection anale à Human papilloma
virus (HPV) (15) est rare au cours de la
grossesse, laquelle serait susceptible
d’aggraver des lésions condylomateuses
préexistantes. La guérison intervient ha-
bituellement sans traitement, en quelques
semaines, après l’accouchement. L’ap-
plication de podophylline est contre-
indiquée pendant la grossesse en raison
des risques fœtaux ; l’électrodestruc-
tion est possible dans les cas les plus
sévères. Une césarienne ne se discutera
qu’en cas de lésions très étendues du fait
38
Tube digestif
Supplément à La Lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VIII - mai-juin 2005
et grossesse

39
Tube digestif
Supplément à La Lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 3 - vol. VIII - mai-juin 2005
et grossesse
du risque de contamination de la filière
oropharyngée du nourrisson lors de
l’expulsion. ■
Références
1. Abramovitz L, Sobhani I, Benifla JL et
al. Anal fissure and thrombosed external
hemorrhoids before and after delivery. Dis
Colon Rectum 2002;45:650-5.
2. Abramovitz L, Sobhani I. Complications
anales de la grossesse et de l’accouche-
ment. Gastroentérol Clin Biol 2003;27:
277-83.
3. Grandjean JP. Fissure anale du post-
partum : une prise en charge spécifique ?
Bull Fr Col Proct 1999;2:9-11.
4. Corby H, Donnely VS, O’Herlihy C,
O’Connel PR. Anal canal pressures are
low in women with post-partum anal fissure.
Br J Surg 1997;84:86-8.
5. Bidart JM. Hémorroïdes et grossesse.
Bull Fr Col Proct 1999;2:12-5.
6. SNFCP. Recommandations pour la
pratique clinique sur le traitement de la
maladie hémorroïdaire. Gastroentérol
Clin Biol 2001;25:674-702.
7. Buckshee K, Takkar D. Micronized fla-
vonoid therapy in internal hemorrhoids of
pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 1997;
57:145-51.
8. Nayar R, Lewis HL. Use of gastrointes-
tinal and hepatic drugs during pregnancy
and lactation. In: Friedman et al. Gastro-
intestinal pharmacoloy and therapeutics.
Lippincott-Raven Publishers 1997:611-31.
9. Koren G, Pastuswak A, Ito S. Drugs in
pregnancy. N Eng J Med 1998;338:1128-37.
10. Fardet L, Nizard J, Genereau T. Anti-
inflammatoires non stéroïdiens sélectifs et
non sélectifs au cours de la grossesse et de
l’allaitement. Press Med 2002;31:1462-8.
11. Medich D, Fazio V. Hemorrhoids, anal
fissure, and carcinoma of the colon, rectum,
and anus during pregnancy. Surg Clin N
Am 1995;75:77-88.
12. Saleeby RG, Rosen L, Stasik JJ et al.
Hemorrhoidectomy during pregnancy:
risk or relief? Dis Colon Rectum 1991;
34:260-1.
13. Couve S, Seksik P, Elefant E et al.
Maladies inflammatoires de l’intestin et
procréation. Gastroentérol Clin Biol 2003;
27:618-26.
14. Marteau P, Beaugerie L, Schenowitz
G, Tucat G. MICI et grossesse. In : Prise
en charge des MICI. Paris : John Libbey
Eurotext Ed;2003:82-90.
15. Sultan S. Condylomes anaux : une prise
en charge encore difficile. J Chir 2001;
138:277-80.
La Lettre de L’hépato-gastroentérologue
vous souhaite un bel été et vous remercie
de la fidélité de votre engagement.
1
/
3
100%