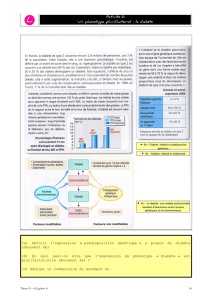Obésité, activité physique et diabète Édi toria l L

Obésité, activité physique
et diabète
Cette Lettre a pour but d’essayer de
comprendre et de mieux définir les liens
unissant l’activité physique, l’obésité et le
diabète.
Nous tenons à remercier le Pr Rivière et ses
élèves : F. Pillard, O. Van Haverbeke ainsi que
T. Clavel et P.L. Colombo d’avoir abordé et
clarifié les différentes facettes de ce sujet
complexe.
Il apparaît que le risque de diabète type II et
d’obésité est corrélé à la sédentarité et
qu’inversement, l’activité physique a un effet
bénéfique sur la morbi-mortalité de ces
pathologies. L’obésité et le diabète type II sont
étroitement liés à l’insulinosécrétion.
Si les facteurs génétiques et
environnementaux sont souvent évoqués dans
leur physiopathologie, les troubles du
métabolisme musculaire jouent un rôle
important dans l’apparition, l’évolution et
l’aggravation de ces deux pathologies.
En général et tout particulièrement dans le
diabète et l’obésité, l’activité physique
régulière, raisonnable, a de nombreuses
raisons d’être proposée :
-préventiondesmaladiescardiovasculaires
-actionfavorablesurlemétabolisme
glucidique et lipidique
-entretiendelamassemusculaireetdeson
métabolisme
-améliorationdelamasseosseuse
-maintiendelasouplessearticulaireetdela
coordination du mouvement, de l’équilibre
et donc de la prévention des chutes
-normalisationdelacirculationveineuse
-actionsurlestress,l’équilibrepsychologique
et le sommeil.
Retenons la devise de l’Observatoire du
Mouvement :
«lasantépourlemouvement,
le mouvement pour la santé »
Ch. Mansat
LETTRE D’INFORMATION (3 numéros par an) Janvier 2011
N° 37
LA LETTRE
Éditorial
Éditorial: Ch. Mansat 1
L’obésité : P.-L. Colombo 1
Le diabète de type II : T. Clavel 3
Place de l’autosurveillance glycémique : T. Clavel 6
Prise en charge de l’excès de masse grasse et du diabète de type II :
l’activité physique peut-elle être prescrite ? : F. Pillard 6
Principe général de la prise en charge comportementale :
O. Van Haverbeke 11
Opinion: Ch. Mansat 12
SOMMAIRE
au delà de 25,d’obésité au delà de 29,et d’obé-
sité morbide au delà de 39.On lui reproche de
ne pas tenir compte qualitativement de la masse
grasse ou maigre, de la répartition des graisses
dans l’organisme.
L’obésité
Le monde grossit et la France avec! À l’instar des pays notamment anglo-saxons,la progression
des personnes en surpoids est telle qu’on en arrive à parler de véritable épidémie.En France,
1personne sur 3 est désormais en surpoids,1 sur 6 obèse.Plus grave,les jeunes adultes et les
adolescents ne sont plus épargnés.
Mais qu’est ce que l’obésité? Comment la diagnos-
tiquer? Est-elle dangereuse ? Autant de questions
quotidiennes,qui concernent tous les acteursde
sa prise en charge.
Qu’est ce que l’obésité ?
L’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS) la
définit comme une accumulation anormale ou
excessive de graisse sous la peau ou entre les vis-
cères,et qui peut provoquer des problèmes de
santé,à court comme à long terme.Mais elle n’est
toujours pas déterminée comme « maladie à part
entière » même si plusieurs experts nous incitent
subtilement à « la considérer comme telle » eu
égard aux risques de complications et au coût
que cela génère.
Diagnostic et symptômes
La mesure du poids d’une personne n’est plus
considérée suffisante pour définir la surcharge
pondérale ou l’obésité.D’autres paramètres sont
pris en compte :
!l’indice de masse corporelle (ou IMC): il repré-
sente le rapport entre le poids (exprimé en kg)
et la taille (exprimée en m) au carré.La valeur
normale est entre 18 et 25.On parle de surpoids

!la mesure du tour de taille vient donc
compléter le calcul de l’IMC.On parle de
surcharge abdominale lorsqu’il est supérieur
à 80 cm pour les femmes et 94 cm pour les
hommes. On la considère ainsi comme un
marqueur supplémentaire et un élément
prédictif chez les personnes à risque vascu-
laire (hypertendues,diabétiques,tabagiques
entre autre…).
!de même,le rapport tour de taille/tour de
hanche donne une information quant à la
répartition de la masse grasse sur le corps.Il
est élevé lorsqu’il est supérieur à 1 chez les
hommes et 0.85 chez les femmes.
L’obésité est dite androïde lorsque la surchar-
ge prédomine dans la région abdominale,
gynoïde lorsqu’elle prédomine aux hanches,
aux cuisses.Pour d’évidentes causes hormo-
nales la première touche les hommes,la secon-
de les femmes.
Peut-on la prévenir ?
De nombreux facteurs favorisent la prise de
poids.Ils ne sont pas qu’individuels et relèvent
de la génétique, de la famille,de l’environ-
nement,de la société.
N° 37 - PAGE 2-LALETTRE DE L’OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT
à la préparation des repas, les ingrédients
utilisés,les horaires des prises et le partage
des repas,la culture familiale du sport etc.
Enfin,les troubles du comportement alimen-
taires peuvent relever de la dépression, du
stress, de l’anxiété, mais également de la
simple déstructuration du rythme des repas
(rendue parfois obligatoire par la charge
professionnelle…).
!les facteurs influant la dépense énergétique:
sédentarité et activité physique, cette der-
nière étant seule à réellement influer béné-
fiquement sur l’augmentation de la dépense
énergétique. C’est déjà souligner toute son
importance.
!les facteurs biologiques: l’âge,son propre
métabolisme, certains médicaments pris
(trop?) longtemps, influencent le stockage
et la dégradation des graisses. De même
certaines maladies endocriniennes,notam-
ment la maladie de Cushing pour ne citer
qu’elle.
!les facteurs socio-environnementaux et cultu-
rels : l’obésité ou le surpoids ne sont plus
comme il y a quelques lustres,signes d’ai-
sance et de prospérité.Tout concours à la
consommation,entre autres:publicité,multi-
plication des points de vente à emporter,
fréquentation assidue des restaurants,multi-
plication des « repas » de travail. Et para-
doxalement s’amplifie le culte de la minceur
et de l’image.
L’analyse est donc complexe et ne souffre d’au-
cune simplification.Elle justifie la meilleure
attention individuelle pour toute prise en char-
ge, même si des réponses collectives sont
souvent adaptées et proposées.
Doit-on la prévenir ?
Surpoids et surtout obésité peuvent avoir de
sévères conséquences,non seulement en terme
d’esthétique et de confort personnel,mais en
favorisant plusieurs maladies chroniques.
Le risque est grandement accru pour l’insuli-
no-résistance et le diabète de type 2 (ainsi
quasiment l’ensemble des personnes atteintes
de ce type de diabète ont un surpoids),et pour
l’hypertension artérielle.Le risque vasculaire
est donc affirmé avec pour conséquence
l‘athérome et à terme insuffisance corona-
rienne (angor,infarctus) et artérite des memb-
res inférieurs ou carotidienne.
Les problèmes veineux (phlébites,thrombo-
ses) sont également nombreux.
Le squelette n’est pas épargné, et outre les
problèmes directement liés à la surcharge
(tendinites,entorses),les phénomènes d’usu-
re,d’arthrose et leurs potentiellesconséquences
chirurgicales (prothèses de hanches, de
genoux) sont favorisés.
Autre conséquence fréquente,le syndrome
d’apnée du sommeil, longtemps négligé et
méconnu,aujourd’hui largement documenté
et dont la prise en charge améliore nettement
le confort de vie de ces patients,avec dispari-
tion d’une symptomatologie certes mineure
(céphalées,fatigue,mal être matinal) mais lanci-
nante,et prévention d’un retentissement beau-
coup plus lourd en particulier vasculaire.
Enfin,plus ou moins fréquents mais tout aussi
corrélés au surpoids citons : lithiases, dyslipé-
mies,goutte,certains cancers (notamment sein,
endomètre,ovaire chez la femme,prostate chez
l’homme),problèmes d’infertilité chez les deux
sexes,d’hypogonadisme chez l’homme.
L’obésité est donc une menace pour la santé.
Prévenir est l’idéal absolu,mais aux difficultés
personnelles s’ajoutent les croyances propres
et familiales, les problèmes d’environnement
et de société, les affinités de chacun à la
pratique d’une activité physique.Il reste perti-
nent,dès l’enfance de commencer par une
alimentation maîtrisée, de rapidement
conseiller activité physique et gestion du stress,
à tout âge d’agir autant que faire se peut sur
l’environnement, le comportement et limiter
ainsi les facteurs les plus « obésogènes ».
Car maigrir est difficile et demande motiva-
tion,connaissance et constance.On ne peut
compter suraucuneaidemédicamenteuse.La
chirurgie bariatrique est réservée aux obési-
tés morbides,après avoir éliminé les contres
ou non indications psychologiques et orga-
niques,ces dernières correspondant déjà en
grande partie,aux propres complications de
l’obésité.
Enfin,entretenons la culture du sport et de
l’exercice physique,éléments déterminants de
toute prise en charge.
"Dr Pierre-Louis Colombo
!les facteurs génétiques:plusieurs gènes sont
impliqués.Citons simplement le rôle de la
leptine, hormone de la satiété, sécrétée par
le tissu adipeux et dont l’action permettrait
le contrôle de la masse grasse par le contrô-
le de la prise alimentaire et de la dépense
énergétique. Son action serait modifiée par
une anomalie génétique portant sur son
récepteur.
!les facteurs alimentaires:ils concernent bien
sûr l’alimentation quantitative (tout excès
calorique favorise l’excès pondéral), mais
aussi l’alimentation qualitative.Par exemple,
àcaloriesingéréeségales,toutexcèsen
sucres rapides sera stocké sous forme de grais-
ses s’ils ne sont pas immédiatement utilisés.
Une alimentation trop pauvre en protéines
favorise également le stockage des graisses.
Ne négligeons pas l’héritage familial, quant

N° 37 - PAGE 3-LALETTRE DE L’OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT
Diabète de type 2,
syndrome métabolique et
obésité, quel lien ?
Les données de l’étude ENTRED 2007-2010,
montrent que l’indice de masse corporelle
médian (IMC) des personnes diabétiques de
type 2 est estimé à 28,7 kg/m2(valeur
correspondant à un surpoids).Ainsi,seulement
20 % des personnes diabétiques de type 2 sont
de corpulence normale (IMC < 25 kg/m2),39 %
sont en surpoids (25 ≤IMC < 29 kg/m2)et41%
sont considérés comme obèses (IMC
≥30 kg/m2). Le surpoids constitue donc un
facteur de risque modifiable majeur du dia-
bète de type 2.
De même, dans le diabète de type 1, si le
surpoids n’est pas un facteur de risque recon-
nu, 56 % des personnes diabétiques de type 1
ont une corpulence normale, 30 % sont en
surpoids (+ 3 points depuis 2001) et 14 % sont
obèses (+ 4 points).
Il est cependant intéressant de noter que selon
les résultats de l’étude ObEpi ces fréquences
sont similaires à celles retrouvées en popula-
tion générale [ObEpi 2006 et 2009].(Fig.1 et 2).
Selon les résultats de l’étude ENTRED 2007-
2010,la France métropolitaine n’échappe pas
àcetterègleplanétaire.Eneffet,laprévalence
du diabète traité a augmenté de 2,7 à 3,95 %
entre 2000 et 2007,soit environ 2,5 millions de
personnes traitées en 2007 ce qui correspond
à une augmentation moyenne annuelle de
5,7 %.Comme au niveau mondial,cette crois-
sance est liée à la progression du surpoids et
de l’obésité,au vieillissement de la population,
à l’améliora
tion de l’espérance de vie des
personnes traitées pour diabète et à l’intensi-
fication du dépistage.La prévalence du diabè-
te n’est pas uniforme en France.Elle est plus
élevée chez les personnes de niveau socio-
économique moins favorisé,chez les person-
nes originaires du Maghreb et elle augmente
davantage dans les départements économi-
quement les moins favorisés.Enfin, il a été
démontré récemment que l’épidémie de diabè-
te suit celle de l’obésité.Ainsi,32 % desFrançais
adultes sont en surpoids,et 14,5 % sont obèses,
soit une augmentation de 11 % par rapport à
2006 (résultats ObEpi 2009),tandis que la préva-
lence du diabète augmente de 5 % par an.
En 2010, La France compterait environ
9millionsd’adultesobèseset2,5millionsde
patients diabétiques de type 2.
Le diabète qu’est-ce que c’est ?
Le diabète « sucré » est une affection métabo-
lique caractérisée par une hyperglycémie chro-
nique liée à une anomalie de sécrétion et/ou
d’utilisation de l’insuline et du glucagon, les
deux principales hormones impliquées dans
la régulation de la glycémie.
On distingue deux types de diabète:
Le diabète de type 2 qui est la forme la plus
fréquente du diabète (plus de 92 % des cas de
diabète traité).Il est caractérisé par une insu-
linorésistance,une carence relative de sécré-
tion d’insuline et une hyperglucagonémie rela-
tive.Cette forme de diabète survient essentiel-
lement chez les adultes d’âge mûr.
Le diabète de type 1,beaucoup moins fréquent
(environ 6 % des cas), est secondaire à la
destruction des cellules bêta du pancréas. Il
en résulte une diminution de la synthèse et de
la sécrétion d’insuline. Cette forme de diabè-
te survient essentiellement chez les enfants et
les jeunes adultes.
Dans cette revue nous n’évoquerons que le
diabète de type 2.
Comment réaliser le
diagnostic du diabète ?
Selon l’OMS,la Haute Autorité de Santé (HAS)
en 2006 et l’American Diabetes Association
(ADA) en 2010,la définition du diabète est biolo-
gique et se caractérise,en dehors de la gros-
sesse,comme suit:
!Une glycémie supérieure à 1,26 g/l (7 mmol/l)
après un jeûne de 8 heures et vérifiée à deux
reprises.
!Ou par la présence de symptômes de diabè-
te (polyurie,polydipsie,amaigrissement) asso-
ciée à une glycémie (sur plasma veineux)
supérieure ou égale à 2 g/l (11.1 mmol/L)
!Ou par une glycémie supérieure ou égale à
2g/l(11,1mmol/l)2heuresaprèsunechar-
ge orale de 75 g de glucose [HAS,
Recommandation professionnelle de bonne
pratique, Traitement médicamenteux du
diabète de type 2,novembre 2006].
En pratique clinique,en l’absence de symp-
tômes,il convient d’obtenir confirmation par
une deuxième mesure glycémique avant de
retenir le diagnostic de diabète.
Dans la réalité quotidienne,l’HGPO n’est que
très peu utilisée et seule la glycémie à jeun est
effectuée.
Le diabète de type 2
Le diabète est une maladie de plus en plus fréquente en France et dans le monde.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que le nombre de personnes diabétiques
atteindra 299 millions en 2025.Cette progression du diabète s’explique en partie par
l’accroissement d’éléments favorisant son développement tel que le vieillissement de la
population,l’augmentation de l’obésité et le manque d’activité physique.
Fig.1 : Évolution de 2001 à 2007 de l’indice de masse corporelle selon le type de diabète et son
traitement en France métropolitaine.Entred 2001 (n = 3324) et Entred 2007 (n = 3377),poids et
tailles auto déclarés [BEH 10 Novembre 2009].
Fig.2:Répartition des niveaux d’IMC par tranche d’âge en population générale [ObEpi 2009].

Que reste-t-il du syndrome
métabolique ?
le et hyper insulinisme),caractéristique de l’in-
sulinorésistance,persiste pendant au moins 10
ans pendant lesquels l’obésité abdominale
s’aggrave progressivement.Au-delà d’un certain
seuil d’accumulation de graisse viscérale
(diagnostic par la mesure du tour de taille),le
profil métabolique du patient change.Il appa-
raît alors progressivement une réduction de
l’insulinosécrétion et maintien de l’insulino-
résistance ce qui constitue l’entrée dans la
maladie diabétique.
Obésité abdominale du patient diabétique de
type, qu’est-ce que c’est?
Les données épidémiologiques montrent que
le surpoids précède souvent le développement
de l’insulinorésistance voire même qu’il serait
un facteur déclenchant et aggravant de l’in-
sulinorésistance. Ce surpoids est particulier,
car il est constitué par un excès d’adiposité au
niveau abdominal.
N° 37 - PAGE 4-LALETTRE DE L’OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT
péritonéale qui sont stockés dans le foie.Au
niveau hépatique,une partie de cet excès lipi-
dique est exportée dans la circulation sous
forme deVLDL puis va être capté par différents
tissus périphériques comme le muscle sque-
lettique et la cellule ß pancréatique.Ainsi,l’ex-
cès d’adiposité abdominale est à l’origine de
l’accumulation de lipides dans le foie,le muscle
squelettique et la cellule ß pancréatique.
Cet impact de l’insulinorésistance et de l’obé-
sité abdominale a été étudié dans l’étude
DESIR.Les résultats de cette étude observa-
tionnelle,confirment que l’adiposité abdomi-
nale est la variable clinique la plus prédictive
du diabète à 9 ans.Cette étude DESIR montre
aussi qu’en ajoutant l’hypertension et le taba-
gisme chez l’homme, et l’hypertension et les
antécédents familiaux de diabète chez la
femme, on obtient un score clinique très
pratique pour le ciblage des actions préventi-
ves du diabète par le médecin généraliste.
La prise en charge du patient
diabétique de type 2
Dans ses recommandations publiées en 2006,
l’HAS fait une place prépondérante et initiale
aux règles hygiéno-diététiques et à l’éducation
thérapeutique [HAS,Recommandation profes-
sionnelle de bonne pratique,Traitement médi-
camenteux du diabète de type 2,novembre
2006].
Les règles hygiéno-diététiques
L’objectif de la prise en charge diététique est
la correction des principales erreurs alimen-
taires qualitatives:celle-ci repose sur la réduc-
tion des lipides surtout saturés, des sucres
simples et de la consommation d’alcool.
La mise en place d’un régime modérément
hypocalorique est nécessaire sachant qu’un
amaigrissement même limité (- 5 % du poids
corporel) apporte un bénéfice glycémique très
significatif.
L’activité physique consiste en des modifica-
tions réalistes du mode de vie quotidien et
autant que possible repose sur trois heures par
semaine d’activité plus intensive adaptée au
profil du patient.
L’éducation thérapeutique est un volet fonda-
mental de la prise en charge de tout patient
diabétique.Elle doit être mise en œuvre dès la
découverte du diabète.
Le syndrome métabolique désigne un ensem-
ble d’anomalies métaboliques et de facteurs
de risque vasculaire agrégés les uns aux
autres.
Il constitue un outil simple et synthétique utile
pour prédire à la fois le risque cardiovascu-
laire et le risque de devenir diabétique (pour
les sujets non diabétiques) surtout si on résu-
me cette définition à la mesure du tour de
taille comme outil de dépistage.
Le syndrome métabolique,le diabète,et l’obé-
sité présentent des points communs: l’insuli-
no résistance et l’obésité abdominale.
L’insulinorésistance, qu’est-ce que c’est ?
L’insulinorésistance correspond à la limitation
des actions de l’insuline sur la régulation de
la glycémie (réduction de la production hépa-
tique de glucose et en augmentation du
transport de glucose dans le muscle squelet-
tique) et sur les contrôles des paramètres lipi-
diques (contrôle de l’hyper triglycéridémie
post-prandiale et stockage dans l’adipocyte
des lipides ingérés).
En conséquence,l’apparition d’une insulino-
résistance provoque une augmentation de l’in-
sulinosécrétion endogène afin de compenser
la réduction de l’effet de l’insuline dans les
tissus périphériques.Cette adaptation de l’in-
sulinosécrétion est un processus fondamental
qui permet de maintenir la glycémie dans des
valeurs normales. Le sujet reste ainsi normo
glycémique tout en ayant un taux élevé d’in-
suline circulante à la fois à jeûn et en post-pran-
diale.Ce profil métabolique (glycémie norma-
Fig.3 : Répartition de la population au-delà des
seuils de tour de taille en fonction de l’âge et
du sexe (en population générale) [Obépi
2009].
La mesure du tour de taille constitue un indi-
cateur majeur et facile à mettre en œuvre.Ce
tour de taille augmente parallèlement à l’ac-
cumulation de tissu gras intra-abdominal (ou
viscéral) et au développement de l’insulino-
résistance.
Ce lien entre tour de taille augmenté,insuli-
norésistance et diabète de type 2 s’explique en
partie par les propriétés particulières du tissu
adipeux intra-abdominal. En effet, ce tissu
adipeux viscéral libère de manière inappro-
priée des acides gras libres dans la circulation

N° 37 - PAGE 5-LALETTRE DE L’OBSERVATOIRE DU MOUVEMENT
diabétiques de type 2 datent de fin 2006.
Tou t e fo i s , depu is 2 0 06 , plu si e u r s n o u ve ll e s cl as -
ses thérapeutiques fondées sur l’activité incré-
tine sont maintenant disponibles en France
dans la prise en charge des patients diabétiques.
En 2010,le Pr.Serge HALIMI a proposé un nouvel
algorithme de prise en charge thérapeutique
fondé plutôt sur des remplacements de classes
médicamenteuses que sur l’empilement .
Ainsi,dans les stratégies de prises en charge
précoces et bien encadrées,une HbA1c située
entre 6,6 et 7,5 à 8 % sous monothérapie metfor-
mine nous incite de plus en plus à ajouter un
inhibiteur des DPP4 (IDPP4 ou gliptines) pour
sa facilité d’usage et sa tranquillité d’emploi pour
le patient et le prescripteur,son absence de toute
hypoglycémie et sa neutralité pondérale.
En conclusion
Le diabète de type 2 est souvent associé à une
obésité abdominale ou à un syndrome méta-
bolique.Dans ce cadre,la pratique régulière
d’une activitéphysiquepermetde:
!Baisser le taux de glycémie;
!Lutter contre l’obésité;
!Maintenir un poids satisfaisant;
!Entretenir le cœur et les artères ;
!Aider à s’arrêter de fumer.
La prise en charge thérapeutique du patient
diabétique de type 2 doit être globale (lutte
contre les facteurs de risque cardiovasculai-
res associés),précoce (mémoire glycémique)
et intensive sans provoquer d’hypoglycémies
sévères souvent délétères.
"Dr Thierry CLAVEL
Activité physique chez le patient diabétique:
pourquoi et comment ?
L’activité physique diminue significativement
la valeur de l’hémoglobine glyquée chez le
diabétique de type 2,mais elle a aussi un effet
préventif sur l’apparition d’un diabète de type
2chezdespatientsàrisque.
On distingue les activités physiques d’endu-
rance des activités de résistance (renforcement
musculaire).
Les premières,correspondent à des exercices
qui mettent en jeu le métabolisme aérobie et
sont souvent peu ou modérément intenses,
mais prolongées.
Les activités de résistance sont des activités de
plus courte durée mais d’intensité plus impor-
tante.Elles augmentent la force musculaire et
la masse maigre ce qui pourrait faciliter l’amé-
lioration de l’équilibre glycémique.
L’amélioration de la capacité cardiorespiratoi-
re et de l’HbA1c serait plus marquée pour les
entraînements d’intensité plus élevée.
Les dernières recommandations américaines
concernantlespatientsdiabétiquesdetype2,
publiées en 2006,sont centrées sur la réduc-
tion du risque cardiovasculaire,l’amélioration
de l’HbA1c et le maintien du poids.Elles asso-
cient:
!Des exercices de type endurance; 150 minu-
tes par semaine d’intensité modérée, ou 90
minutes par semaine d’intensité plus impor-
tante sur au moins 3 jours par semaine ;
!Et des exercices de renforcement musculai-
re;trois séries d’exercices avec des périodes
de récupération de 1 à 2 minutes entre
chaque série ;
!Il s’agit d’activité d’intensité modérée à
élevée,recommandée 3 fois par semaine.Au-
delà des recommandations, le problème
majeur demeure la faisabilité,la motivation
et l’observance des patients sur le long terme.
La prise en charge thérapeutique
Les recommandations françaises de la Haute
Autorité de santé (HAS) pour le traitement des
Chez le diabétique de type 2 Chez le diabétique de type 1
Effet hypoglycémiant.
Baisse de l’hémoglobine glyquée :- 0.6 % pour 3 séances
par semaine de 1 heure chacune d’intensité modérée
Diminution de la glycémie immédiate et post-prandiale
Meilleure sensibilité périphérique à l’insuline grâce à
l’augmentation du débit vasculaire
Augmentation de l’insulino-sensibilité
Modification du profil lipidique dans un sens moins athé-
rogène (LDL HDL)
Modification du profil lipidique
Diminution de la TA Effets psychologiques (la personne peut continuer une
activité physique)
En pratique: impact de l’activité physique dans la prise en charge du patient diabétique
Exemples d’activité physique possible et leur impact métabolique.
Proposition de prise en charge thérapeutique [La revue du PraticienVol.60,20 avril 2010].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%