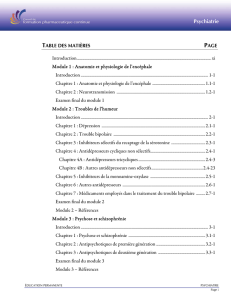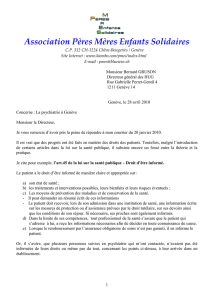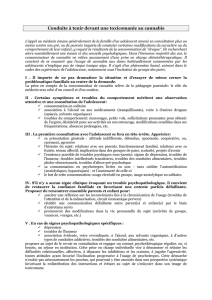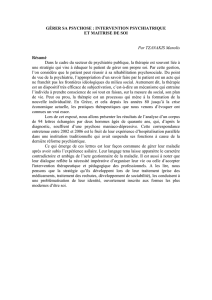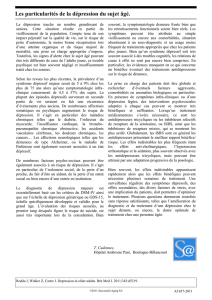Quelles nouveautés thérapeutiques ? PSYCHIATRIE 17

© Garo/Phanie
© Alix/Phanie
‰
Quels sont les apports de la
neuro-imagerie à la compréhen-
sion des effets du méthylphéni-
date (employé dans le traitement
de l’hyper-activité de l’enfant) ?
Le docteur Jim Rosack a mis en
évidence l’action du méthylphéni-
date au niveau du cerveau en uti-
lisant le PET Scan. Cette sub-
stance utilisée dans le traitement
du syndrome d’hyper-activité
chez l’enfant (également utilisé
dans la même pathologie chez
les adultes) serait capable d’aug-
menter de manière significative la
dopamine extracellulaire après
que les sujets en aient consom-
mé par voie orale. De là à penser
que son effet thérapeutique s’ex-
plique par le fait que les sujets
malades manifestent des symp-
tômes secondaires à une insuffi-
sance de dopamine extra-cellu-
laire…
‰
Comment transformer des
rats infidèles en rats respectant
les règles interdisant l’adultère ?
Le professeur Sapolsky qui tra-
vaille dans le département des
neurosciences à l’Université de
Stanford étudie les effets de la
thérapie génique chez l’animal, le
rat étant très proche de l’homme
du point de vue génétique. En
traitant des rats naturellement
polygames par thérapie génique
c’est-à-dire en introduisant dans
leur matériel génétique certains
gènes issus d’espèces mono-
games, il a observé que les rats
traités devenaient fidèles.
‰
Application thérapeutique
potentielle de l’utilisation d’un
gène de tortue aquatique au
traitement des conséquences
d’AVC.
Les dommages post-AVC sont
consécutifs au manque d’oxygène
des neurones privés de la vas-
cularisation indispensable. L’idée
du
professeur Sapolsky a donc consisté
à envisager de donner les moyens
aux neurones du cerveau de rats
Psychiatrie
Quelles nouveautés thérapeutiques ?
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 62 • mars-avril 2005
>> DOSSIER
PSYCHIATRIE 17
Ce tour d’horizon n’a pas la prétention d’être exhaustif
mais de présenter une sélection de travaux publiés en
2004 dans la littérature en psychiatrie. Nous examine-
rons successivement des travaux de neuro-imagerie,
l’apport de la génétique et les balbutiements de la théra-
pie génique appliquée à la psychiatrie, les guidelines bri-
tanniques dans le domaine du traitement et de la prise en
charge des états dépressifs et des troubles anxieux, la
question brûlante et très débattue voire polémique de la
prescription des antidépresseurs chez les adolescents,
des éléments de nutrition et leur pertinence dans le trai-
tement des troubles de l’humeur, les facteurs de risque
de schizophrénie et enfin les relations complexes que le
cannabis entretient avec la psychose.
>>
Sommaire
•Santé mentale
•Adolescence et conduites à risque
•Troubles bipolaires et schizophrénie
•Les psychoses hallucinatoires chroniques
•Dépression
•L’état de stress post-traumatique
•Antidépresseurs
Réalisé avec la participation de notre publication
Les Actualités en psychiatrie

chez lesquels était provoqués des
AVC à mieux résister à l’hypoxie ou
à l’anoxie. L’observation des tortues
aquatiques capables de plonger à
des profondeurs considérables sans
dommage au niveau cérébral est la
conséquence des effets protecteurs
d’un gène qui leur confère une
dépendance neuronale à l’oxygène
moindre. L’équipe du professeur
Sapolsky étudie la possibilité d’intro-
duire ce gène de tortue chez le rat
et de mesurer sa résistance neuro-
nale au manque d’oxygène post-
AVC. À suivre…
Le professeur Sapolsky a été inter-
rogé sur l’avenir des thérapies
géniques en psychiatrie et a souli-
gné que si ces nouvelles thérapies
étaient susceptibles de belles pro-
messes en psychiatrie, les psycho-
thérapies ne disparaîtraient pas,
les patients auront toujours
besoin qu’on les écoute…
‰
L’utilisation thérapeutique de
certaines plantes en psychiatrie :
évolution dans l’APA (American
Psychiatric Association).
Dans la prochaine édition du
congrès de l’APA en 2005, une
section sera consacrée à l’étude
des usages thérapeutiques des
plantes en psychiatrie. Cela ne
s’était plus produit depuis 1960 !
Rappelons que les principales
plantes utilisées en psychiatrie,
outre le millepertuis en Allema-
gne pour traiter l’état dépressif
sont le Kava Kava (Piper
Methysticum), le Ginkgo Biloba
(arbre japonais), la Valériane
(Valeriana Officinalis) qui sont
connus pour affecter l’humeur ou
la cognition (mémoire, attention,
motivation). Toutes ces sub-
stances diminuent le métabo-
lisme des substrats des 1A2 qui
détruisent des substances telles
que la caféine, la théophylline,
mais aussi l’halopéridol (Haldol®),
la clozapine (Leponex®), l’olanza-
pine (Zyprexa®) et l’amitriptyline
(Laroxyl®) ou l’imipramine (Tofra-
nil®). À titre d’exemple, les effets
de la dose de Zyprexa®lorsqu’elle
est coprescrite avec l’herbe de
Saint John’s wort sont tout sim-
plement triplés ! En effet, cette
herbe est capable de rendre
inopérante la dégradation du
Zyprexa®par les systèmes enzy-
matiques du foie ; en consé-
quence ses effets en sont très
augmentés et prolongés. L’herbe
de Saint John’s wort serait sus-
ceptible d’augmenter la dopa-
mine au niveau du système
nigrostrié (noyaux gris de la base
du cerveau régulant la dopamine,
au niveau desquels le manque de
dopamine entraîne des effets
extrapyramidaux sous neurolep-
tiques). Cette observation pourrait
expliquer la relative protection
dont les patients qui consom-
ment cette herbe jouissent vis-à-
vis des effets secondaires extrapy-
ramidaux (raideur, tremblements)
des patients traités par neurolep-
tiques.
Autre observation intéressante :
l’Auyrdeva originaire de la région
Est de l’Inde aurait des effets
potentialisateurs des traitements
utilisés en psychiatrie.
Un des plus récents exemples
d’utilisation de l’inhibition sélec-
tive du métabolisme du CYP 450
concerne une découverte encou-
rageante publiée dans la revue
Nature et qui montre que des
sujets ayant un déficit génétique
en 2A6 qui métabolise la nicotine
sont très peu enclins à débuter
un tabagisme ou bien si ces
sujets fument, ils consomment
très peu de tabac. L’avenir dans la
lutte contre le tabagisme serait à
la recherche d’une substance à
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 62 • mars-avril 2005
effet antabuse de la nicotine.
‰
Les Guidelines d’utilisation
des traitements et de la prise en
charge des patients souffrant
d’état dépressif et de troubles
anxieux ont été publiés par
l’Agence Britannique de Régula-
tion des traitements et des pro-
duits de Santé (la MHRA), équi-
valent de la FDA Américaine ou
de la toute récente Haute Auto-
rité Sanitaire en France.
Ces Guidelines peuvent être résu-
més essentiellement de la maniè-
re suivante :
•L’utilisation des IRS (Inhibiteurs
du Recaptage de la Sérotonine)
chez les adultes se justifie par le
ratio bénéfice/risque positif de
ces substances.
•Le suivi régulier des patients trai-
tés par IRS.
•Pour les états dépressifs d’inten-
sité légère à modérée, la psycho-
thérapie est recommandée en pre-
mier, en mettant l’accent sur
l’apprentissage de la résolution de
problèmes, la thérapie cognitivo-
comportementale, les conseils. Ces
méthodes se révéleraient aussi effi-
caces que les médicaments.
•Les antidépresseurs ne doivent
pas être utilisés pour traiter les
états dépressifs d’intensité légère
car leur ratio bénéfice/risque est
faible.
•Lorsqu’un antidépresseur est
prescrit dans un état dépressif
d’intensité moyenne à sévère, un
IRS doit être préféré à un tricy-
clique de première intention en
raison du risque de cette dernière
Infos ...
Les médicaments
psychotropes
Presque toutes les
civilisations humaines ont
utilisé des substances
naturelles afin de
soulager des souffrances
physiques et/ou
psychiques. Le terme
psychotrope apparaît à la
fin du 19
e
siècle. J.F.
Cade découvre le sel de
lithium en 1949 pour trai-
ter la psychose maniaco-
dépressive. H. Laborit
découvre en 1952 la
chlopromazine, premier
psychotrope
nommé
neuroleptique.
À ce jour, il
y a cinq grandes familles
de médicaments
psychotropes : les
antidépesseurs, les
neuroleptiques, les
hypnotiques, les
anxuilytiques et les
régulateurs de l’humeur.
DOSSIER
18
>>
>> DOSSIER
© Voisin/Phanie

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 62 • mars-avril 2005
classe thérapeutique.
•Tous les patients doivent être
informés que l’arrêt d’un traite-
ment antidépresseur doit être
progressif au risque de voir appa-
raître des symptômes de sevrage.
•Les groupes de patients à risque
en ce qui concerne l’utilisation des
antidépresseurs sont les patients à
antécédents dépressifs, les pa-
tients malades d’une pathologie
somatique, les états dépressifs
d’intensité sévère et les patients
qui présentent un état de dégéné-
rescence ou une démence.
•Pour les patients souffrant d’état
dépressif d’intensité sévère, la
thérapie cognitivo-comportemen-
tale doit être associée aux antidé-
presseurs.
En ce qui concerne les guidelines
consacrés aux troubles anxieux,
l’ordre préconisé dans lequel doi-
vent être proposés les traitements
est le suivant : la thérapie cogniti-
vocomportementale, puis un IRS
ayant l’AMM (Autorisation de
Mise sur le Marché) dans le
trouble anxieux généralisé, ces
techniques doivent être utilisées
avec des informations de soutien
écrites basées sur la thérapie
cognitivo-comportementale.
‰
Qu’en est-il de la controverse
actuelle sur l’utilisation des anti-
dépresseurs chez les mineurs, et
les ados ?
Dans un communiqué rendu pu-
blic le 9 décembre 2003, l’Agence
Européenne pour l’Évaluation des
Médicaments (EMEA) recom-
mande de ne pas prescrire d’anti-
dépresseurs aux enfants et aux
adolescents : « dans l’union euro-
péenne, les antidépresseurs de la
classe des inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine
n’ont pas l’indication dans le trai-
tement de la dépression chez les
moins de 18 ans. Leur prescrip-
tion est déconseillée dans cette
population en raison d’une aug-
mentation du risque de compor-
tement suicidaire et de compor-
tement agressif mis en évidence
chez ces patients ». L’Agence
Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé (AFSSAPS)
a repris avec certaines précisions
ces recommandations euro-
péennes : « le traitement de pre-
mière intention de l’enfant et de
l’adolescent est une prise en
charge psychothérapeutique, et
la prescription d’antidépresseurs,
si elle est envisagée, ne doit inter-
venir qu’en seconde intention
dans le cadre d’une dépression
majeure, avec une prise en
compte de l’ensemble des béné-
fices attendus et des risques pos-
sibles ».
Cette polémique concerne princi-
palement la prescription des anti-
dépresseurs et plus particulière-
ment des inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine
(ISRS) chez l’adolescent. La pro-
blématique de la dépression à
l’adolescence est complexe et les
débats sur le diagnostic et la prise
en charge sont anciens. Le pre-
mier point est la difficulté de dia-
gnostiquer un épisode dépressif
chez l’adolescent : la sémiologie
est très variée et le risque est de
traiter excessivement des troubles
d’allure dépressive, témoins d’un
mal-être fréquent à cette période,
ou, à l’inverse, de sous-estimer un
épisode dépressif dont la présen-
tation est souvent atypique, no-
tamment une irritabilité, par rap-
port à la sémiologie décrite chez
l’adulte. Le second point concer-
ne les modalités de prise en
charge de ces épisodes. Nous
rappellerons la prise en charge
communément admise en Fran-
ce. La prise en charge des adoles-
cents déprimés repose sur plu-
sieurs axes thérapeutiques : une
évaluation par un spécialiste, une
aide psychologique pour l’adoles-
cent et pour ses parents, un traite-
ment médicamenteux dans les
dépressions sévères, et en cas
d’hospitalisation un étayage insti-
tutionnel.
La prescription d’antidépresseur
chez l’adulte a prouvé son effica-
cité. Cependant, les particularités
cliniques, neurobiologiques et
physiologiques d’un individu en
voie de développement rendent
hasardeuse une analogie trop
rapide entre l’adulte et l’enfant
même si un lien existe entre
dépression de l’adulte et dépres-
sion de l’adolescent. Le débat et
la mise au point suscité par
l’EMEA et l’AFFSSAPS sur l’intérêt
de l’utilisation des antidépres-
seurs chez le sujet jeune permet-
tent de relancer la réflexion des
professionnels de santé sur les
modalités de prise en charge d’un
adolescent déprimé.
‰
Prise en charge médicamen-
teuse : des traitements contro-
versés.
Les deux classes d’antidépres-
seurs les plus fréquemment utili-
sés sont les tricycliques et les inhi-
biteurs sélectifs de la recapture de
la sérotonine (ISRS) mais aucun
n’a d’indication officielle chez l’en-
fant de moins de 15 ans.
•Les tricycliques sont les antidé-
presseurs les plus anciens. L’inter-
prétation et les résultats des diffé-
rents essais cliniques sont très
>>
>> DOSSIER
PSYCHIATRIE 19
© Burger/Phanie

hétérogènes. En regroupant les
différents résultats il n’apparaît
pas un effet significativement dif-
férent à court terme de ces traite-
ments par rapport au placebo.
Outre les difficultés méthodolo-
giques d’évaluation, une des
explications de ces mauvais résul-
tats pourrait être liée au taux
élevé de dépression atypique
chez l’adolescent dont on sait
chez l’adulte qu’elles sont plus
sensibles aux IMAO qu’aux tricy-
cliques.
•Les antidépresseurs de seconde
génération les plus utilisés sont la
fluoxétine, la paroxétine, la sertra-
line, le citalopram et la venla-
faxine. Leur utilisation est plus
encourageante que celle des tri-
cycliques mais reste discutée
comme le montre une méta-ana-
lyse des résultats des essais
contrôlés – publiés ou non
publiés mais utilisés par le
“Committee on Safety Medecine”
– évaluant les ISRS versus pla-
cebo chez les 5-18 ans déprimés
(parue dans Lancet en 2004).
Ces auteurs concluent que
2 essais publiés suggèrent que la
fluoxétine à un “profile” béné-
fice/risque favorable. Ce profile
tendant à être confirmé par les
données non publiées. Une étu-
de publiée sur la paroxétine et
deux sur la sertraline montrent au
mieux un “profile” bénéfices/
risques (notamment idéations
suicidaires et tentatives de sui-
cides) faiblement favorable non
corroboré par les données non-
publiées où les risques semblent
l’emporter sur les bénéfices.
Quant aux données non publiées
sur le citalopram et la venlafaxine,
elles font état d’un “profile” béné-
fices/risque défavorable.
Ces résultats confirment l’impor-
tance de réaliser des études
contrôlées spécifiques chez les
enfants et les adolescents. Les
instruments utilisés dans l’évalua-
tion en psychiatrie de l’enfant et
l’adolescent sont généralement
inspirés de ceux employés chez
l’adulte. La validation par tranche
d’âge reste limité. La prise en
considération du milieu familial et
social auxquels l’adolescent est
particulièrement sensible, ainsi
que de l’effet placebo – qui
semble plus important chez l’ado-
lescent – doivent être mieux pris
en considération en élaborant des
méthodologies plus spécifiques.
‰
Les psychothérapies.
L’aide psychologique pour l’ado-
lescent est indispensable. Elle
apparaît être le traitement de choix
des troubles dépressifs d’intensité
légère à modérée. Plusieurs tech-
niques sont envisageables en
fonction des situations :
•La psychothérapie de soutien :
pouvant être pratiquée par le
médecin traitant, elle cherche, par
une attitude attentive, sans juge-
ment de valeur, à rétablir l’équi-
libre psychologique du patient en
faisant appel à plusieurs types
d’attitudes comme la réassurance
et le conseil.
•La psychothérapie d’inspiration
analytique peut être appliquée
une fois le noyau dépressif un
peu diminué en fonction des pos-
sibilités d’expression du patient.
•Le psychodrame particulière-
ment indiqué quand l’inhibition
est importante propose au patient
de jouer des scènes dont il aura
imaginé la trame.
•La thérapie cognitivo-comporte-
mentale cherche à reformuler les
pen
sées irrationnelles (peurs, crain-
tes,
croyances...) de l’adolescent.
‰
Quand hospitaliser ?
L’hospitalisation s’impose lorsqu’il
existe un risque pour la sécurité
psychique ou physique de l’adoles-
cent :
– contexte familial ou social
dépassé ou déficient ;
– dépression d’intensité sévère
et/ou comportant des risques
vitaux (risque d’actes auto ou
hétéro-aggressifs, conduites à
risques, conduites addictives...) ;
– traitement ambulatoire, psycho-
thérapie et/ou médicamenteux
n’ayant pas permis une améliora-
tion après 3 à 4 mois.
Il est préférable d’hospitaliser les
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 62 • mars-avril 2005
enfants et les adolescents dans
des lieux conçus pour eux avec
des équipes habituées à les
accueillir.
‰
Nutrition et traitement de la
dépression.
Manger du poisson, riche en
acides gras Omega 3 présents
dans le thon ou le saumon peut
avoir une action antidépressive.
On a observé une chute des
acides gras Omega 3 dans l’ali-
mentation des pays occidentaux
au cours des cent dernières
années. En revanche, les Ome-
ga 6 contenus dans le maïs, les
graines de sésame, les graines de
coton sont 20 fois plus nombreux
que les Omega 3. Le Collège
américain de nutrition recom-
mande un ratio Omega 3/
Omega 6 de 1. L’âge de début de
la dépression a diminué conti-
nuellement ces 100 dernières
années. Cette observation peut
être mise sur le compte d’un
changement d’attitude des pro-
fessionnels de la santé, d’une
modification des critères diagnos-
tiques, d’un biais d’observation ou
bien d’artefacts divers. Le docteur
Joseph Hibbeln du National
Institute of Health (NIH) a mon-
tré qu’une consommation de
poisson diminue le risque de
dépression. La chute des Omega 3
entraînerait un déficit de séroto-
nine et de dopamine et une alté-
ration de leur métabolisme. Un
déficit en Omega 3 serait suscep-
tible d’altérer la barrière hémato-
Infos ...
Les psychothérapies
Il faut se méfier des
approches “à la mode”,
“nouvelle vague”, qui promet-
tent des résultats miraculeux
ou ultra-rapides.De telles
“psychothérapies” s’avèrent
la plupart du temps
décevantes, onéreuses et
peuvent même nuire. Le
débat s'avère nécessaire pour
mettre de l'ordre dans la
profession.
On distingue quatre
principales orientations
théoriques qui se
différencient par leur origine,
les techniques employées,
ainsi que par les aspects du
développement privilégié.
Ce sont : l’orientation
psychodynamique/
analytique ;
l’orientation
existentielle/humaniste ;
l’orientation béhaviorale/
cognitive ; l’orientation
systémique/interactionnelle.
DOSSIER
20
>>
>> DOSSIER
© Voisin/Phanie

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 62 • mars-avril 2005
méningée. Une équipe de Har-
vard a montré qu’un gramme
d’acide éicosapentanoïque aurait
des effets régulateurs de l’hu-
meur et serait bénéfique dans le
traitement des troubles de la per-
sonnalité de type Border-line
caractérisés par des tendances
dépressives et de l’agressivité.
‰
Neurosciences.
Olivier Mason à Londres a étudié
les critères permettant à des indi-
vidus à risque de développer une
psychose et constaté que 50 à
60 % des sujets identifiés étaient
en réalité des faux positifs c’est-à-
dire qu’ils ne développaient pas
d’état psychotique. Cet auteur a
donc mené une étude ayant pour
objectif de déterminer si l’histoire
familiale, les complications péri-
natales, le fonctionnement social
prémorbide, les événements de
vie récents et les symptômes
étaient susceptibles d’améliorer la
valeur prédictive d’une évolution
psychotique chez les sujets jeu-
nes qui consultaient en raison de
leur connaissance de facteurs de
risque.
Cette étude réalisée chez 74 sujets
suivis un an après la première éva-
luation clinique a montré que
50 % des sujets développaient
une psychose mais surtout que le
meilleur élément prédictif de cette
évolution était le degré des carac-
téristiques de la personnalité de
type schizotypique. Par exemple,
cet auteur a montré que lorsque
des individus développaient un
ratio de pensées magiques élevé,
un déficit de fonctionnement, des
troubles de l’affectivité, une anhé-
donie (perte de la capacité à se
procurer du plaisir), le fait d’être
peu sociable et des hallucinations
auditives, on constatait une prédic-
tivité de 84 % en sensibilité
(degré avec lequel la mesure se
révèle mesurer finement la va-
riable qu’elle doit mesurer) et de
86 % en spécificité (degré selon
lequel la mesure est capable de
mesurer uniquement la variable
pour laquelle elle a été choisie).
La difficulté de ces études est liée
à la pertinence des facteurs de
risque choisis en terme de pré-
vention. On identifie des sujets à
risque de la manière suivante
(Young et al., 1998) :
•symptômes psychotiques atté-
nués ;
•symptômes psychotiques francs
mais transitoires (une semaine) ;
•facteurs de risque de type trait
(personnalité) et état (réactionnel
à un contexte) : apparentés de
premier degré avec antécédents
psychotiques ou personnalité psy-
chotique, déficit du fonctionne-
ment général.
Parmi ces sujets 40 % ont déve-
loppé une psychose dans les six
mois, 35 % dans les douze mois
(Young et al., 2004).
‰
À propos du cannabis et du
risque de devenir schizophrène…
En Australie (Institut des Bio-
sciences Moléculaires de l’Uni-
versité du Queensland) Hall W.,
Dogenhardt L. et Teesson M. ont
examiné trois hypothèses à la
lumière de données issues
d’études épidémiologiques pros-
pectives récentes.
•La première hypothèse soutient
que le cannabis provoque une
psychose qui ne se serait jamais
produite si le sujet n’avait pas
fumé de cannabis.
•La deuxième hypothèse avance
que le cannabis précipite l’appari-
tion d’une schizophrénie ou
aggrave ses symptômes.
•Troisième hypothèse : le canna-
bis exacerbe les symptômes de
psychose.
On peut résumer les travaux de
ces auteurs en disant que peu
d’arguments sont en faveur de la
première hypothèse, un certain
nombre d’arguments valident la
seconde. En effet, quatre études
prospectives dans trois pays diffé-
rents ont mis en évidence un lien
entre la fréquence d’utilisation du
cannabis et le risque d’être dia-
gnostiqué schizophrène ou de
manifester des symptômes psy-
chotiques.
Ces liens sont plus forts chez les
sujets ayant une histoire de
symptômes psychotiques et per-
sistent après ajustement des
autres variables confondantes.
L’absence de modification de l’in-
cidence de la schizophrénie
durant les trois dernières décades
d’utilisation du cannabis en
Australie rend peu probable l’hy-
pothèse que le cannabis puisse
produire une psychose qui ne se
serait jamais manifestée si le sujet
n’avait pas fumé.
En conclusion, le cannabis peut
précipiter une schizophrénie chez
les sujets vulnérables. On ne peut
écarter la troisième hypothèse de
l’exacerbation de symptômes de
la psychose par le cannabis.
Conclusion
Les recherches que nous avons
mentionné dans cet article nous
enseignent que les méthodes
d’étude applicables en psychiatrie
sont très hétérogènes et que cha-
cune d’entre elles contribue à
l’avancée des connaissances sur
les effets des psychotropes, les
mécanismes à l’œuvre en psy-
chopathologie, les facteurs de
risque, les nouvelles thérapeu-
tiques, etc… Mais nous devons
absolument mous souvenir que
la grande majorité de ces études
est issue d’une seule discipline, la
plus importante, qui font de la
démarche expérimentale, c’est-à-
dire la clinique (science de l’ob-
servation !). Bonnes lectures et
surtout, bonnes observations.
Pr Charles-Siegfried Peretti,
Dr Florian Ferreri
Service de psychiatrie,
CHU Hôpital Saint-Antoine, Paris
Références bibliographiques
– Müller WE, Rolli M, Schafer C, Hagner
U. (1997) Effects of Hypericum extract (LI
160) in biochemical of antidepressant
activity. Pharmacopsychiatry, 30 (Suppl.2):
102-7.
– Young AR, Phillips LJ, Yuen HP, Mc
Gorry PD. (2004) Risk Factors for
Psychosis in an ultra high-risk group : psy-
chopathology and clinical features.
Schizophrenia Research, 67, 131-142.
– Hall W, Dogenhardt L, Teesson
M. (2004) Cannabis use and psychotic
disorders : an update. Drugs Alcohol Rev.
>> DOSSIER
PSYCHIATRIE 21
1
/
5
100%