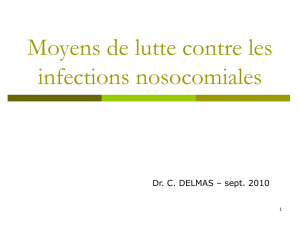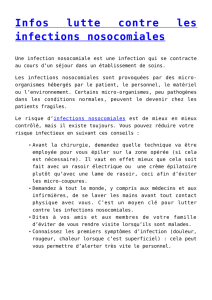D’Hippocrate aux CLIN Hygiène

L
es maladies infectieuses “bénéficient” aujour-
d’hui d’un regain d’intérêt lié à la découverte
Une progression cahotique
Si, au XVIIIesiècle, les médecins de l’époque s’in-
téressent enfin aux comportements des individus
et à leurs conditions de vie (propreté du corps,
de la maison et de l’alimentation), ce n’est que
dans la première moitié du XIXesiècle que la mé-
decine devient véritablement scientifique : de-
vant l’organisation économique du monde, les
hygiénistes sont confrontés aux nouveaux pro-
blèmes engendrés par la naissance de l’ère in-
dustrielle. La lutte contre l’hospitalisme peut
commencer : hygiène hospitalière, antisepsie lis-
térienne (1867) et asepsie physique pasteurienne
(vers 1880).
Pour autant, l’hygiène va quand même suivre en-
suite une progression cahotique, freinée par les
deux guerres mondiales de 1914-1918 et 1939-
1945. Il faudra attendre les années 60 pour
qu’elle revienne en force et devienne une disci-
pline dont l’importance est aujourd’hui recon-
nue. Cette reconnaissance a été “officialisée” en
mai 1988, par la mise en place, imposée par dé-
cret, des CLIN (Comités de lutte contre les in-
fections nosocomiales), puis en septembre 1996,
lorsque la première Conférence nationale de
santé a fait de la lutte contre les infections noso-
comiales l’une des dix priorités pour la France.
Entre 1998 et 2001, les pouvoirs publics y ont
consacré plus de 120 millions d’euros, notam-
ment pour renforcer les équipes d’hygiène, fi-
nancer les actions d’amélioration de la sécurité
de la stérilisation et de la désinfection, ainsi que
les dispositifs médicaux à usage unique. En
2002, plus de 45 millions d’euros ont été déga-
gés pour poursuivre ces actions.
Stéphane Henri
Hygiène
D’Hippocrate aux CLIN
Reconnue aujourd’hui comme une discipline à part entière,
l’hygiène est une notion qui remonte à l’Antiquité.
Elle joue un rôle fondamental dans l’éradication des épidémies.
Elle est actuellement le seul remède contre les infections
nosocomiales.
17
Professions Santé Infirmier Infirmière - No37 - mai 2002
Sommaire
• Infections nosocomiales :
une lutte continue
• Le lavage des mains : pour éviter
les infections manuportées
• Les eaux : sous haute surveillance
• Linge hospitalier :
un rôle protecteur à préserver
• Déchets : les règles
de l’élimination
• Contamination :
les soignants concernés
• Les antiseptiques :
rappels pratiques
• Les antibiotiques :
efficacité désormais limitée
de nouvelles infections ou de micro-organismes
pathogènes. La communauté scientifique et mé-
dicale a en effet reconnu assez récemment le
fait que ces maladies infectieuses restent l’un
des problèmes fondamentaux de l’humanité. Pre-
mières causes de mortalité dans les pays à faible
niveau de développement, elles augmentent
aussi dans les pays industrialisés, notamment
chez les patients fragilisés par l’âge ou les mala-
dies intercurrentes, qui constituent des cibles
de choix pour les microbes. L’hôpital est ainsi
devenu la source d’une grande partie des infec-
tions sévères.
Pourtant, les hommes possèdent une connais-
sance empirique de la désinfection depuis des
millénaires. La médecine antique, représentée
par Hippocrate et Galien, est qualifiée de “natu-
riste”, car elle exprime l’idée de natura medica-
trix : c’est elle qui développera l’hygiène, l’utili-
sation des plantes et le thermalisme.
Ce n’est cependant qu’au milieu du xVIesiècle
que les épidémies seront directement liées à
l’air malsain qui, selon les médecins, exerce une
influence sur l’organisme. S’appuyant sur l’ana-
lyse de différentes maladies, le professeur italien
Girolamo Frascator (1483-1553), considéré
comme le créateur de l’épidémiologie et le père
de la pathologie moderne, distingue le premier
deux modes de contamination : directe, d’indi-
vidu à individu, et indirecte, via des seminaria
transportés par l’air, les vêtements, les objets, etc.
Il incite alors les autorités administratives à
établir, en cas de contagion, des systèmes de
quarantaine.

18
L
es infections nosocomiales désignent, par dé-
finition, les infections contractées lors d’un
Elles génèrent en outre des coûts importants :
elles sont notamment responsables de 2 à 5 %
des journées d’hospitalisation en court séjour.
Globalement, trois causes principales sont à leur
origine : le terrain (malades affaiblis), les soins
invasifs et l’hygiène, en raison de la présence de
bactéries multirésistantes.
Pas de risque zéro
Parmi les causes du risque infectieux, les plus im-
portantes sont constituées par les patients et le
personnel : chacun est porteur d’un grand
nombre de germes dont la nature et la quantité
varient selon la partie du corps concerné. Mais
certains traitements à base d’antibiotiques ou
certains actes invasifs (sondes urinaires, intuba-
tions, cathéters, interventions chirurgicales...)
peuvent perturber cet équilibre naturel : en se
déplaçant ou en se renforçant, des germes jus-
qu’alors bénéfiques pour la santé risquent de
devenir sources de maladie. On parle alors d’une
infection d’origine “endogène” puisque les pa-
tients s’infectent eux-mêmes.
Le contact direct avec d’autres personnes, en
particulier par les mains, ou indirect, par l’in-
termédiaire du matériel de soins (notamment
celui utilisé durant les actes invasifs), du linge,
de l’environnement (bâtiment, alimentation,
eau, air) représentent autant de sources pos-
sibles de contamination, dites “exogènes”. Ces
contaminations sont d’autant plus nombreuses
que les malades, comme le personnel, effec-
tuent de fréquents déplacements au sein de
l’établissement.
L’apparition d’une infection nosocomiale est
aussi favorisée par l’état général, l’âge et la si-
tuation médicale du malade. Les prématurés,
les immunodéprimés, les polytraumatisés, les
diabétiques et les grands brûlés sont également
très réceptifs. Logiquement, la fréquence des in-
fections nosocomiales est donc plus élevée
dans les services prenant en charge des cas
lourds et dans ceux où les actes invasifs sont les
plus nombreux, comme les services de réani-
mation et de chirurgie.
Professions Santé Infirmier Infirmière - No37 - mai 2002
Hygiène
Infections nosocomiales
Une lutte continue
La prise de conscience que les infections acquises à l’hôpital représentent un problème
de santé publique majeur est manifeste dans le monde hospitalier : leur taux est
aujourd’hui un indicateur de la qualité des soins.
séjour dans un établissement de soins. Autrefois
inévitables – on les appelait “pourriture d’hôpi-
tal” –, elles auraient dû pratiquement disparaître
avec la venue de l’asepsie, puis des antibio-
tiques. Ce n’est pourtant pas le cas. En dépit
d’indéniables efforts (voir en encadré), elles tuent
chaque année en France plus que les accidents
de la route : on estime qu’elles seraient à l’ori-
gine d’environ 10 000 décès par an, soit 2 %
des patients.
Les infections nosocomiales sont clairement
considérées aujourd’hui comme un bon mar-
queur de non-qualité. Elles induisent une mor-
bidité importante et une surmortalité non négli-
geable même si, faute de données nationales
précises, il est difficile de les chiffrer avec certi-
tude. On estime néanmoins que 600 000 à
1000 000 d’infections sont acquises à l’hôpital.
Staphylocoques
(microscope électronique
àbalayage).
©CMEABG-UCBL/Phanie

En la matière, comme dans de nombreux
autres domaines d’ailleurs, le risque zéro
n’existe évidemment pas. Mais, même s’il est
admis que ce type d’infection existera tou-
jours, l’hygiène – ou plutôt le manque d’hy-
giène – est identifié comme étant le principal
facteur de propagation de ce fléau. D’où la mise
en place, en 1995, d’un plan quinquennal de
lutte contre les infections nosocomiales, dont
l’objectif était de réduire leur taux moyen de
30 % d’ici l’an 2000.
La vigilance de tous
Auparavant, la lutte contre les infections noso-
comiales dans les hôpitaux français, aujourd’hui
totalement opérationnelle, avait été organisée
par le décret du 8 mai 1988 relatif à l’organisa-
tion de leur surveillance et de leur prévention,
et par sa circulaire d’application définissant les
missions des CLIN. Depuis, l’organisation ré-
gionale et nationale a été complétée par l’arrêté
du 3 août 1992, annonçant la mise en place de
cinq Centres de coordination inter-régionaux
(C.CLIN) et d’un Comité technique des infec-
tions nosocomiales (CTIN).
Pour mener à bien leurs missions, les CLIN sont,
rappelons-le, relayés par une équipe opération-
nelle. Des référents en hygiène hospitalière peu-
vent également être désignés dans chaque ser-
vice, pour favoriser la mise en œuvre de ces
actions ainsi que l’implication des personnels de
santé à tous les niveaux.
Car la prévention repose sur la vigilance quoti-
dienne et générale de tout le personnel. Les pro-
fessionnels de santé et les personnels adminis-
tratifs sont en effet responsables de la prise en
compte du risque infectieux dans leur pratique
quotidienne. Quant à la direction et à la Com-
mission médicale d’établissement, elles doivent
veiller au respect des obligations et à l’améliora-
tion de la qualité des soins en termes d’hygiène
hospitalière.
Résistance aux antibiotiques
Le système d’alerte se trouve aujourd’hui ren-
forcé par la mise en place d’un dispositif de
signalement des infections nosocomiales : le
décret 2001-671 du 26 juillet 2001 (art. R711-
1-12 du Code de la santé publique) détermine
la nature des infections nosocomiales soumises
à signalement et fixe les conditions dans les-
quelles les établissements de santé sont tenus de
recueillir les informations les concernant et de
les signaler.
A l’évidence, le travail des CLIN sera de plus en
plus considéré comme un élément de qualité
19
Professions Santé Infirmier Infirmière - No37 - mai 2002
Une mobilisation payante
Bernard Kouchner, le ministre délégué à la Santé, a
annoncé, le 5 mars dernier, une diminution sen-
sible des infections nosocomiales dans les établis-
sements de soins français qu’il attribue – à juste
titre – à la mobilisation des professionnels de santé.
En effet, 1 533 hôpitaux et cliniques, représentant
78 % des lits d’hospitalisation, ont participé à
l’enquête de prévalence de 2001 contre 800 en
1996. Quant au nombre de services qui partici-
pent au réseau de surveillance en continu, il s’ac-
croît sans cesse : près de 1 200 services en 1999,
soit 5 fois plus qu’en 1994.
Le taux de patients infectés observé en 2001 est
de 6,9 % contre 8 % en 1996. «Si la comparai-
son brute de ces taux doit être prudente en rai-
son des différences méthodologiques entre les
deux enquêtes de prévalence, l’observation d’une
réduction du taux d’infections de 13 % dans les
CHU et de 24 % dans les CH est tout de même
encourageante, et probablement significative, a
constaté le ministre. Ces évolutions nous incitent
à penser que l’amélioration de la formation et de
la connaissance en hygiène, ainsi que les mesures
de prévention adoptées, ont un impact ». Certes
– et il l’a reconnu –, ces chiffres ne correspondent
pas, loin s’en faut, à l’objectif initialement affiché
d’une réduction de 30 %. «Il faut cependant
considérer les caractéristiques des patients
accueillis dans nos hôpitaux, a-t-il expliqué. Les
progrès de la médecine permettent de soigner
des patients plus âgés, plus fragiles, et donc plus
susceptibles de contracter des infections. En
outre, les actes invasifs sont plus fréquents, et les
pathologies plus lourdes ».
Les résultats de la surveillance des infections du
site opératoire sont à ce titre instructifs. Une dimi-
nution de ces infections est en effet observée
dans les services qui surveillent régulièrement leur
taux d’infections. La surveillance répétée apparaît
donc bien comme un facteur de qualité des soins
et de prévention des risques.
S.H.
qui sera pris en compte pour l’accréditation ou
pour la recherche de responsabilité en cas d’ac-
cident. Ils sont même devenus un passage obligé
tant la France se distingue par une fréquence
particulièrement élevée de résistance aux anti-
biotiques : 34 % des staphylocoques sont résis-
tants à la méticilline, contre 1 % seulement dans
les pays nordiques.
S.H.

20
A
pparemment simple, le lavage des mains est
en réalité un geste complexe, qui est rendu
tout soin non invasif (prise de température, etc.),
avant et après tout contact avec un patient ou du
matériel contaminé.
Le second, le lavage antiseptique, est destiné à
éliminer la flore transitoire et à diminuer la flore
résidente. Il doit être effectué avec un savon li-
quide antiseptique avant tout soin technique et
tout acte invasif (injection, sondage urinaire,
pansement...), dans le cadre de protocoles de
lutte contre les infections nosocomiales, avant et
après tout soin septique (malade infecté, mesure
d’isolement), en remplacement du lavage simple.
Enfin, le lavage chirurgical poursuit le même but
que le lavage antiseptique. Mais il doit être effec-
tué avant tout acte invasif à haut risque infectieux
(cathétérisme central, ponction lombaire, etc.) et
avant tout acte chirurgical. Surtout, il nécessite
une eau bactériologiquement pure, avec une ro-
binetterie dégagée à commande non manuelle,
un savon liquide antiseptique à large spectre, une
brosse à usage unique stérile imprégnée ou non
de solution moussante, des essuie-mains stériles
et le port de coiffe et de masques ajustés.
Générer une prise de conscience
Si, à l’hôpital, la politique du lavage des mains est
prioritaire, elle ne peut être menée à bien que si
les équipements sont correctement choisis, en-
tretenus et utilisés, et qu’elle est abordée sous
l’angle de l’organisation, de la formation et de
l’évaluation. Les lavabos doivent par exemple être
nettoyés et désinfectés quotidiennement ; les
pains de savon sont à prescrire ; le savon liquide
doit être conservé dans son emballage d’origine
portant les informations nécessaires à une bonne
utilisation du produit et de ses limites de consom-
mation afin d’éviter une contamination et une dé-
gradation de celui-ci ; enfin, les pompes distri-
butrices doivent être changées entre chaque
flacon ou soigneusement décontaminées et rin-
cées avant réutilisation.
Aujourd’hui, tout le monde semble reconnaître
l’impérieuse nécessité du lavage des mains, pre-
mier barrage de l’infection nosocomiale. Il reste
cependant important de renouveler régulièrement
Professions Santé Infirmier Infirmière - No37 - mai 2002
Hygiène
Le lavage des mains
Pour éviter les infections manuportées
Encore ! Mettre en exergue le lavage des mains peut paraître puéril à certains. Pourtant,
geste élémentaire de la prévention des infections nosocomiales, le lavage des mains est
encore trop souvent négligé à l’hôpital.
d’autant plus difficile qu’il faut le répéter sou-
vent. Son efficacité dépend de nombreux fac-
teurs, tant matériels (quantité et qualité des
consommables, etc) qu’organisationnels, qui ont
tous une incidence budgétaire.
Le soin qu’il convient d’apporter au lavage
des mains tient au fait que la transmission des
micro-organismes se fait souvent de manière di-
recte, d’individu à individu. Les transports, la
convivialité, les soins apportés aux malades, les
contacts répétés avec du matériel souillé sont
autant d’événements expliquant la chronologie
et l’importance de la contamination manupor-
tée, responsable de 50 à 80 % des infections no-
socomiales à l’hôpital. Les mains accueillent et
abritent en effet une flore impressionnante qui,
en l’absence de lavage, peut atteindre des seuils
critiques.
Le reflet de la flore hospitalière
L’objectif majeur du lavage des mains est de pré-
venir la transmission microbienne manuportée
en éliminant la flore microbienne transitoire et,
selon le type de lavage, une partie plus ou moins
importante de la flore résidente, dite aussi flore
commensale. Cette dernière se trouve en super-
ficie sur la peau mais aussi dans les couches plus
profondes. Elle correspond à des contaminants
récents qui ne survivent qu’un temps limité sur
la peau. Pour le personnel soignant, elle est le re-
flet de la flore hospitalière constituée de cocci
pyogènes, d’entérobactéries, de pseudomonas.
L’inconvénient est que ces germes pathogènes ré-
cupérés lors des soins ou lors du travail sont sou-
vent multirésistants aux antibiotiques.
Classiquement, on obtient trois types de lavage
des mains. Le premier est le lavage simple, éga-
lement appelé “normal” ou “habituel”, qui vise à
éliminer la flore transitoire. Il doit être effectué
avec un savon liquide doux, c’est-à-dire non an-
tiseptique, à la prise de service et en le quittant,
avant et après tout geste de la vie courante (dis-
tribution de repas, toilette, etc), avant et après

des rappels à ce sujet et de générer une prise de
conscience pour le soignant du risque d’un lavage
peu ou mal effectué, pour lui comme pour le ma-
lade. Dans ce contexte, l’infirmière hygiéniste se
situe comme une partenaire utile et complémen-
taire. Elle peut même apporter une expertise ex-
térieure. Son rôle est, entre autres, d’aider à mettre
au point les recommandations de base.
Port de gants et allergie
L’hygiène des mains se dissocie difficilement du
port de gants. La première règle est de n’enfiler
des gants qu’après avoir soigneusement lavé ses
mains. La seconde règle réside dans le choix de
ces gants. Le développement du risque infec-
tieux, qui a conduit à l’augmentation de l’usage
de gants en latex, a été un facteur de sensibilisa-
tion des soignants et des patients. Les études sur
les allergies des premiers – et les risques pour les
seconds – se multiplient en effet depuis plusieurs
années. A la fin des années 90, de fortes inquié-
tudes concernant l’allergie au latex se sont no-
tamment manifestées, après plusieurs décès lors
de l’administration de lavements barytés. Or, il
s’est avéré que le responsable de ces accidents
était le latex contenu dans les canules de lave-
ments. On découvrit alors qu’en chirurgie, 13 %
des réactions avec choc anaphylactoïdes obser-
vées chez les patients étaient dues au contact
avec du caoutchouc naturel. La poudre des gants
joue aussi un rôle important dans la formation
d’adhérences et entraîne des effets négatifs sur la
cicatrisation des plaies abdominales. En outre, le
matériel introduit dans le corps du patient peut
aussi être contaminé avec de la poudre de gant
durant sa manipulation ou son insertion.
Un autre problème ne doit pas être sous-estimé.
La poudre est absorbable biologiquement, et le
lubrifiant à base de poudre de maïs utilisé dans
la fabrication des gants est traité avec de l’épi-
chlorohydrine. Cet agent, associé à d’autres
constituants chimiques également utilisés dans la
fabrication des gants, peut interférer avec d’im-
portantes procédures de diagnostic biologique,
ou induire des réactions granulomateuses au sein
de tissus ayant subi un traumatisme chirurgical.
Enfin, l’hydratation – c’est-à-dire l’absorption de
fluide par les espaces interstitiels du gant en mi-
lieu humide – contrarie les propriétés des gants
de latex.
En dépit de tous ces constats effectués scientifi-
quement, les pratiques évoluent lentement. De
nombreux soignants, notamment les chirur-
giens, rechignent à utiliser des gants sans poudre
parce qu’ils les considèrent comme moins faciles
à enfiler que les gants avec poudre. Les premiers
gants chirurgicaux sans poudre, apparus en
1982, étaient pourtant conçus avec un hydrogel
polymérisé similaire à celui utilisé par les fabri-
cants de lentilles, et avaient subi de nombreux
tests cliniques de sécurité. La présence de poly-
mère procure en outre une barrière de protection
évitant le contact peau-latex. La force de friction
à l’enfilage (donning force) a également été mesu-
rée : les chercheurs ont démontré que si les forces
de friction des gants avec et sans poudre sont
comparables lorsque les mains sont sèches, elles
sont plus grandes pour les gants avec poudre
avec des mains humides. En fait, les gants avec
poudre se déchirent assez fréquemment quand
ils sont mis avec des mains humides, ce qui n’est
pas le cas des gants sans poudre. Au final, ces
derniers conviennent mieux pour de nombreux
actes en bloc opératoire.
S.H.
21
Professions Santé Infirmier Infirmière - No37 - mai 2002
La désinfection des endoscopes
Le principe de la désinfection des endoscopes vise
à prévenir l’ensemble des risques infectieux pour
chaque patient soumis à l’endoscopie.
La désinfection des endoscopes comporte cinq
étapes qui répondent à des règles strictes :
–le traitement préliminaire doit intervenir le plus
précocément possible après la fin de l’acte pour
éviter le séchage des sécrétions et/ou excrétions,
ou la formation des biofilms ;
–le rincage élimine, par son action physique, les
matières organiques résiduelles et toute trace de
détergent qui pourraient interférer avec le produit
de désinfection utilisé ultérieurement et altérer
ainsi la qualité des optiques des endoscopes ;
–la désinfection proprement dite est une opéra-
tion au résultat momentané permettant d’éliminer
ou de tuer les micro-organismes et/ou d’inactiver
les virus indésirables portés par des milieux inertes
contaminés ;
–le rincage terminal a pour but d’éliminer toute
trace de désinfectant sur le matériel, sans compro-
mettre les résultats ;
–enfin, le stockage doit s'effectuer dans un
endroit propre et sec, à l’abri de toute source de
contamination microbienne.
Le personnel chargé de la désinfection des endo-
scopes doit recevoir une formation spécifique sur
les procédés de désinfection du matériel et une
information sur les risques liés à la manipulation
des substances toxiques et dangereuses. Il faut
aussi lui rappeler la nécessité de respecter les pré-
cautions universelles pour la prévention des acci-
dents liés à l’exposition au sang.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%