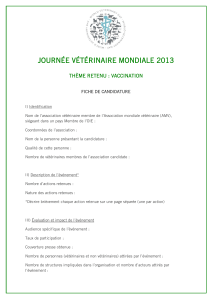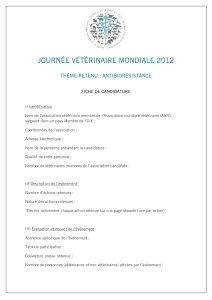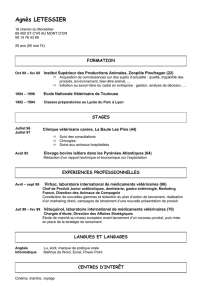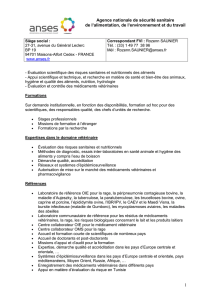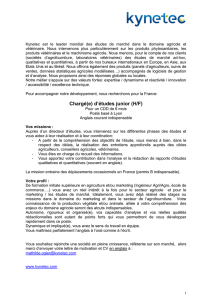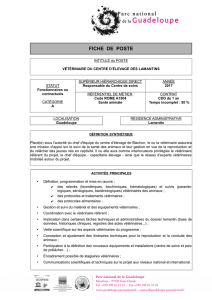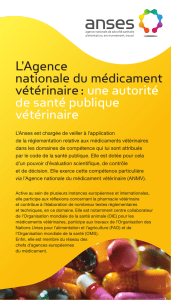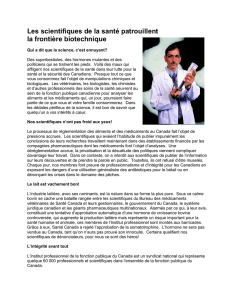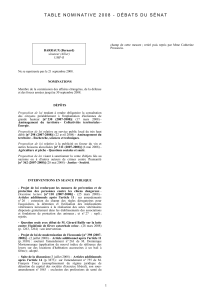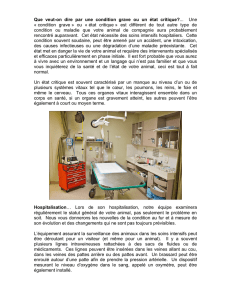Les Services Vétérinaires: Quelle organisation pour l'avenir?

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.,
1987,
6 (4),
885-897
Les Services Vétérinaires:
Quelle organisation pour l'avenir?
L.
BLAJAN *, R.W. GEE **
et.
E.J. GIMENO ***
Résumé : Les Services
Vétérinaires
gouvernementaux ont été créés pour prévenir
et combattre les épizooties qui menacent l'économie des productions animales
et compromettent les échanges mondiaux.
L'insuffisance des moyens mis à leur disposition, l'instabilité économique,
l'opinion publique et la détérioration de l'environnement imposent à ces Services
des transformations pour s'adapter aux situations nouvelles.
Les fonctions
vétérinaires,
au nombre d'une trentaine, qui relèvent du secteur
public dans les pays à économie de marché ou à économie centralement planifiée,
qu'ils soient développés ou en développement, relèvent de trois grandes
caté-
gories
—
économiques, sociales et sanitaires.
L'organisation des Services
Vétérinaires
de l'avenir devra prendre en compte
les technologies nouvelles, donner plus d'importance aux techniques d'analyse
économique pour la gestion des programmes de santé animale. La formation
aux méthodes de gestion et l'adoption des techniques modernes d'administration
publique permettront d'améliorer leur efficacité.
Les auteurs passent en revue les moyens permettant d'atteindre ces objectifs.
MOTS-CLÉS
:
Administration - Analyse économique - Commerce international
- Efficacité - Financement - Formation - Législation - Planification - Production
animale - Progrès technique - Santé animale - Services Vétérinaires.
INTRODUCTION
Le Comité international de l'OIE, préoccupé par la situation à laquelle doivent
faire face de nombreux Services Vétérinaires de par le monde, a décidé lors de sa
53e
Session Générale, en mai 1985, de consacrer une partie des travaux de sa 54e Session
Générale à l'étude de l'organisation des Services Vétérinaires.
Sur la base des rapports reçus de 52 Pays Membres de l'OIE, Sir William
Henderson a présenté à la 54e Session Générale un document de synthèse qui a été
amplement discuté par les participants.
* Directeur Général de l'OIE, 12 rue de Prony, 75017 Paris, France.
** Président sortant du Comité international de l'OIE, 81 Ronald Avenue, Lane Cove, NSW 2066,
Australie.
*** Président du Comité international de l'OIE, Profesor Titular de Epidemiología y Salud Pública,
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, Calle 60 y 118, La Plata, Argentine.

886
En conclusion de cette discussion, le Comité de l'OIE a invité le Directeur Général
de l'OLE à préparer, avec l'aide d'un groupe de travail, des propositions pour
l'organisation future des Services Vétérinaires.
Le groupe de travail, constitué des auteurs du présent document, en a présenté
le contenu à la 55e Session Générale de l'OIE en mai 1987. Le Comité a approuvé
ce rapport et a demandé qu'il soit publié et communiqué aux Gouvernements des
Pays Membres et aux Organisations internationales. C'est ce texte qui est intégralement
reproduit ci-après.
LA PRESSION DES FACTEURS EXTÉRIEURS
La crise économique mondiale attribuée aux deux «chocs pétroliers» de 1974 et
1980,
et que beaucoup ont voulu voir comme un phénomène passager, apparaît
maintenant comme un phénomène durable. On ne parle d'ailleurs plus de crise, mais
de guerre économique : Pégoïsme des nations, la concurrence sans pitié à laquelle
elles se livrent, ont remplacé les slogans généreux des années 60.
Les pays en développement, souvent écrasés sous le poids de la dette extérieure,
ont vu les termes des échanges se dégrader. Les pays exportateurs de produits animaux
rencontrent la concurrence des pays développés qui compensent leurs coûts plus élevés
de production par des subventions à l'exportation. L'insuffisance des revenus de la
production animale pousse les éleveurs marginaux à aller vivre à la périphérie des
grandes villes à la quête d'un emploi. Cet exode rural est accéléré dans certaines
régions, comme le Sahel, par les mauvaises conditions climatiques et, dans d'autres
régions, par les conflits locaux. En dehors de quelques rares pays, auxquels
l'exportation de produits animaux procure des ressources importantes en devises fortes,
le secteur de l'élevage connaît le plus souvent une situation critique. Ceci est
particulièrement vrai des éleveurs exclusifs des régions où seul l'animal peut tirer profit
des maigres ressources du sol. Eleveurs nomades poussant leurs troupeaux à la
recherche de pâturages et d'eau, ils dépendent entièrement des aléas climatiques dont
les effets souvent néfastes alternent avec les épizooties dévastatrices telles que la peste
bovine. Inorganisés, ils vivent en marge de la politique de leur pays et, trop souvent,
ne trouvent aucun appui auprès de leur gouvernement. Ainsi, sont à la veille de
disparaître des civilisations riches de traditions qui laisseront derrière elles le désert
dont, de façon simplificatrice et abusive, elles sont accusées d'être responsables.
Dans les pays en développement, plus que les populations confrontées à des
difficultés immédiates, ce sont les gouvernements et surtout les Organisations
internationales qui sont conscients de l'importance de la préservation des ressources
naturelles. La désertification des régions d'élevage extensif préoccupe à juste titre
la communauté internationale, mais les Services Vétérinaires ne prennent pas la part
qu'ils devraient avoir dans l'étude des solutions de ce problème dont la complexité
justifie une approche multidisciplinaire.
Dans les pays développés on peut, schématiquement, distinguer ceux à économie
de marché et ceux à économie planifiée.
Dans les premiers, le chômage augmente presque partout et les producteurs eux-
mêmes voient leur revenu se dégrader. Les gouvernements dressent à nouveau des

887
barrières tarifaires ou non tarifaires pour protéger leur économie et réduisent les
dépenses correspondant à des programmes qui ne sont pas jugés prioritaires. La taille
des élevages et la productivité y ont considérablement augmenté au cours des dernières
décennies, en même temps que diminuait le nombre des éleveurs. Ceux-ci ont géné-
ralement une très grande compétence technique et économique, en permanence mise
à jour par l'encadrement des organisations professionnelles auxquelles ils sont affiliés.
Bien que peu nombreux, ils constituent un groupe de pression politique non négli-
geable. Ayant un comportement d'industriels, ils cherchent à se dégager au maximum
de toute tutelle administrative. L'intervention des Services Vétérinaires dans ces
élevages se limite donc aux grandes maladies contagieuses (fièvre aphteuse, peste
porcine, etc.) et à celles faisant l'objet de programmes financés par l'Etat (tuberculose,
brucelloses, leucose bovine enzootique). Pour les prophylaxies nouvelles, telles que
celle de la maladie d'Aujeszky, de plus en plus ils en assument eux-mêmes le coût.
Les pouvoirs publics de la plupart de ces pays estiment en effet que ce sont les éleveurs
bénéficiaires de ces programmes qui doivent en assurer le financement. Ces mêmes
pouvoirs publics jugent également possible de réduire les moyens des Services Vétéri-
naires, puisque les épizooties meurtrières semblent maintenant appartenir au passé.
Il existe parfois une tendance à ne reconnaître aux Services Vétérinaires qu'un rôle
de protection, plus économique que sanitaire, vis-à-vis des produits étrangers.
La deuxième catégorie comprend les pays à économie planifiée. Comme dans le
groupe précédent, les épizooties dévastatrices sont maintenant maîtrisées. Mais la
production animale ne relève que très rarement d'entreprises individuelles ; elle est
planifiée au niveau central et généralement sur plusieurs années. Les activités sani-
taires sont considérées comme un outil technique de la production, leur coût est
quantifié à l'avance et tout dérapage par rapport à l'objectif fixé par le plan peut
être mis sur le compte d'une défaillance technique vétérinaire. Ce sont donc les Services
Vétérinaires qui assument cette responsabilité technique. Confrontés essentiellement
aux problèmes de la pathologie multifactorielle des élevages intensifs, ils disposent
en règle générale de moyens en personnel et logistiques suffisants. Il n'est cependant
pas certain qu'ils soient toujours associés étroitement aux décisions qui aboutissent
à la définition du plan.
Dans tous les pays développés, sous la pression de l'opinion publique, et notam-
ment des associations de défense des consommateurs, la qualité et la salubrité des
denrées d'origine animale sont maintenant une priorité. Les Services Vétérinaires
pourraient être amenés, en raison de la sensibilité accrue de l'opinion à ces problèmes,
à inspecter les élevages afin de s'assurer que les médicaments et les pesticides employés
sont conformes à la législation en vigueur, que la réglementation relative au bien-
être des animaux y est respectée, et enfin pour certifier, avant l'abattage, que ceux-ci
sont en bonne santé et exempts de résidus.
Les Services Vétérinaires, confrontés à une évolution rapide des facteurs extérieurs,
devraient prendre conscience de la transformation du paysage social, politique et écono-
mique, et revoir leur politique et l'étendue de leurs responsabilités en conséquence.
ATTRIBUTIONS ET ACTIVITÉS
A l'origine, les Services Vétérinaires ont été mis en place pour améliorer la santé et
la productivité du bétail : ils se sont vus confier ensuite l'inspection des denrées alimen-

888
taires pour protéger la santé publique et faciliter les échanges internationaux. Puis, grâce
aux progrès réalisés dans le domaine scientifique, leur activité, qui se bornait jusque-là
au secteur strictement vétérinaire,
s'est
élargie à d'autres domaines, celui des
médicaments notamment. Néanmoins, la préoccupation essentielle des services officiels
a été, jusqu'à une époque relativement récente, de lutter contre les grands fléaux
épizootiques, et de les prévenir. Par la suite, les pouvoirs publics, confrontés à une
opinion plus exigeante, ont tenté de répondre à cette évolution en élargissant le champ
des compétences des Services Vétérinaires. A ce jour, leurs activités peuvent être rangées
sous trois grandes rubriques, en fonction de leur finalité :
- Economique : prophylaxie des maladies animales, contrôle sanitaire aux
frontières, production animale, contrôle des médicaments vétérinaires, facilitation des
échanges commerciaux.
- Sociale : protection des animaux d'élevage, soins aux animaux de compagnie,
formation et relations professionnelles.
- Sanitaire : lutte contre les zoonoses, inspection et protection des denrées
alimentaires.
La tâche des Services Vétérinaires apparaît dans toute sa complexité si l'on songe
qu'ils doivent le plus souvent prendre en compte ces différents facteurs dans les actions
qu'ils conduisent.
S'ils
s'acquittent de leurs missions et de leurs responsabilités selon des modalités
différentes suivant les pays, les vétérinaires sont compétents, d'une manière générale,
dans cinq grands domaines :
- la gestion des prophylaxies officielles, la production animale, la santé publique,
le contrôle sanitaire aux frontières et la protection de l'environnement ;
- les examens cliniques et traitements des animaux ;
- les médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire ;
- l'enseignement ;
- la recherche.
Les responsabilités des Services Vétérinaires varient considérablement d'un pays à
l'autre, mais dans tous les cas, il est important qu'ils gardent des liaisons étroites avec
tous les autres secteurs d'activité vétérinaire. Leurs fonctions et attributions doivent être
clairement définies et approuvées par le gouvernement ; il est également souhaitable
qu'elles correspondent aux souhaits des éleveurs et du public dont l'appui est nécessaire.
Les objectifs prioritaires doivent être fixés et approuvés par les instances supérieures.
Le Service Vétérinaire ne doit pas assumer de nouvelles tâches sans avoir revu, au
préalable, l'ordre des priorités ainsi que l'affectation des crédits ou en avoir obtenu
l'augmentation. Ses activités et ses responsabilités doivent être réévaluées et leur ordre
de priorité redéfini périodiquement.
Un plan élaboré avec toutes les parties intéressées, définissant la politique, les
objectifs, les stratégies, les repères, les cibles et la procédure de révision, constitue un
outil de gestion très rationnel, dont le principe s'impose de plus en plus. Ce genre de
plan facilite considérablement la définition des priorités, l'obtention des ressources
nécessaires et l'approbation des programmes d'action.

889
En définitive, les attributions et les activités des Services Vétérinaires officiels seront
très variables selon le niveau de développement des pays et leur système politique. De
toute évidence, le rôle du secteur vétérinaire privé dans les pays à économie de marché
impliquera une approche de la planification très différente de celle des pays à économie
centralement planifiée. Les programmes vétérinaires des pays développés ou en
développement seront influencés par le type et l'importance des productions animales,
ainsi que par les ressources du pays.
En dépit de ces différences, les activités mises en œuvre dans les Pays Membres de
l'OIE présentent dans l'ensemble un grand nombre de points communs, qu'il s'agisse
des formes d'action traditionnelles ou de leur évolution à venir.
La dernière étude effectuée auprès des 110 Pays Membres indique que l'éventail des
activités vétérinaires est le suivant :
1.
Prophylaxie des maladies animales : programmes de prophylaxie et d'éradication
en accord avec les grandes orientations nationales ; méthodes de diagnostic, de
prévention, de traitement et de financement.
2.
Maladies exotiques : surveillance, recherche, diagnostic et prophylaxie ; forma-
tion ; programmes d'urgence et plans pour des situations accidentelles.
3.
Epidemiologie : systèmes d'information, collecte et analyse de données, études
de faisabilité économique et technique, systèmes d'identification du cheptel.
4.
Contrôle sanitaire aux frontières : protocoles d'importation, négociations
internationales, détermination des importations prioritaires, stations de quarantaine.
5.
Economie : études coût/avantages des programmes de santé et de productions
animales.
6. Exportation d'animaux et de produits animaux : contrôle et certification,
négociations internationales, supervision des transports, service après-vente, stations
de quarantaine.
7.
Production animale : reproduction, génétique, alimentation et conduite de
l'élevage ; systèmes de type intensif et
extensif,
surveillance des troupeaux nomades et
des pâturages.
8. Reproduction artificielle : techniques d'insémination artificielle et de transfert
d'embryons, supervision et certification.
9. Commercialisation : création de nouveaux croisements, systèmes de vente et de
transport, classification des animaux et de leurs produits.
10.
Coopération internationale : déclaration des maladies, programmes régionaux
de prophylaxie, banques de vaccins, programmes d'assistance technique.
11.
Aquaculture : pisciculture, hygiène du milieu, prophylaxie des maladies.
12.
Faune sauvage : préservation des différentes espèces, prophylaxie des maladies,
capture, études de croisement entre espèces.
13.
Jardins zoologiques : préservation du patrimoine génétique, diagnostic et
traitement des maladies.
14.
Animaux de laboratoire : reproduction et conduite de l'élevage, prophylaxie des
maladies et protection animale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%